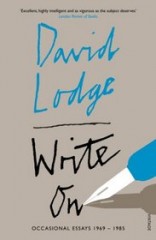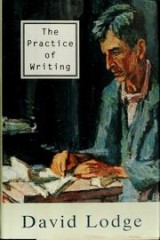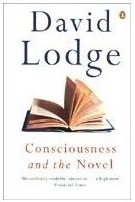En 1989, Jeu de société est publié en français chez Rivages, et depuis lors « l’augmentation remarquable » du nombre de ses lecteurs français est « l’un des aspects les plus surprenants et les plus gratifiants » de sa vie d’écrivain, confie David Lodge (né en 1935). Dans A la réflexion (2004), le romancier anglais, qui a été professeur de littérature anglaise à l’université de Birmingham, a rassemblé des articles et des conférences sur ses propres romans, au risque de paraître égocentrique, pour les lecteurs intéressés par cette « entreprise de réflexion et de révélation » sur sa pratique d’écrivain.

David Lodge - Photo Sophia Evans (The Guardian)
David Lodge écrit dans de nombreux registres : romans, nouvelles, critique universitaire, comptes rendus de lecture, journalisme… Ecrire – « la seule chose que je sache vraiment faire » – offre des résultats durables : « Les textes n’appartiennent pas seulement à la mémoire. Ils sont recréés chaque fois que quelqu’un les lit. » Issu de la « toute petite bourgeoisie » catholique, l’écrivain a grandi dans la banlieue de Londres, unique enfant d’un mariage mixte entre un père « non-catholique » et une mère « croyante, mais sans ostentation ». Vers seize ans, ses lectures le rendent de plus en plus critique « à l’égard de la culture « ghetto » catholique » hostile envers les arts et lorsqu’il lit Portrait de l’artiste en jeune homme, il s’identifie immédiatement à Stephen Dedalus.
« J’appartiens à la dernière génération d’Anglais pour qui le mariage était la seule façon socialement autorisée d’avoir des relations sexuelles » affirme Lodge dans « L’amour et le mariage dans le roman ». Il constate que les deux plus grands romanciers modernes de langue anglaise ont défié la conception traditionnelle du mariage tout en s’y conformant : D. H. Lawrence s’enfuit avec Frieda Weekley, la femme d’un professeur de lettres françaises, avec qui il aura trois enfants – une union chaotique mais il lui reste fidèle ; Joyce s’enfuit avec Nora Barnacle, une femme de chambre, et proteste quand on l’accuse d’immoralité : « de toute ma vie, je n’ai aimé qu’une seule femme. »

Joyce est pour Lodge la référence majeure. En 1979, il assiste au Symposium international James Joyce à Zurich, ville où l’Irlandais a passé la première guerre mondiale et où il est mort pendant la seconde. On y trouve un authentique bar de Dublin (démonté et rebâti), le James Joyce Pub. Bien sûr les spécialistes s’y retrouvaient le soir – les congrès internationaux sont pour Lodge « un matériau de fiction » d’une grande richesse. « Mon Joyce » revient sur ce compagnonnage avec un écrivain lu et relu, commenté et enseigné. « Je lisais Joyce mais (…) en un certain sens, je fus aussi « écrit » par lui ».
Vous trouverez dans A la réflexion de quoi éclairer les romans de David Lodge, de Un tout petit monde à Pensées secrètes, ainsi que de nombreux éléments autobiographiques, même si avec son humour habituel, l’écrivain prévient : « Il faut reconnaître que ce qui se donne ici pour une sorte de confession ou d’aveu est souvent une façon de dissimuler ou de se construire une image – mais n’est-ce pas là l’origine de la fascination qu’exercent les miroirs que se tend un auteur ? » (Préface)
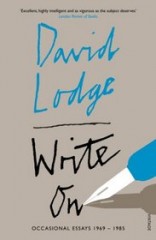
Lodge raconte comment ses sujets lui viennent, comment il griffonne dans un cahier « entièrement consacré au projet », comment il trouve les lignes directrices avant de composer. Il insiste sur l’importance de concevoir une « idée de structure », comme Joyce l’a fait dans Ulysse avec L’Odyssée, c’est pour lui « le stade le plus important de la genèse d’une œuvre. » Par exemple, dans Thérapie, il voulait écrire sur la dépression et c’est quand il a pensé que son narrateur « devrait peut-être lire Kierkegaard » que son projet a pris forme.
Les rapports entre réalité et fiction sont « ambivalents et contradictoires ». Dans son œuvre, Birmingham devient « Rummidge », un lieu fictif, ce qui permet à l’auteur d’exagérer ou de déformer la réalité : « Un roman est un jeu, un jeu qui nécessite la présence de deux joueurs, un lecteur aussi bien qu’un écrivain. » Il va sans dire que les lecteurs fidèles de David Lodge retrouvent avec plaisir dans cet essai ses personnages et leurs situations souvent comiques (mais pas « frivoles », selon sa distinction).
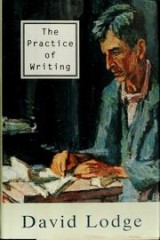
A la réflexion s’attache à situer le roman actuel dans l’histoire du genre et dans la société contemporaine, « un statut ambigu entre l’œuvre d’art et le bien de consommation ». Lodge remarque qu’au moment où la critique universitaire poststructuraliste a décrété la « mort de l’auteur », les auteurs contemporains suscitent vers leur personne un intérêt public sans précédent. « Le succès commercial de la littérature dépend de la collaboration entre l’écrivain, l’éditeur et les médias. » Il évoque la dérive financière des grands groupes d’édition et la recherche « frénétique » du best-seller. Lodge revient en particulier sur l’à-valoir faramineux obtenu par Martin Amis pour L’information en 1995. Il aborde aussi la question des cours de création littéraire et le rôle de la critique.
Moi qui aime partager mes lectures avec vous, j’ai lu avec une attention particulière « Le roman comme forme de communication ». David Lodge rappelle qu’« il est quasiment impossible de discuter d’un roman sans le résumer ou sans supposer que votre interlocuteur connaît l’histoire ; ce qui ne signifie pas que l’intrigue soit la seule ou même la principale raison de s’y intéresser, mais plutôt, que c’est le principe fondamental qui le structure. (…) Le récit s’intéresse au processus, c’est-à-dire au changement qui intervient dans un certain état de choses ; ou bien, il convertit les problèmes et les contradictions de l’expérience humaine en processus pour les comprendre ou les résoudre. »
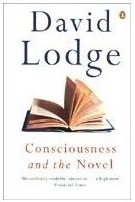
« La conscience et le roman », un texte plus ambitieux d’une centaine de pages, termine le recueil. J’ai apprécié la simplicité avec laquelle David Lodge explique sa conception de l’écriture et expose son « savoir-faire ». Et aussi qu’il se réfère, dans la littérature anglo-saxonne principalement, à des écrivains comme Graham Greene ou Henry James, mais aussi à Jane Austen, Virginia Woolf ou Jane Smiley, entre autres. S’il n’en parle pas, Lodge est sans doute très conscient de ce qu’aujourd’hui, la plupart de ses lecteurs sont des lectrices.