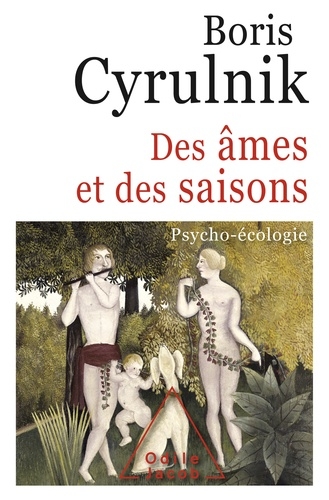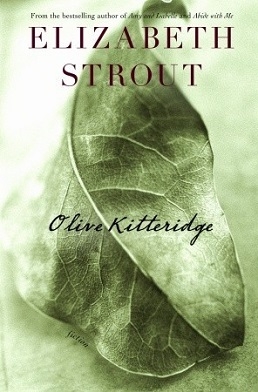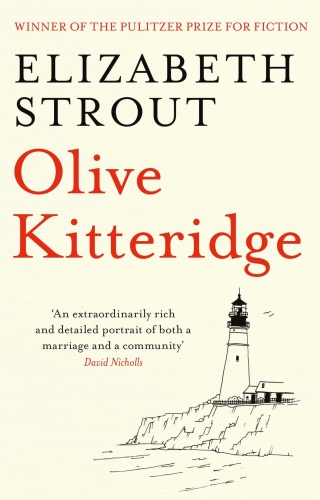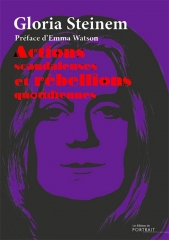Des âmes et des saisons, l’essai de Boris Cyrulnik publié l’an dernier, a pour sous-titre « Psycho-écologie ». « L’homme n’est pas séparable de son environnement dont son corps est un carrefour. Son âme, elle aussi, est à la croisée des contraintes. » S’appuyant sur des données scientifiques, ici souvent empruntées aux neurosciences, Cyrulnik examine le développement d’un être vivant dans une approche qui intègre « une cascade de causes hétérogènes qui convergent pour conjuguer l’âme et le corps : habitat climatique, ambiance affective, structure sociale, entourage verbal et récits culturels. »
Le neuropsychiatre aborde dans leur évolution historique la manière dont se distribuent les rôles des hommes et des femmes, d’une part, et la façon dont le cerveau se développe, d’autre part. Pour ce qui est des rôles masculin et féminin, ses raccourcis stéréotypés me laissent souvent perplexe. Par exemple quand il fait dire aux femmes à l’époque des « chasseurs musclés » : « OK, je serai ta femelle servante et tu seras mon mâle protecteur. » Il constate que la domination « qui a été une adaptation pour survivre » ne produit que du malheur aujourd’hui, dont nous ne sortirons qu’en prenant une nouvelle direction « vers l’unité de la Terre et du monde vivant ».
J’ai été plus intéressée par ses explications sur le cerveau humain « sculpté différemment selon les pressions des milieux précoces », Dans l’utérus puis dans le foyer, la construction du cerveau est influencée par les émotions ressenties dans un milieu sécurisant ou adverse. On a mesuré, par exemple, que la réception de la douleur est plus ou moins tolérée selon qu’on a acquis ou pas un facteur de protection dans les premières années de sa vie, étant donné que le cerveau est « circuité par le milieu ».
Un bon départ dans la vie renforce la résistance « aux inévitables agressions de l’existence », mais un mauvais départ ne signifie pas que ce soit perdu pour toujours – « le cerveau se transforme sans cesse selon les apprentissages et les expériences de la vie » (I. Mansuy). Après un traumatisme, certains se servent de la parole pour atténuer leur douleur quand d’autres « aggravent leurs souffrances en ruminant » (syndrome post-traumatique). Pour un psychologue, « ce qui est vrai n’est vrai que pour chacun d’entre nous ».
Cyrulnik évoque aussi la résilience dont peuvent faire preuve les plantes et les animaux, mais il s’attache surtout au développement humain en interaction avec les autres et avec le monde : « L’esprit des êtres humains organise le milieu qui sculpte le corps et l’âme de ceux qui y vivent. Depuis les chasseurs-cueilleurs, nous avons incroyablement modifié le milieu, qui nous a incroyablement modifiés. » Le cerveau ne cesse de changer sous les pressions naturelles et culturelles toujours en changement.
Après avoir montré à l’aide de nombreux exemples à quel point la « niche affective » joue un rôle positif ou négatif sur l’avenir d’un bébé – les mille premiers jours de la vie sont la période où le cerveau est le plus sensible –, l’auteur se penche sur la période critique de l’adolescence. Il n’y a pas pour autant de déterminisme social dans l’évolution d’un individu, ce sont des probabilités et non des certitudes, des cas contraires en témoignent.
A l’adolescence, le cerveau réduit ses circuits mais améliore ses performances. Pourquoi tant de souffrance chez un tiers des moins de dix-huit ans ? se demande-t-il. Cela l’amène à examiner les effets secondaires indésirables du progrès : surpopulation, dilution affective, perte de sens. Boris Cyrulnik décrit les problèmes d’une société où, de plus en plus souvent, on naît hors mariage, on se sépare, on postpose la maternité ou on la refuse, où on ne voit plus bien quel rôle est le sien, où on prend conscience que l’homme n’est pas au-dessus de la nature mais dans la nature...
Deux citations de Cyrulnik que j’ai trouvées encourageantes pour conclure cet aperçu d’un livre stimulant, qui souligne l’importance des débuts de la vie et de l’éducation. D’abord, ce qui peut paraître une évidence, mais qui n’en est pas une : « Ceux qui meurent sont ceux qui ont eu la chance de vivre. » Et puis celle-ci : « Les catastrophes écologiques et sociales sont souvent l’occasion de nouvelles directions. »