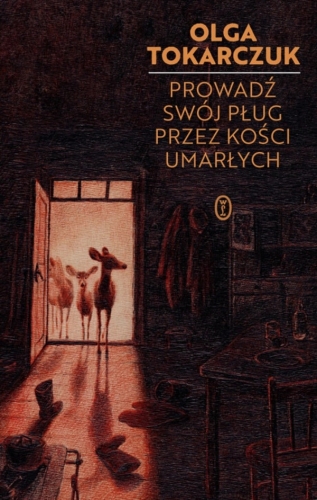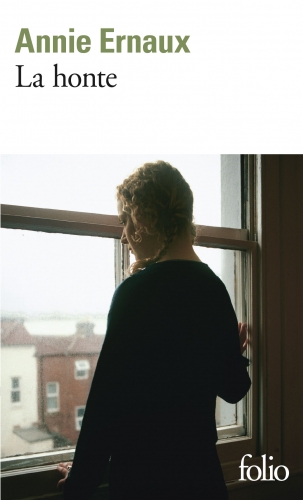« D’une certaine façon, les gens comme elle [l’Ecrivaine], ceux qui manient la plume, j’entends, peuvent être dangereux. On les suspecte tout de suite de mentir, de ne pas être eux-mêmes, de n’être qu’un œil qui ne cesse d’observer, transformant en phrases tout ce qu’il voit ; tant et si bien qu’un écrivain dépouille la réalité de tout ce qu’elle contient de plus important : l’indicible. »
« D’une certaine façon, les gens comme elle [l’Ecrivaine], ceux qui manient la plume, j’entends, peuvent être dangereux. On les suspecte tout de suite de mentir, de ne pas être eux-mêmes, de n’être qu’un œil qui ne cesse d’observer, transformant en phrases tout ce qu’il voit ; tant et si bien qu’un écrivain dépouille la réalité de tout ce qu’elle contient de plus important : l’indicible. »
- Page 2
-
-
La gardienne et eux
Le titre du roman d’Olga Tokarczuk Sur les ossements des morts, publié en 2010 (traduit du polonais par Margot Carlier), est tiré du livre de William Blake, Le Mariage du Ciel et de l’Enfer (1793) – « Conduis ta charrue par-dessus les ossements des morts » – et les épigraphes des chapitres, de ses Proverbes de l’Enfer.
« Je suis à présent à un âge et dans un état de santé tels que je devrais penser à me laver soigneusement les pieds avant d’aller me coucher, au cas où une ambulance viendrait me chercher en pleine nuit. » L’autodérision rassure à l’entrée du récit. Je ne m’attendais pas à tant d’humour dans cette histoire qui commence avec des coups frappés à la porte au milieu de la nuit. Son voisin, Matoga, demande à la narratrice de s’habiller : « Grand Pied est mort. »
« Comment ça, « il est mort » ? » ai-je fini par demander, la gorge serrée, en rouvrant la porte. Mais Matoga ne m’a pas répondu.
En général, il est très peu loquace. Selon moi, il doit avoir Mercure en Capricorne, un signe de silence, ou bien en conjonction, en carré ou peut-être en opposition avec Saturne. Cela pourrait être aussi un Mercure rétrograde – ce qui est typique pour un introverti. »Mme Doucheyko (Janina, qui déteste son prénom et donne un surnom de son choix à chaque personne qu’elle rencontre) est une astrologue passionnée et la gardienne du hameau : elle veille sur les maisons vides durant l’hiver. Grand Pied, Matoga et elle sont les seuls à y vivre toute l’année. Matoga a entendu la chienne de Grand Pied aboyer, vu de la lumière dans la cuisine et il la prévient : « Ça n’est pas beau à voir. » Se frayant un chemin dans la neige derrière lui et sa lampe torche, elle remarque les yeux brillants de deux biches qui les suivent, des « Demoiselles » comme elle les appelle.
Ils n’arrivent pas à joindre la police par téléphone, juste à capter « la voix tchèque d’un répondeur automatique » (Luftzug n’est pas loin de la frontière). Matoga la convainc de déplacer le cadavre sur le divan et de l’habiller plus dignement, même si elle lui rappelle qu’ils devraient attendre l’arrivée de la police. Apparemment l’homme s’est étouffé avec un os coincé dans la gorge – il reste une tête de biche tranchée et des restes de repas dans sa cuisine.
L’hiver est difficile sur le plateau avec la neige, le vent, le grand froid, et la route est mauvaise, qui mène jusqu’à Wroclaw ou en Tchéquie. Bien que voisins, Matoga et Mme D. ne sont pas très proches : il est aussi ordonné qu’elle ne l’est pas. Elle n’aimait pas Grand Pied et avait même déposé plainte contre lui pour braconnage ; la police n’y avait pas donné suite, excédée par cette « folle à lier » qui prend la défense des animaux et tient tête aux chasseurs. La gardienne et eux ne sont pas en bons termes.
Passionnée par la chaîne météo et ses annonces qui divisent la population en « skieurs, allergiques et conducteurs », la narratrice observe les étoiles, enterre les animaux morts, surveille les maisons des Professeurs, de l’Ecrivaine, des Dupuits. Quand elle fait sa ronde dans le paysage noir et blanc, son œil est chaque fois blessé de se poser sur les « ambons », huit tribunes érigées par les chasseurs pour appâter le gibier.
Le jour, elle fait ce qu’elle a à faire, malgré ses maux douloureux. Le soir, elle s’occupe de thèmes astrologiques à l’aide d’éphémérides et de livres pour étudier « les ordres de la mort » selon les planètes. Son ancien élève Dyzio, informaticien de la police, lui a offert un ordinateur et vient chaque vendredi lui raconter son travail en cours : il traduit William Blake.
Une nuit au temps particulièrement exécrable, elle le reconduit en voiture (son « Samouraï ») et ils remarquent une lumière inhabituelle près du col ; ils y découvrent la voiture du chef de la police et son cadavre dans un vieux puits, entouré d’empreintes de sabots. « Dyzio, ce sont les animaux qui se vengent des hommes. » – « Tu es sous le choc. Tu racontes n’importe quoi. »
Sur les ossements des morts n’est pas un roman policier, mais il s’y produit une série de meurtres mystérieux sur lesquels Mme Doucheyko a sa propre idée. Très observatrice de la nature, du ciel, des animaux et des humains, elle commente tout sous un angle original, inattendu, attentive aux subtiles « corrélations » entre les choses. Matoga lui conseille de ne pas trop ébruiter ses théories, qui pourraient lui causer du tort, elle s’en fiche. Elle ne s’est jamais remise de la disparition de ses deux chiennes, ses « Petites Filles ».
Olga Tokarczuk campe ici un personnage de vieille excentrique très attachant, malgré ses lubies, voire à cause d’elles. Ingénieure des ponts et chaussées puis institutrice, elle donne encore des cours d’anglais une fois par semaine en ville. Ce roman nous apprend des noms d’oiseaux et d’insectes, des proverbes de Blake et décrit la vie quotidienne d’une retraitée dans ce coin perdu de Pologne où la Tchéquie toute proche semble le pays idéal. S’il y est question essentiellement de la vie et de la mort, c’est à travers une succession de péripéties désolantes et de remarques désopilantes que je me garderai bien de vous dévoiler.
(Un roman apprécié aussi par Dominique, Claudialucia, Keisha, Marilyne - entre autres.)
-
Topographie
 « Décrire pour la première fois, sans autre règle que la précision, des rues que je n’ai jamais pensées mais seulement parcourues durant mon enfance, c’est rendre lisible la hiérarchie sociale qu’elles contenaient. Sensation, presque, de sacrilège : remplacer la topographie douce des souvenirs, toute en impressions, couleurs, images (la villa Edelin ! la glycine bleue ! les buissons de mûres du Champ-de-Courses !), par une autre aux lignes dures qui la désenchante, mais dont l’évidente vérité n’est pas discutable par la mémoire elle-même : en 52, il me suffisait de regarder les hautes façades derrière une pelouse et des allées de gravier pour savoir que leurs occupants n’étaient pas comme nous. »
« Décrire pour la première fois, sans autre règle que la précision, des rues que je n’ai jamais pensées mais seulement parcourues durant mon enfance, c’est rendre lisible la hiérarchie sociale qu’elles contenaient. Sensation, presque, de sacrilège : remplacer la topographie douce des souvenirs, toute en impressions, couleurs, images (la villa Edelin ! la glycine bleue ! les buissons de mûres du Champ-de-Courses !), par une autre aux lignes dures qui la désenchante, mais dont l’évidente vérité n’est pas discutable par la mémoire elle-même : en 52, il me suffisait de regarder les hautes façades derrière une pelouse et des allées de gravier pour savoir que leurs occupants n’étaient pas comme nous. »Annie Ernaux, La honte (in Ecrire la vie)
-
12 ans, 23 ans
Plus de vingt ans après Les armoires vides, Annie Ernaux revient dans La honte et dans L’événement sur deux expériences qui ont changé son existence. Deux clichés de son « photojournal » (Quarto) permettent d’imaginer son allure à douze ans, près de son père à Biarritz, et celle de l’étudiante « mutine » de vingt-trois ans, au Havre.
Ernaux emprunte à Paul Auster l’épigraphe de La honte (1997) : « Le langage n’est pas toujours la vérité. Il est notre manière d’exister dans l’univers. » Le drame est énoncé d’emblée : « Mon père a voulu tuer ma mère un dimanche de juin, au début de l’après-midi. » Sa mère ne cessant de récriminer, son père tremblant de colère l’avait empoignée et la menaçait avec une serpe. La petite Annie D. (Duchesne) appelant au secours, cela s’était terminé avec des cris et des pleurs. Elle se souvient d’avoir dit à son père : « Tu vas me faire gagner malheur ». Depuis cette scène inoubliable du 15 juin 1952, elle a toujours eu peur que cette violence se répète, jusqu’à la mort de son père quinze ans après. Ce fut la fin de son enfance et le début de la honte, écrit-elle des décennies plus tard.
« Ce qui m’importe, c’est de retrouver les mots avec lesquels je me pensais et pensais le monde autour. » En « ethnologue » d’elle-même, elle décrit le pays de Caux d’alors, entre Le Havre et Rouen, reconstitue la topographie de « Y. », où tout oppose la rue du Clos-des-Parts et la rue de la République. Quand elle rentrait avec sa mère à l’épicerie-mercerie-café, celle-ci disait : « On arrive au château ». Annie Ernaux rappelle leur parler, les expressions, les gestes, l’éducation (« corriger et dresser »), la surveillance générale dans le quartier : « Les conversations classaient les faits et gestes des gens. » Il fallait être « simple, franc et poli » pour « être comme tout le monde ». Elle ajoute : « Je ne connaîtrai jamais l’enchantement des métaphores, la jubilation du style. »
De l’école privée catholique, de la religion alors « la forme de [son] existence », elle passe de son comportement d’excellente élève à ses sentiments d’envie en observant « les plus grandes », de solitude, de curiosité pour les choses sexuelles. Sa mère prend le relais à la maison. Sans être très pratiquante, elle s’habille pour l’église comme pour une sortie et par désir de distinction. Son père ne prie pas.
Depuis la mi-juin, Annie se sent indigne, « dans la honte ». En août, un voyage touristique à Lourdes en autocar avec son père – dix jours en compagnie d’inconnus – lui permet de découvrir le luxe des chambres d’hôtel (lavabo, eau chaude) et d’autres usages. Celle qu’elle est en 1996 n’a « plus rien de commun avec la fille de la photo (de 1952), sauf cette scène du dimanche de juin qu’elle porte dans la tête et qui [lui] a fait écrire ce livre, parce qu’elle ne [l’]a jamais quittée. »
Dans L’événement (2000), autre récit court (une cinquantaine de pages), elle revient sur son avortement en 1963, d’une façon factuelle, très différente par rapport aux Armoires vides. D’abord l’attente vaine des règles, les nausées, le verdict du médecin, l’horreur de se retrouver enceinte. « Les mois qui ont suivi baignent dans une lumière de limbes. Je me vois dans les rues en train de marcher continuellement. » Annie Ernaux a depuis longtemps le désir d’écrire « là-dessus » et ne veut pas mourir sans l’avoir fait. Son agenda et son journal lui donnent des repères pour raconter cette expérience vécue dans la clandestinité. (La loi Veil date de 1975.)
Elle y voit un lien confus avec son origine : l’étudiante a échappé « à l’usine et au comptoir » mais pas à « l’échec social » de la fille enceinte ou de l’alcoolique. Tout de suite, elle sait qu’elle se fera avorter. En quête d’un médecin « marron » ou d’une « faiseuse d’anges », sans aide de celui qui l’a mise enceinte, elle en parle à un étudiant marié, qui lui donne le nom d’une étudiante passée par là, qui « a failli en crever d’ailleurs ». Les visites chez des généralistes s’avèrent inutiles – « les filles comme moi gâchaient la journée des médecins ».
L’un d’eux, consulté après un essai infructueux de manier elle-même des aiguilles à tricoter, lui dit : « Je ne veux pas savoir où vous irez. Mais vous allez prendre de la pénicilline, huit jours avant et huit jours après. Je vous fais l’ordonnance. » Quand elle se rend chez la faiseuse d’anges « impasse Cardinet, dans le XVIIe à Paris », à trois mois, en janvier 1964, c’est « le bon moment pour le faire ». Annie Ernaux a écrit L’événement pour mettre en mots « une expérience humaine totale, de la vie et de la mort, du temps, de la morale et de l’interdit, une expérience vécue d’un bout à l’autre au travers du corps » dont elle devait rendre compte. Ce texte fait partie des « 25 livres féministes qu’il faut avoir lus » selon le journal Le Temps.
P.-S.
Le Monde a publié en avant-première (7/12/2022) le discours d’Annie Ernaux reçue à Stockholm le 10/12/2022. Le même jour, Pierre Assouline en a publié une critique dans sa République des livres. -
Radical
 « Giacometti fut radical parce qu’il sut rompre sans réserve avec ce que les artistes, au temps du surréalisme, se croyaient tenus de pratiquer. Il fut radical parce qu’il emprunta, sans l’approbation d’aucun maître mais avec le sentiment d’une impérieuse nécessité, un chemin solitaire et risqué, un chemin creusé d’ornières et qui ouvrait sur l’inconnu mais qui lui semblait, envers et contre tout, constituer le sien propre et le seul, un chemin dont personne au monde n’aurait su le détourner et dans lequel il pourrait jeter, il en avait la secrète intuition, toutes les forces qui bouillonnaient au fond de lui. Il fut radical parce qu’il refusa les tièdes compromis où d’autres s’égaraient et put brûler de sa passion hasta la muerte. »
« Giacometti fut radical parce qu’il sut rompre sans réserve avec ce que les artistes, au temps du surréalisme, se croyaient tenus de pratiquer. Il fut radical parce qu’il emprunta, sans l’approbation d’aucun maître mais avec le sentiment d’une impérieuse nécessité, un chemin solitaire et risqué, un chemin creusé d’ornières et qui ouvrait sur l’inconnu mais qui lui semblait, envers et contre tout, constituer le sien propre et le seul, un chemin dont personne au monde n’aurait su le détourner et dans lequel il pourrait jeter, il en avait la secrète intuition, toutes les forces qui bouillonnaient au fond de lui. Il fut radical parce qu’il refusa les tièdes compromis où d’autres s’égaraient et put brûler de sa passion hasta la muerte. »Lydie Salvayre, Marcher jusqu’au soir
© Alberto Giacometti, L’homme qui marche, 1960 (Photo Artslife)