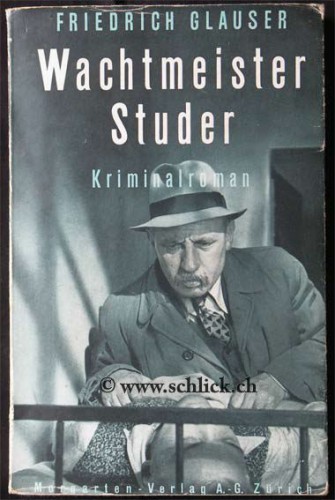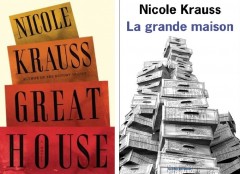Stabat Mater de Tiziano Scarpa (2008, traduit de l’italien par Dominique Vittoz) est un roman d’une étrange beauté, intense. « Madame Mère, au cœur de la nuit, je quitte mon lit pour venir, ici, vous écrire. » Une orpheline de l’Hospice de la Pietà à Venise, que l’angoisse tient éveillée, sait à présent lui tenir tête, elle écrit en secret sur de vieilles partitions à celle qui l’a abandonnée, dont elle ne sait rien.

L'enregistrement préféré de Tiziano Scarpa (Note de l'auteur)
Devant la masse obscure des eaux noires qui tentent de la submerger, elle tient : « Je suis encore quelque part, je suis là, étrangère à cette dévastation, l’angoisse ne me possède pas tout entière, il me reste un endroit où m’abriter et dire je. » Chaque nuit, elle quitte le dortoir et monte l’escalier, s’assied sur la plus haute marche, son « endroit secret ». Paragraphes de quelques lignes, parfois d’une page, quand elle dialogue avec la tête aux cheveux de serpents noirs, sa mort, qui lui tient compagnie.
Sa mère se souvient-elle encore d’elle ? Cécilia se sent perdue, guettée par l’amertume. Elle décrit ce qu’elle vit et ce qu’elle imagine : il y a seize ans, une jeune fille honteuse de son secret, enceinte par amour ou par caprice, d’une violence peut-être ? C’est à quatre-cinq ans qu’elle a suivi une ombre jusqu’aux cabinets du rez-de-chaussée, qu’elle l’a écoutée gémir dans l’effort, qu’elle a entendu pleurer son « excrément » – avant de s’enfuir. Elle n’a jamais su qui c’était, ce qu’est devenu le nouveau-né, une des fillettes de l’hospice ? Mais alors, sa mère y est, y était peut-être aussi ?
Il y a des années, sœur Amelia, une jeune religieuse, était venue chercher leur camarade Anastasia : une dame avait à un bracelet la moitié d’une pièce de monnaie qui s’ajustait parfaitement à la moitié détenue par la religieuse, mère et fille s’étaient retrouvées, et la religieuse avait ensuite disparu, « réprimandée pour avoir permis ces retrouvailles en présence des petites pensionnaires ». Depuis, Cecilia rêve de ce tout recomposé, se demande si pour elle aussi, on a déposé un signe de reconnaissance.
Ce n’est qu’au tiers de Stabat Mater qu’apparaît la musique. Cecilia joue avec les autres instrumentistes ce qu’écrit le vieux don Giulio pour les messes et les concerts, une musique répétitive, « exténuée », « écrite pour des gens qui n’ont plus la force de rien ». Dans l’église carrée, sur les murs latéraux, deux grandes tribunes se font face, garnies d’une dentelle de métal doré à travers laquelle les musiciennes peuvent suivre les gestes des autres en face d’elles et le bras du vieux prêtre, mais qui ne laisse voir aux gens assis en bas que des silhouettes. Un jour, Cecilia n’en peut plus et fait crier sur son violon une méchante note – tout s’interrompt. On l’emmène, elle perd connaissance. Sœur Teresa lui parle, l’incite à manger pour être plus solide.
Dès leur jeune âge, les orphelines sont exercées à chanter et à jouer d’un instrument. Celles qui n’ont ni voix ni dispositions auront d’autres tâches. Les plus douées apprennent le solfège, « l’harmonie de l’air et de l’encre ». Cecilia est chargée de la classe des cadettes, elle les incite, pour les éveiller, à imiter sur leur violon le cri des hirondelles.
Un soir, elle ne trouve plus ses feuilles. Quelques jours plus tard, sœur Teresa l’appelle et l’emmène en cachette jusqu’à un placard dont elle sort son dossier. Dedans, peu de chose, mais assez pour nourrir de nouveaux envols imaginaires. C’est alors qu’apparaît le nouveau maître de violon, un jeune prêtre aux cheveux roux, et cette fois « la musique de don Antonio remplit nos yeux, pénètre nos têtes, anime nos bras. » La vie de Cecilia prend un nouveau sens. Stabat Mater (prix Strega 2009) est l’hommage de Tiziano Scarpa à son compositeur favori, Antonio Vivaldi.

Textes & prétextes, cinq ans