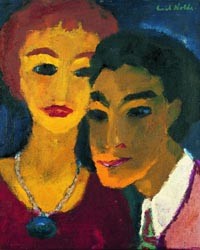A Bruxelles, le Mont des Arts relie le quartier de la Grand-Place à la Place Royale, le « bas » et le « haut » de la ville (comme on dit chez nous), un axe fort fréquenté, notamment par les touristes et par les visiteurs des musées (Musées Royaux des Beaux-Arts et MIM, entre autres). Rue en pente ou escaliers, vous avez le choix.
Bordée par la Bibliothèque royale de Belgique, cette terrasse urbaine s’est dotée en 2009 vers le haut d’un nouvel accès au Palais des Congrès sous la forme d’un grand cube de verre baptisé le Square (anglicisme destiné au public international et qui évite l’indispensable traduction dans une capitale bilingue). Certains se souviennent de l’époque où ce Palais des Congrès accueillait le Festival du cinéma de Bruxelles ou sa Foire du Livre, autant d’occasions d’admirer à l'intérieur la grande fresque de Delvaux ou encore celle de Magritte.
Samedi d’août ensoleillé, j’en profite pour prendre quelques photos, en commençant par les troncs d’arbres couchés çà et là depuis le début du mois, une installation éphémère pour promouvoir le Mont des Arts. Aux uns, ces grumes servent de banc, aux autres de support pour un cliché souvenir sous la statue de la reine Elisabeth (place de l’Albertine) en face de la statue équestre du roi Albert Ier. Les jardins, conçus comme un « tremplin visuel » par le paysagiste René Pechère, ont été replantés, les parterres fleuris protégés par de basses haies de buis, entre deux allées de platanes.
De nouvelles sculptures font le bonheur des passants, comme ce grand Loup de pierre bleue (Albert Aebly) dont les enfants raffolent – les parents n’hésitent pas à les installer dessus à califourchon, le temps d’une photo – ou, près du Square, un joyeux trio d’enfants accompagnés d’un chevreau, un beau bronze d’Eugène Canneel.
Sous les arcades qui longent la rue, le café-brasserie ne désemplit pas, et cela semble aussi le cas du restaurant voisin avec sa grande terrasse avec vue sur les jardins. Il ne manque plus que quelques occupants aux vitrines du bas pour compléter cette rénovation.
Si vous descendez le Mont des Arts, vous n’y passez pas, si l’heure est près de changer, sans guetter le carillon de l’horloge aux rayons de soleil : un petit personnage en bronze (ce jacquemart est un « bourgeois de Bruxelles ») juché tout en haut de l’arcade sonne les heures. Les personnages des douze niches s’y animent au son du carillon, pour le plaisir des flâneurs.
C’est un des agréments de la vie en ville, quand on a le temps de s’y promener le nez en l’air : quelque chose est là depuis toujours, depuis longtemps, disons, et vous ne l’avez jamais vu : pour moi, ce furent les imposantes portes de bronze du bâtiment Dynastie qui jouxte l’horloge. Entre les deux grands personnages en bas relief porteurs l’un, de tables de la loi (la Constitution ?), l’autre, d’une couronne royale, figure notre devise nationale belge : « Eendracht maakt macht – L’union fait la force ». Faisons un voeu...