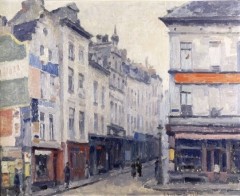Le 8 juillet 2010 restera dans la mémoire des 35.861 spectateurs présents au stade Roi Baudouin pour avoir battu le record de la plus nombreuse assistance d’un match de tennis. Le record précédent datait du 20 septembre 1973, quand Billie Jean King, grande figure et promotrice du tennis féminin, a battu l’Américain Bobby Riggs lors de la fameuse « Bataille des sexes ». L’affiche de « Best of Belgium » était alléchante : Justine Henin – Kim Clijsters.
Quoi de mieux pour les amateurs de tennis que d’applaudir nos deux meilleures joueuses belges à Bruxelles ? C’était avant qu’on n’apprenne la défection de Justine, blessée au coude lors du tournoi de Wimbledon. Mais les organisateurs lui ont trouvé une remplaçante, l’actuelle n° 1 du tennis féminin, Serena Williams elle-même, quitte à rebaptiser la partie « Best of the world ». De quoi fêter la présidence belge de l’Union européenne (et oublier un peu l’imbroglio politique dans notre pays).
J’ai eu le plaisir de vivre cette soirée spéciale dans notre stade national (encore merci à la société Groen Service qui m’a accueillie dans l’espace V.I.P. et à B.), une première pour moi qui n’avais jamais assisté à un match de tennis entre joueuses de ce niveau ni goûté aux savoureuses attentions d’un accueil si soigné. Au Heysel régnait une atmosphère bon enfant. Chaleur de juillet, temps des vacances, tenues estivales – le temps superbe a fait le bonheur des vendeurs d’eau en bouteille, de bière et de crèmes glacées, mais pas seulement, les frites aussi avaient leurs amateurs (réputation oblige). Distribution d’applaudisseurs gonflables et de jumelles en carton, musique d’ambiance, concert avant et après le match : sur le podium, une belle brochette d’artistes belges dont Maurane, Clouseau, Toots Thielemans.
A cette fête sportive, un match d’exhibition sans réel enjeu, on a vu défiler d’abord sur la piste, à bord de voitures MGB, des vedettes du sport belge, très applaudies, puis Kim et Justine ensemble, et enfin l’Américaine, apparemment ravie de participer à cette soirée. De grands écrans dans les quatre angles du stade permettaient de mieux les voir.
Que dire du match ? C’était très sympathique de le voir arbitrer par Martina Navratilova – « la plus grande joueuse de simple, double et double mixte qui ait jamais vécu » selon Billie Jean King. Pour l’occasion, la partie se déroulait sans avantages : à 40/40, celle qui gagnait le point suivant emportait le jeu. Il est certain qu’un affrontement entre Kim et Justine aurait présenté plus d’intérêt.
Sans surprise, Kim a pris le dessus dès la première manche pour s’imposer sur le score final de 6-3, 6-2. Quelques beaux services, plusieurs longs échanges, de quoi admirer la vitesse dont sont capables ces joueuses, d’apprécier des balles qui fusent ou suivre celles qui s’égarent, comme cette balle envoyée par Serena dans la toiture amovible disposée au-dessus du terrain (pour garantir la tenue du match quels que soient les caprices de la météo), un dispositif qui permettait aussi de jouer avec les éclairages pendant les pauses. A l’applaudimètre, la palme est sans doute revenue à la petite fille de Kim qui déclenchait des réactions enthousiastes à chaque apparition sur les écrans.
En attendant le feu d’artifice qui clôturait cette soirée festive sans véritable compétition, les spectateurs ont allumé les petites lampes nichées à l’intérieur des applaudisseurs, du plus bel effet à la nuit tombée, puis se sont amusés à les lancer sur la piste d’athlétisme bientôt jonchée de lucioles vertes – du travail supplémentaire pour les services de la Ville de Bruxelles. La princesse Mathilde et le prince Philippe ont été chaleureusement applaudis, Yves Leterme, le premier ministre « en exercice », hué – comme on pouvait s’y attendre.
Justine a défendu au micro la cause de la Belgique et des Pays-Bas candidats ensemble pour la Coupe du Monde de football en 2018. Vers minuit, la foule s’est dispersée dans la bonne humeur au pied des boules illuminées de l’Atomium, tout le monde semblait content d’avoir participé à cet événement populaire à l’organisation impeccable et sans anicroche. Bien sûr, on espère revoir bientôt un vrai match Henin – Clijsters.