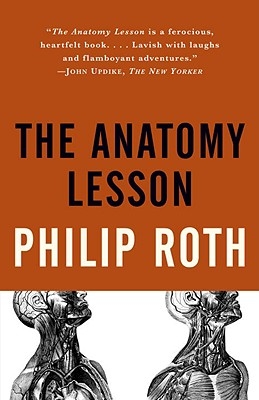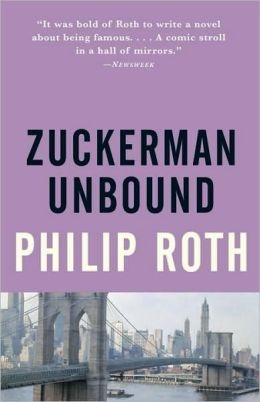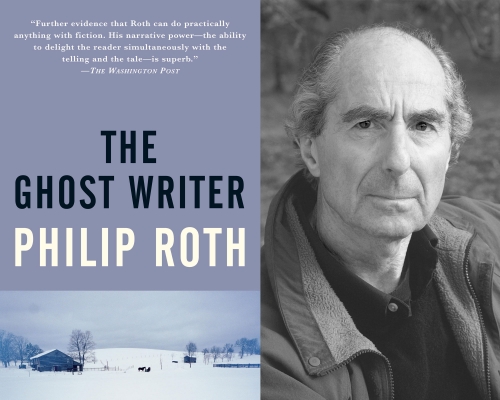L’incipit de La leçon d’anatomie (1985) ne manque pas d’ironie, provocatrice comme toujours chez Philip Roth qui revient pour la troisième fois à son alter ego Nathan Zuckerman. Lisez plutôt : « L’homme malade a besoin de sa mère ; si elle n’est pas là, d’autres femmes peuvent faire l’affaire. Quatre autres femmes faisaient l’affaire pour Zuckerman. Il n’avait jamais eu tant de femmes à la fois, ni tant de médecins, ni d’ailleurs bu tant de vodka, abattu si peu de travail, ou connu un désespoir de proportions aussi cruelles. »
L’écrivain scandaleux n’est plus que douleur. Marcher, porter un sac, ouvrir une fenêtre, tout lui demande un terrible effort. Pour lire dans un fauteuil, il porte un col orthopédique censé maintenir l’alignement de ses vertèbres cervicales, ce qui le soulage parfois et l’horripile souvent. Il n’arrive quasi plus à écrire, ni sur la nouvelle machine à écrire électrique qu’on lui a conseillée à la place de sa petite Olivetti ni à la main.
Quand il n’en peut plus, il s’installe sur un moelleux tapis de jeu pour enfants, étendu de tout son long sur le sol de son studio, avec la tête sur le Roget’s Thesaurus. Là, il donne ses coups de téléphone, suit l’affaire du Watergate à la télévision, reçoit ses visiteurs et les quatre femmes qui se relaient pour lui servir de « secrétaire-confidente-cuisinière-maîtresse de maison-compagne ». Le mariage était un « rempart », mais il a eu « trop d’épouses en trop peu d’années ».
Ostéopathie, psychanalyse, acupuncture, physiothérapie, Zuckerman a essayé tous les traitements pour sortir de la douleur chronique. Sa souffrance n’est pas si terrible « au regard de toutes les misères du monde », mais il se sent vaincu, à quarante ans, par « une maladie fantôme sans cause, sans nom et intraitable. » Serait-ce, avec la chute de ses cheveux, une punition « pour le portrait d’une famille que tout le pays avait pris pour la sienne, pour le manque de goût qui avait outragé des millions de lecteurs, pour l’impudeur qui avait mis en rage sa propre tribu » ? La douleur lui signifie-t-elle d’abandonner à d’autres l’écriture littéraire et de renoncer à vivre en chambre ?
Réduit au chômage, « Zuckerman avait perdu son sujet ». Les pensées déprimantes l’envahissent. Depuis trois ans, sa mère « n’est plus », selon la formule de son frère. « Ayant perdu père, mère, et terre natale, il cessait d’être un romancier. Cessant d’être un fils, il cessait d’être écrivain. » Il se souvient du temps passé dans son appartement après sa mort et des choses qui lui parlaient d’elle, du long discours écrit par son frère en une nuit « dans sa chambre d’hôtel avec trois jeunes enfants et une épouse » alors que lui « n’arrivait pas à écrire quand il y avait un chat dans la pièce. »
« Des trésors de colère refoulée », voilà l’origine du mal d’après le jeune Dr. Felt, qui lui conseille d’ouvrir le feu contre Milton Appel. Après l’avoir considéré comme un jeune prodige, cet Appel, auteur d’une anthologie yiddish, avait revu son jugement après la parution de Carnovsky : « Sans être probablement lui-même totalement antisémite, Zuckerman n’était certainement pas l’ami des juifs : l’affreux animus de Carnovsky suffisait à le prouver. »
Jenny, Diana, Gloria, Jaga : on découvre peu à peu les femmes qui se succèdent auprès de Nathan Zuckerman et de quelle manière elles s’occupent de lui. Aucune ne pourra le dissuader de suivre l’idée de génie qui lui vient de s’inscrire à l’université, pour devenir médecin, renonçant à la littérature. D’où un voyage en avion mémorable et de non moins mémorables leçons d’anatomie.
Ce roman de Philip Roth consacré à la douleur physique et à la solitude, à l’impossibilité d’écrire et de vivre sans écrire, à la présence des femmes et au sexe, à la famille et aux juifs de Newark où il a grandi, ces obsessions qui reviennent d’une œuvre à l’autre, continue à explorer avec cet humour singulier qui est le sien, mêlé de chagrin, de colère et de désir, la condition humaine de l’écrivain Zuckerman, qui n’en est pas moins homme.