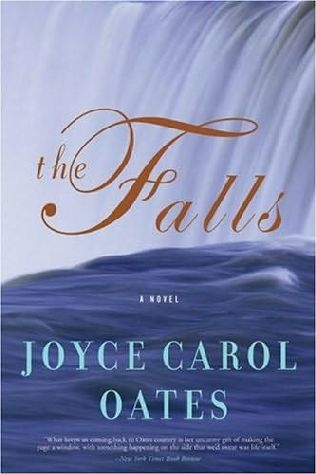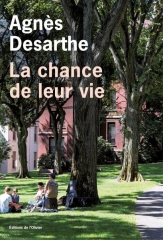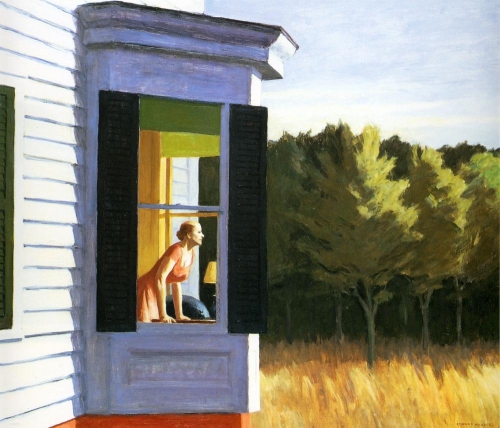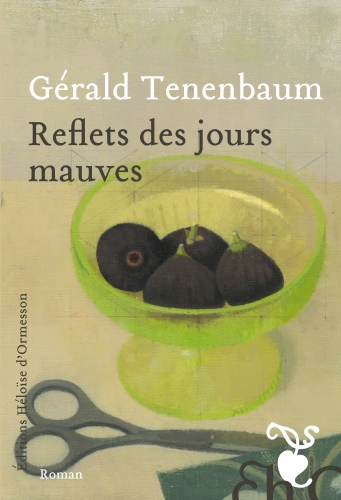Les Chutes de Joyce Carol Oates (2004, traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Claude Seban) s’ouvrent sur une scène dramatique, racontée par le gardien du pont suspendu de Goat Island : le 12 juin 1950, il a tenté d’arrêter un homme au visage « à la fois vieux et jeune » qui s’est jeté dans les eaux bouillonnantes de Niagara Falls.
Comme beaucoup de jeunes mariés, Ariah Littrell et Gilbert Erskine ont passé leur nuit de noces dans un hôtel près des chutes du Niagara. Stupéfaite de se réveiller seule dans la suite nuptiale, Ariah, vingt-neuf ans, y découvre un mot d’adieu dont elle ne dit mot quand la police vient lui annoncer qu’un homme ressemblant à son époux a « disparu sans laisser de traces ». Déjà veuve ? Elle ne peut y croire.
Gilbert, vingt-sept ans, pasteur presbytérien comme son père, s’intéressait aux fossiles et avait choisi l’endroit de leur voyage de noces. Leur première nuit s’est mal passée. Chez sa femme rousse aux yeux vert galet, pianiste et chanteuse, professeur de musique, il avait cru trouver une sœur, quelqu’un qui lui ressemblait. Leurs parents avaient voulu ce mariage, plus qu’eux.
Alors commence la légende de la Veuve blanche des Chutes, cette rousse égarée qui a hanté les lieux pendant sept jours, tant que le cadavre n’avait pas été retrouvé. « Damnée », voilà ce que croit être l’éphémère Madame Erskine, dans la douleur et l’humiliation. Quand Colborne, le propriétaire de l’hôtel, y revient après une nuit de poker sur le yacht de son ami Dirk Burnaby, il l’accompagne au commissariat. Ariah n’admet pas le suicide. Colborne fait alors appel à son ami pour qu’il le conseille sur la marche à suivre.
Dirk Burnaby, trente-trois ans, avocat brillant et célibataire séduisant, connaît bien les chutes. Son grand-père funambule, après plusieurs traversées spectaculaires au-dessus des eaux, a fini par y tomber. Ariah l’impressionne dès leur première rencontre par son souci de rester digne, son regard intense et son obstination. « Pourquoi me suis-je intéressé à cette femme ? Elle est folle. » Dirk s’étonne qu’elle refuse d’appeler ses parents et ses beaux-parents. Quand il les rencontrera, il comprendra à leurs réactions égoïstes pourquoi elle les évite. Le corps du mari est repêché après sept jours.
Claudine Burnaby, la mère de Dirk, veuve obsédée par la perte de sa beauté depuis la cinquantaine, vit de plus en plus recluse. Elle ne s’occupe guère de ses deux filles, Dirk a toujours eu sa préférence, « un beau garçon vigoureux au caractère agréable ». Quand il lui annonce qu’il va peut-être se marier avec cette fille de pasteur pas du tout de leur milieu, elle n’y croit pas. Mais Burnaby se rend chez Ariah et la demande en mariage, l’embrasse. « Elle dirait oui. Oui avec son petit corps ardent de chat maigre épousant celui de l’homme. (…) Oui à l’homme qui lui faisait si agréablement l’amour, comblant son corps qui était à la fois petit et infini, inépuisable. »
Ils se marient fin juillet, à l’étonnement de tous. En plus de leur entente sexuelle, « chacun devint le meilleur ami de l’autre ». Dirk a installé un Steinway pour Ariah dans son appartement. Il a refusé d’aller vivre en couple dans la grande maison de sa mère qui menace de le déshériter, refuse de rencontrer son épouse. Dans leur milieu, les femmes ne travaillent pas ; Ariah donne des cours de piano, bien que son mari gagne très bien sa vie.
Quand naît Chandler, leur fils aîné, en qui Ariah craint de voir le fruit de sa seule nuit avec Erskine, malgré les dénégations du gynécologue, elle se jure d’abord de ne pas avoir d’autre enfant. Dans la crainte de voir à nouveau disparaître son époux, elle changera d’avis. Et elle est heureuse de prendre soin de sa famille. Le bonheur semble au rendez-vous.
Joyce Carol Oates creuse pourtant les failles, les angoisses, la hantise de la perte (Ariah cache son passé à ses enfants), les tiraillements entre Dirk et sa mère. Une « femme en noir » se met à harceler les avocats, elle veut dénoncer la pollution chimique qui pourrit la vie dans un nouveau lotissement du côté de Love Canal. La bonne société ferme les yeux sur les activités des entreprises fautives. Dirk Burnaby aussi refuse de la recevoir. Mais un jour de grosse pluie, il invite une femme et une fillette à monter dans sa voiture sans savoir que c’est elle et il découvre où elle vit avec ses enfants. Il la défendra.
Le roman de Joyce Carol Oates (Prix Femina étranger en 2005) donne le vertige ; aux troubles personnels s’ajoutent les drames sociaux : inégalités, exploitation, profit, injustice, misère, déchéance… Le personnage d’Ariah déroute et fascine, celui de Burnaby aussi. Leur famille sera-t-elle à son tour maudite ? Lire Les Chutes est une plongée dans la face sombre de l’Amérique, où la lumière a bien du mal à se frayer un passage. Un drame passionnant et un suspense de bout en bout.