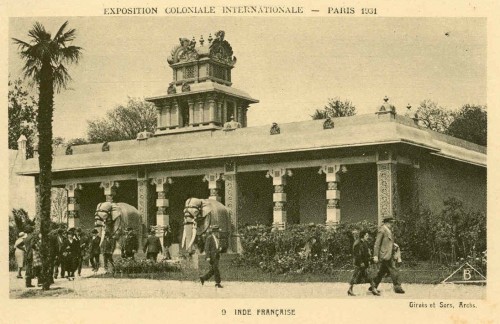Je lis rarement des romans policiers mais le titre de cette enquête de l’inspecteur Chen, La danseuse de Mao (The Mao Case, 2007), a retenu mon attention. Qiu Xialong situe son histoire à Shanghai, où il est né en 1953 et où sa famille a souffert de la Révolution culturelle. Etudiant aux Etats-Unis à l’époque des événements de Tian’anmen, il a choisi d’y rester et d’écrire en langue anglaise.
A la « réunion d’études politiques du comité du Parti » sur « l’urgence de bâtir la civilisation spirituelle en Chine », Chen Cao n’a pas fort envie d’intervenir. Mais un inspecteur principal et un « cadre du Parti en pleine ascension » – Chen, poète reconnu, a étudié l’anglais à l’université – se doit de trouver quelque chose à dire,. Au moment où il se décide, un coup de téléphone l’oblige à sortir : une amie de Ling, son ex-petite amie, lui apprend que celle-ci s’est mariée avec un homme d’affaires en vue, un ECS comme elle (enfant de cadre supérieur).
Qipao, robe traditionnelle chinoise
Mais c’est un autre appel de Pékin qui déclenche la nouvelle mission de Chen : le ministre Huang l’entretient de Shang, actrice devenue célèbre pour avoir dansé avec le président Mao, qui a fini par se suicider. Elle pourrait avoir transmis quelque chose à sa fille Qian, puis celle-ci à sa propre fille, la jeune Jiao. En effet, celle-ci vit depuis un an dans un appartement luxueux des beaux quartiers de Shanghai, une fortune récente qui paraît suspecte. Chen, tenu au secret – tout ce qui concerne Mao reste un sujet très délicat en Chine –, est invité à l’approcher sous le masque de l’écrivain, la Sécurité intérieure n’ayant rien trouvé jusqu’ici. Voilà donc l’inspecteur mis « en congé » pour enquêter secrètement au manoir Xie, où Jiao prend des cours de peinture auprès d’un vieil héritier d’un capitaliste « noir ». Pour se lancer dans cette « affaire Mao », comme il l’appelle déjà intérieurement, Chen se procure Nuages et pluie à Shanghai, un best-seller sur la vie de Qian.
Un ami l’introduit auprès de Xie sous le prétexte d’un livre à écrire sur le vieux Shanghai : on dit que le manoir a échappé aux destructions grâce à la liaison de l’ex-épouse de Xie avec un commandant des Gardes rouges. A part les jeunes filles du cours de peinture, ce sont surtout des « Vieilles Lunes » qui fréquentent les réceptions de Xie. On y joue des airs des années trente, tout évoque la nostalgie du passé. Dans l’atelier où Chen s’est glissé à l’écart des danseurs, Jiao vient le rejoindre et ils font connaissance. A première vue, elle ne semble pas une fille entretenue.
Pour ses recherches, Chen s’adresse à un policier retraité, Vieux Chasseur, qu’il invite dans une maison de thé à la mode. « Beaucoup de choses, passées et présentes, sont racontées par d’autres comme des histoires autour d’une tasse de thé » dit La Chronique des trois Royaumes. Son interlocuteur devine rapidement où Chen veut en venir avec ses questions sur l’époque de la Révolution culturelle. La conversation tourne bientôt sur les épouses successives de Mao, « jetées » l’une après l’autre par cet homme « au cœur de serpent et d’araignée ». Vieux Chasseur promet de l’aider. De visite en visite, Chen constate que le propriétaire du manoir ne roule pas sur l’or, malgré son train de vie. Un promoteur lui a fait une offre pour détruire sa maison et bâtir des appartements de luxe, Xie l’a repoussée, mais il sait l’acheteur puissant, avec des relations et « des moyens noirs et blancs ». Une piste à suivre. Chen propose alors son appui à Xie – il connaît quelqu’un au gouvernement de Shanghai. Puis il invite Jiao à dîner.
L’autre piste de Chen est inattendue. Il décide de relire les poèmes de Mao dans la perspective de la critique littéraire traditionnelle, appelée « suoying », c’est-à-dire « la recherche du véritable sens d’une œuvre dans la vie de l’auteur ». Des poèmes officiellement « révolutionnaires » peuvent avoir un lien avec une rencontre, un moment vécu. C’est ce que lui confirme un spécialiste de la poésie de Mao, d’abord peu disert, mais que Chen inquiète à propos de la réforme du « système des écrivains professionnels » en faisant miroiter l’intérêt pour lui d’une nouvelle publication sur Mao, pour laquelle ils collaboreraient. Ainsi Chen finit par apprendre que c’est bien Shang qui a inspiré « La milicienne » et aussi l’ « Ode à une fleur de prunier » et même que quelqu’un aurait vu chez elle un rouleau calligraphié par Mao. Une information utile.
En plus du suspense de l’enquête proprement dite, compliquée par plusieurs meurtres, La danseuse de Mao intéresse par son contexte, celui de la Chine actuelle où le fossé entre riches et pauvres s’accentue, où les villes changent de visage, où les conversations restent très prudentes. Si le sujet « Mao » est assez tabou, en revanche « Mao était devenu une marque commerciale pleinement intégrée dans l’ère de la consommation, avec les restaurants Mao, les antiquités Mao ; on collectionnait les badges Mao et les timbres à son effigie. » Chen, grâce à l’intervention de Ling, son amie revue à Pékin, y visite l’ancienne résidence de Mao interdite au public.
Imprégnés de culture chinoise, les dictons savoureux, les vers et les citations abondent, tirées notamment du Rêve dans le pavillon rouge. Chen a hérité sans aucun doute des goûts littéraires de son créateur. Les scènes de repas, formidables, décrivent les préférences culinaires des uns et des autres, d’un festin de crabes impromptu à l’incroyable banquet « impérial » au restaurant chic Fanshang, situé au dernier étage du « Moon on the Bund ». Avec cet inspecteur principal, nous découvrons dans La danseuse de Mao les protagonistes d’une sombre affaire mêlant le présent et le passé et en plus, une atmosphère riche et subtile, qui nous conduira peut-être à lire ses autres enquêtes, en commençant par la première, Mort d’une héroïne rouge (2000).