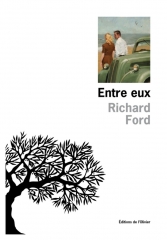Par hasard, après la quête d’un père, voici celle d’une mère, dans Dix-sept ans, le dernier roman d’Eric Fottorino. Un dimanche de décembre, une mère invite ses trois fils à déjeuner avec leurs familles. Après le repas, Lina veut parler à « ses garçons », à eux seuls. Nervosité, inquiétude, et puis une révélation inattendue : en 1963, elle a mis au monde une petite fille qu’on lui a enlevée aussitôt.

Bonnard, Jeune femme à table, 1925
Deux ans après Moshé, le « père juif de Fès » d’Eric, le fils aîné, Lina s’est retrouvée enceinte pour la deuxième fois, d’un autre Marocain, et cette fois sa mère furieuse, bigote, lui a fait signer immédiatement une promesse d’abandon – « Pour votre grand-mère, j’étais une Marie-couche-toi-là ». Elle l’a éloignée en louant un studio à Bordeaux pour sa fille et son petit-fils, sous la garde de Paul, oncle et parrain d’Eric.
Troublé par cet aveu, Eric, 47 ans, n’en peut plus d’essayer de recoller ses souvenirs. L’absence de son père biologique, il l’a heureusement acceptée grâce à son père adoptif, Michel Signorelli, pied-noir de Tunis, qui lui a donné son nom quand il avait dix ans en épousant sa mère (cf. L’homme qui m’aimait tout bas), puis en lui donnant deux petits frères, François et Jean. Mais après le récit de sa mère, il se sent incapable de lui dire quoi que ce soit, « impuissant à l’aider ».
Rentré chez lui, il donne ses cours machinalement à la fac, garde le silence à la maison, finit par décider de partir seul quelques jours à Nice, où il est né. « En réalité, je n’avais jamais accordé à Lina l’importance qu’elle méritait. A-t-on déjà entendu dire : ma mère, ce héros ? Que pèse une maman de rien du tout face à l’aura de deux pères ? »
De sa naissance sans père, ils s’en sont sortis vivants, sa mère et lui – « Vivants, pas indemnes. Dans mon cœur, une statue de pierre est toujours debout, raide et menaçante. » A Nice, il arpente les rues en quête de signes, cherche où il est né, se remplit « de soleil tiède », imagine Lina sur la Promenade des Anglais avant que sa mère l’emmène dans le village d’Ascros, chez des inconnus qui la cacheront jusqu’à l’accouchement, en août 1960.
Au restaurant où il prend ses habitudes, il fait la connaissance de Novac, un pédopsychiatre appelé en renfort après l’attentat de Nice ; il l’écoute parler des enfants traumatisés, qui revivent sans cesse les scènes d’horreur. Durant ses promenades, il imagine comment sa mère se sentait, à Nice, imagine son regard sur ce qu’il regarde lui, à présent. Il voudrait lui téléphoner, lui en parler, mais ils n’arrivent jamais à se parler par téléphone. Ni autrement.
La veille de l’an 2000, Lina lui avait annoncé joyeusement qu’elle s’installait à Nice, seule. Eric se reproche de n’y être jamais allé la voir, malgré ses demandes répétées. Les souvenirs se bousculent dans sa tête, en désordre. C’est Novac qui le met sur la voie en lui parlant de la femme au regard perçant qu’ils ont remarquée au restaurant et dont le fils aux traits asiatiques ne cesse de lancer un boomerang sur la plage. Elle tient une brocante dans une impasse, véritable « palais de curiosités ». Eric s’y rend, intrigué, et est surpris d’y reconnaître des œuvres de Lina, qui crée des sculptures à partir de bois flottés.
Betty Legrand, la chorégraphe devenue brocanteuse, a bien connu sa mère et elle l’a tout de suite reconnu, lui : Lina et elle partageaient la même chambre à la maternité, elles sont toujours restées en contact. « Jusqu’ici, ma mère était restée un être irréel et diaphane. » Et voilà quelqu’un, enfin, qui lui raconte ses débuts dans la vie, noyés dans l’oubli. Betty lui parle de Moshé, du père de son fils, un danseur vietnamien venu une saison à l’Opéra de Nice, reparti à Saïgon sans se savoir père. « Des lambeaux de nos vies m’étaient rendus. »
Dix-sept ans, c’était l’âge de sa mère quand il est né. Elle voulait l’appeler Arthur, sa grand-mère a choisi Eric. Grâce à Betty, il comprend peu à peu d’où il vient, pourquoi il n’a aucun souvenir de sa petite enfance auprès d’une mère aimante, pourquoi sa grand-mère a pris toute la place dans son cœur. Après ce séjour à Nice sur ses traces, il va, enfin, pouvoir parler avec Lina ou du moins écouter ce qu’elle n’avait jamais réussi à lui dire.
Bien que sous-titré « roman », Dix-sept ans d’Eric Fottorino est une recherche très intime, au croisement des faits et des sentiments : « Je suis devenu écrivain parce que je ne savais pas qui j’étais » reconnaît-il dans un entretien. Dans cette fiction, le narrateur, Eric Signorelli, ne masque ni ses manques, ni sa fragilité : un roman bourré de nostalgie, émouvant par son obstination à lever les secrets, à comprendre et à mettre des mots sur sa vie à elle, sa vie à lui.
 « J’essayais de recoller nos vies. Jusqu’ici à ce jeu-là, je m’étais toujours blessé. Ou découragé. Comme dans un puzzle où il aurait sans cesse manqué une pièce majeure permettant de lire l’image complète, et de la comprendre. Tu en avais assez, petite maman, de garder ce secret pour toi. Un jour, à soixante-dix ans passés, tu as pris rendez-vous avec une ancienne sage-femme devenue psychologue. « Elle fait naître ceux qui sont déjà nés », dis-tu doucement. Elle est partie à la recherche de tes peurs. Elle a ramené cette petite-fille. L’enfant que tu t’efforçais d’oublier. Peut-on oublier la chair de sa chair ? Avec ta mère ce fut une histoire sans paroles. Il ne s’était rien passé. »
« J’essayais de recoller nos vies. Jusqu’ici à ce jeu-là, je m’étais toujours blessé. Ou découragé. Comme dans un puzzle où il aurait sans cesse manqué une pièce majeure permettant de lire l’image complète, et de la comprendre. Tu en avais assez, petite maman, de garder ce secret pour toi. Un jour, à soixante-dix ans passés, tu as pris rendez-vous avec une ancienne sage-femme devenue psychologue. « Elle fait naître ceux qui sont déjà nés », dis-tu doucement. Elle est partie à la recherche de tes peurs. Elle a ramené cette petite-fille. L’enfant que tu t’efforçais d’oublier. Peut-on oublier la chair de sa chair ? Avec ta mère ce fut une histoire sans paroles. Il ne s’était rien passé. »