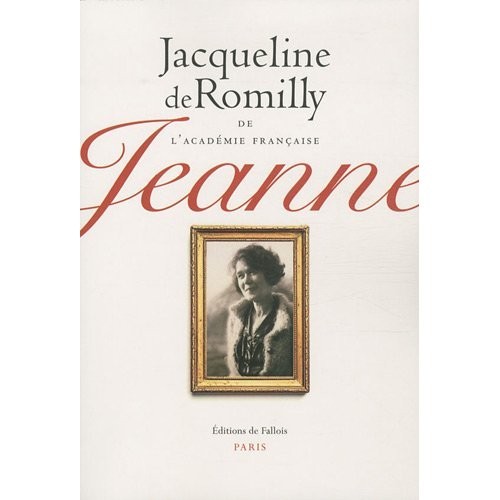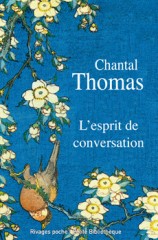Qui a croisé la route de Jacqueline de Romilly sait avoir rencontré une grande dame, remarquable helléniste, professeur inoubliable. Jeanne, le portrait de sa mère qu’elle a écrit en 1977, après sa mort, a été publié à titre posthume en 2011, selon sa volonté.
« Jeanne au bracelet d’argent », bracelet reçu à seize ans d’un oncle revenu d’Indochine, c’est le père d’une amie qui la surnomme ainsi. Jacqueline de Romilly le retient pour ce qu’il évoque de l’élégance de Jeanne, qui aimait se déguiser, rire, une femme pour qui « l’ironie a toujours été son arme, en même temps que son charme. » Qu’a ressenti sa mère, se demande-t-elle, à la mort de sa propre mère ? Elle se reproche de n’avoir pas été assez curieuse de la vie d’une femme qui mettait « son courage, qui était grand » à lui « éviter toute pensée triste ».
Jeune, Jeanne avait des amies avec qui converser, partager ses lectures, noter « de belles pensées » dans un carnet. Pour le plaisir, avec Marie Rod, dont le père, écrivain, recevait beaucoup et correspondait avec Zola, Rodin, Proust, Verhaeren…, elle assistait au cours de Bergson et c’est là qu’elle a fait la connaissance d’un philosophe brillant et musicien fervent, quelqu’un de gai, aux belles manières mais sans le sou, socialiste, juif. Jacqueline de Romilly a retrouvé les lettres « d’une époque révolue » – les fiançailles de ses parents avaient fait scandale des deux côtés.
« Joie de vivre pour un autre ». Mariée, Jeanne écrit des contes pour gagner un peu d’argent, puis c’est la naissance de Jacqueline, leur Jacquinot, leur « grenouille », un « gros bébé heureux ». Sa mère n’aime pas les gens « comme il faut » ni faire « comme tout le monde ». Son mari part à la guerre de 1914, il est tué le soir même dans la Somme, le frère de Jeanne quelques mois après. Sa mère fait tout pour préserver Jacqueline de la tristesse et met tout son art à élever son enfant sans souci visible.
A Paris, dans une rue tranquille du XVIe, Jeanne leur trouve un appartement « selon son cœur », à la fois sage et original, bourgeois et fantaisiste. Des fenêtres « en plein midi », une vue sur des jardins et un acacia. Elle en arrange les pièces « pour le loisir et l’élégance », sans salle à manger, une table roulante faisant l’affaire pour leurs repas à deux. Dans la chambre de sa fille, rose et verte, elle place un tapis ancien en soie « du bon rose », lui confère comme à leur séjour « un charme incroyable ». Ingénieuse, sa mère aménage tout cela sans argent, coud, peint, garnit elle-même des sièges.
Jeanne travaille huit heures par jour, du secrétariat, puis écrit un premier roman, La victoire des dieux lares (Grasset, 1923). « Femme de lettres », elle a besoin de reconnaissance, mais reste fière, conjugue liberté de l’artiste et vertus : sagesse, droiture, honnêteté. Sa famille la juge trop libre, alors qu’aujourd’hui elle paraîtrait trop bourgeoise. Lorsqu’elle entame une liaison véritable, dix ans après la mort de son mari, l’homme qu’elle aime est tué à la chasse.
Jacqueline de Romilly raconte la passion de sa mère pour le théâtre, où elle a connu quelques succès sans lendemain. Elle avait beaucoup d’attaches dans ce milieu et sera déçue de ne pas voir monter ses pièces, qui passeront pour la plupart à la radio. En même temps, elle s’occupe bien de sa fille, lui achète un collier en or aux perles pleines, plus beau encore que celui, admiré, d’une petite amie riche. « Telle était, pour Jeanne, la joie de la richesse : pouvoir me donner tout ce dont j’avais un instant envie. » Avec des amis, elles voyagent, mènent une vie variée et chaleureuse. Puis Jeanne rencontre Bob qui devient son ami permanent, « officiel ».
Jacqueline connaît une adolescence aisée et brillante, grâce à sa mère très active, qui en plus d’écrire devient journaliste à la Chambre des Députés, se forme à la reliure, coud, crochète, toujours avec le goût du travail bien fait. Toutes ces occupations ne l’empêchent pas d’être gaie – « Je recevais tout. Je ne m’en étonnais pas. » Excellente élève, Jacqueline réussit bien à l’Ecole normale, se passionne pour Thucydide (dans une belle édition en sept volumes que sa mère lui a achetée chez un bouquiniste). Jeanne signe alors de son double nom, Jeanne Maxime-David, Amélie, une œuvre encensée par la critique.
C’est à cette époque qu’elle se lie avec un musicien célèbre, mari depuis peu d’une amie d’enfance, futur grand chef d’orchestre et idole de Paris, qui lui écrit de très belles lettres et qu’elles appellent le brigand : « le brigand changea nos vies ». Il leur apporte « lumière et spontanéité », Jeanne l’aide pour son courrier, puis Jacqueline aussi. Dans ses papiers, sa mère a mis à part un paquet : « A garder : Clinou et le Brigand ».
La deuxième guerre mondiale vient tout bouleverser. Jacqueline est nommée professeur à Bordeaux, emmène sa mère avec elle, les rôles s’inversent. Elle se marie avec un homme d’une grande famille, avec terres et maisons. Sa belle-famille ne s’intéresse guère à Jeanne. Il leur faut déménager à Toulouse, puis à Aix-en-Provence, et se débrouiller avec le statut des juifs : son mari l’est aux trois quarts, Jacqueline le devient par son mariage. Pas de retour possible à Paris, elle perd son poste.
Et pourtant sa mère prend ces années d’exil, de guerre et de peur avec allant, écrit, noue des amitiés nouvelles. Jacqueline en garde l’image d’une Jeanne encore jeune, heureuse. Le retour à Paris en octobre 1944 change la donne, les sépare. La fille de Jeanne enseigne, accompagne son mari éditeur en week-end, voyage. L’époque, les goûts ont changé, Jeanne n’arrive plus à faire accepter ses textes, même si elle travaille dans un comité de lecture des manuscrits de pièces radiophoniques, alors elle les signe d’un pseudonyme, et ses pièces diverses, étonnantes de naturel, aux dialogues excellents, connaissent le succès.
« A force d’attendre et de se battre, on vieillit et la vie passe. » Jacqueline de Romilly rend hommage à l’énergie magnifique de sa mère, que des problèmes d’audition finissent par obliger à habiter chez sa fille. Elles ne savent pas encore que leur vie à deux, à cause de circonstances inattendues, reprendra un jour, dans un autre appartement. Avec pudeur, Jacqueline de Romilly rend compte des dernières années d’une vie. Jeanne retrace le destin d’une mère et dévoile, avec ses pleins et ses manques, l’amour d’une fille éperdue de reconnaissance. Jacqueline de Romilly s’y montre sans complaisance, dans le désordre de sa mémoire. Elle a reçu de Jeanne cette grande « élégance morale » qu’elle admirait tant, le courage, et aussi quelque chose qui ne définit pas aisément, un charme fou.