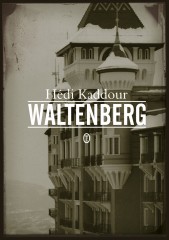Purge (Puhdistus, 2008, traduit du finnois par Sébastien Cagnoli) a déjà fait couler beaucoup d’encre. Sofi Oksanen, née en 1977 d’une mère estonienne et d’un père finlandais, a placé en tête de ce roman choc une carte de « L’Estonie dans l’Europe du Nord depuis 1991 » pour que ses lecteurs situent mieux les frontières de ce pays balte entré dans l’Union Européenne en 2004.

View of Emumägi from SW. Emumäe landscape protection area.
Picture taken at 58,9332N 28,3642E looking towards NE.
© Pimik (Wikimedia Commons)
Il s’ouvre sur un slogan – « Pour une Estonie libre ! » – que Hans Pekk, un paysan estonien, écrit au-dessus de chaque page de son cahier où il écrit « pour ne pas perdre la raison ». Mai 1949. Dans sa propre ferme, depuis la déportation de sa femme et de sa fille, Hans se terre dans un cagibi tandis qu’Aliide, sa belle-sœur, vaque aux travaux journaliers. 1992. Aliide Truu aperçoit quelque chose d’étrange par la fenêtre, comme « un ballot » au pied des bouleaux, et va voir cela de plus près, munie d’une fourche. Elle découvre une fille qui porte une robe de l’Ouest mais des pantoufles russes, et qui parle estonien. Celle-ci, en piteux état, finit par accepter de l’eau, de la valériane, du pain.
La jeune Zara n’en revient pas d’avoir trouvé Aliide Truu. Il faut que celle-ci comprenne au plus vite sa terreur : Pacha, son mari, et son associé, Lavrenti, sont à sa recherche. Elle prétend les avoir rencontrés au Canada où elle travaillait comme serveuse, cherche une histoire qui pousse Aliide à bien vouloir la garder chez elle. La vieille femme se méfie, soupçonne un traquenard.
Sofi Oksanen livre par fragments, dont elle précise chaque fois l’année et le lieu (le plus souvent, « Estonie occidentale ») mais en sautant constamment d’une époque à l’autre, l’histoire des deux personnages essentiels du récit. A l’insu de sa mère, qui avait fui les Allemands lors de la guerre et trouvé du travail en Russie, Zara a appris l’estonien avec sa grand-mère, Ingel. La jeune fille, originaire de Vladivostok, s’est laissé persuader par une amie, l’année précédente, de la suivre en Allemagne pour y travailler et mener une vie plus intéressante. Aliide laisse son canapé à la fugitive et dort dans la chambre de derrière où des herbes médicinales sèchent sur des journaux. Quand elle lui annonce, le lendemain matin, qu’elle attend sa fille qui vit en Finlande, Zara rêve qu’on la dépose en voiture à Tallinn, d’où elle passerait à l'étranger. Dans l’immédiat, elle s’efforce d’inspirer confiance.
On l’a deviné, Zara est une de ces filles de l’Est tombées dans le piège de la prostitution. Violentée, torturée, elle s’est retrouvée prisonnière de Pacha et Lavrenti, avec d’autres. Pourquoi, quand elle a saisi l’occasion d’échapper à ses proxénètes, a-t-elle cherché le village et la maison d’Aliide ? Pourquoi celle-ci affirme-t-elle à un ami, venu l’avertir d’un procès possible à l’encontre de son défunt mari, qu’ils n’ont fait « qu’obéir aux ordres » et qu’ils étaient « des gens bien », mais s’empresse-t-elle après de brûler toute la propagande communiste et les papiers compromettants qui restaient dans sa maison ? Pourquoi Zara cache-t-elle sur elle une photo d’Ingel et Aliide ? Pourquoi celle-ci nie-t-elle avoir une sœur ?
Des années de guerre où l’Estonie se voit occupée tantôt par les Russes, tantôt par les Allemands, et lutte pour sa liberté, aux années nonante pendant lesquelles se déroule la rencontre entre ces deux femmes secrètes, rusées, toutes deux mues par la peur, toutes deux capables du pire pour sauver leur peau, la romancière finlandaise fait monter la pression, rassemble les pièces d’un puzzle historico-romanesque. On y découvre un pays, ses paysans, ses patriotes, ses sbires, ses traîtres, et aussi une famille avec ses amours, ses drames, ses jalousies, ses rancœurs. « Ce qui m'attire avant tout, explique Sofi Oksanen, ce sont les destins bâillonnés, les personnages muets, les histoires tues. S'approcher du non-dit et tenter de l'articuler, n'est-ce pas l'essence même de l'écriture ? »
Purge contient une violence crue, omniprésente, insoutenable dans certaines scènes – le roman a d’abord été conçu comme une pièce de théâtre. Envahi soi-même par le malaise des personnages, on veut tout de même aller de l’avant, comprendre ce qui les a menés là où ils sont, savoir à quel jeu terrible s’adonnent la vieille Aliide et la jeune Zara, pour leur bonheur ou leur malheur.