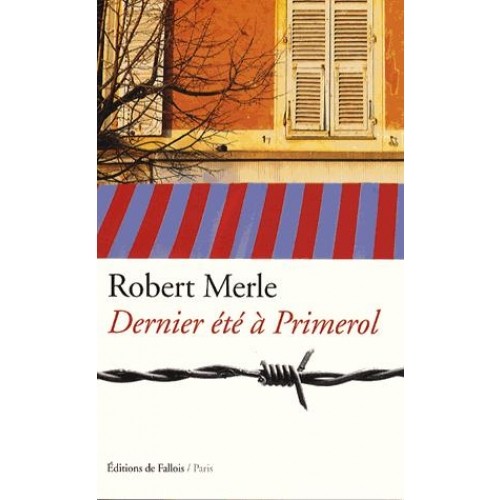Vous êtes nombreux à avoir lu Jérôme Ferrari avant son Goncourt pour Le Sermon sur la chute de Rome et j’ai donc ouvert Où j’ai laissé mon âme (primé en 2010) avec une grande curiosité. C’est un roman âpre sur la guerre, sujet l’année suivante d’un autre Goncourt, L’art français de la guerre d’Albert Jenni.
Arrestation de Larbi Ben M’Hidi (Alger, Algérie) 1957, qui a inspiré le personnage de Tahar (d'après la critique du Monde)
Le récit assez court, 150 pages, est à deux voix : celle du lieutenant Horace Andreani – « Je me souviens de vous, mon capitaine, je m’en souviens très bien, et je revois encore distinctement la nuit de désarroi et d’abandon tomber sur vos yeux quand je vous ai appris qu’il s’était pendu » (incipit) – et celle du narrateur qui raconte trois journées cruciales du capitaine André Degorce en mars 1957 à Alger (à la troisième personne, avec des fragments de monologue intérieur).
Entre eux deux, l’homme qui révèle la cassure entre deux conceptions de la guerre, ou du moins deux façons de traiter l’ennemi : Tahar, un colonel de l’ALN. Andreani n’en revient pas encore de l’aberrante exigence de Degorce quand celui-ci a reçu l’ordre de remettre l’homme entre ses mains : « vous avez fait sortir Tahar de sa cellule et vous lui avez rendu les honneurs, on l’a conduit vers moi devant une rangée de soldats français qui lui présentaient les armes, à lui, ce terroriste, ce fils de pute, sur votre ordre, et moi, mon capitaine, j’ai dû subir cette honte sans rien dire. »
La photo de Tarik Hadj Nacer – surnommé Tahar, « le pur » – trônait en haut de l’organigramme qui occupait tout un pan de mur du bureau où André Degorce avait pris ses fonctions deux mois plus tôt. Des dizaines de noms et de photos à marquer d’une croix rouge au fur et à mesure des arrestations, jusqu’à ce qu’il ne reste aucune case vide. L’officier français « a nourri des rêves de victoire, sans connaître autre chose qu’une longue suite de défaites (…) il lui faudrait découvrir combien la victoire pouvait être cruelle et qu’elle lui coûterait bien plus que tout ce qu’il avait à donner. »
Le capitaine n’arrive plus à écrire à sa femme ni à recevoir ses lettres sans trembler : peur d’y lire « son châtiment », de mauvaises nouvelles d’un des siens « à cause de ce qu’il fait ici ». L’arrestation du Kabyle semble lui donner l’occasion de respecter ses principes, pour une fois : éviter la torture physique qui est la base de leur travail de renseignement, interroger, menacer, pour obtenir des noms.
Plus que les circonstances de la guerre, Indochine ou Algérie, Où j’ai laissé mon âme explore le combat entre les principes et l’action, les valeurs morales et la loyauté – « Nous n’aimons pas ce travail, mais nous le faisons bien. » Le chef de la rébellion ne laisse aucune illusion à son geôlier qui pense avoir porté un coup fatal à l’autre camp : « La vérité, c’est que c’est moi qui suis fini, seulement moi, et ça n’a aucune importance parce que je ne compte pas. »
« Dieu appela le sec Terre, et il appela Mer l'amas des eaux. Et Dieu vit que cela était bon. » (Genèse IV, 10) Aux trois jours du récit, Ferrari fait correspondre trois extraits bibliques, ces versets du Jugement dernier pour le deuxième : « Car j’ai eu faim, et vous ne m’avez pas donné à manger ; j’ai eu soif, et vous ne m’avez pas donné à boire ; j’étais étranger, et vous ne m’avez pas recueilli; j’étais nu, et vous ne m’avez pas vêtu ; j'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. » (Matthieu, XXV, 41-43)
Troisième jour : « Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu’il les connaissait tous, et parce qu’il n’avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d’aucun homme ; car il savait lui-même ce qui était dans l’homme. » (Jean II, 24-25). Comment un ancien résistant et déporté – au camp, quelqu’un l’appelait « le petit curé » pour son entêtement à prier – a-t-il pu devenir à son tour tortionnaire ? « Chaque matin, il faut retrouver la honte d’être soi-même. » Dans ce roman aux faits et aux questions terribles, la guerre ne fait que des perdants.