Quand Agnès Desarthe (°1966) avait présenté Le Château des Rentiers (2023) à La Grande Librairie, son sujet m’avait beaucoup plu, et je suis heureuse de l’avoir trouvé à la bibliothèque. Le titre renvoie au nom d’une rue parisienne, celle de l’appartement de ses grands-parents maternels, Boris et Tsila Jampolsky. « Dans moins de dix ans, j’aurai l’âge qu’avaient mes grands-parents quand ils sont devenus propriétaires du petit appartement de la rue du Château des Rentiers. »

Agnès Desarthe en 2023 ©Celinę Nieszawer/Édition de l'Olivier/Leextra (source)
« Un projet d’avenir », titre de la troisième séquence (chacune de quelques pages), décrit une attente que nous avons tous ressentie, j’imagine, celle d’être « plus grande ». A huit ans, raconte Agnès Desarthe, elle rêvait de la belle jeune fille qu’elle serait quand elle en aurait dix-sept. Ensuite elle a pris pour modèle une amie, puis une chanteuse. Elle s’est rêvée « jeune agrégée d’anglais », puis « écrivain ». A vingt-quatre ans, elle l’est devenue, et aussi mère, traductrice, et depuis lors elle a laissé « filer le temps ».
Dans les années 1990, avec une dizaine d’amis, ils faisaient tout ensemble, se donnaient souvent rendez-vous près du tennis municipal. De l’autre côté de la rue, le nom d’une maison de retraite les « enchantait » : « MAPI » – « comme une contraction de mamie et papi ». Ils s’imaginaient alors fréquenter le même établissement quand ils seraient vieux, pour passer la fin de leur vie ensemble.
Ce « fantasme d’une vie communautaire du grand âge », elle sait qu’il vient du mode de vie de ses grands-parents et de leurs voisins. A soixante-cinq ans, ils avaient convaincu leurs amis d’acheter avec eux, sur plan, dans une tour pas encore construite, un petit appartement pas cher, moderne. Grâce à cela, ils se retrouvaient très facilement les uns chez les autres, Tsila et Boris, Marianne et Mme Grobo, Tania et son mari David, Froïm, Esther… « Personne n’était riche. Tout le monde avait souffert. Sur certains poignets, on lisait une série de chiffres tatoués. Je n’ai su que des années plus tard ce que cela signifiait. »
Le pacte passé avec ses propres amis trentenaires prévoyait de s’entraider – « Je me demande si nous comprenions quoi que ce soit à la vieillesse. La douleur n’entrait pas dans nos prévisions. » Agnès Desarthe se rappelle un festival littéraire en Ecosse, où elle présentait son troisième roman traduit en anglais, Cinq photos de ma femme. Le personnage principal, devenu veuf à plus de quatre-vingts ans, elle l’avait imaginé en se basant sur les souvenirs de son grand-père.
Au moment des questions, une très vieille dame au premier rang lui avait hurlé dessus : « Comment osez-vous parler de la guerre ? Comment osez-vous parler de la vieillesse ? […] Vous n’avez pas le droit de parler de ce que vous ne connaissez pas. » Elle allait lui répondre quand, à sa grande surprise, sa gorge s’était soudain nouée, elle s’était mise à pleurer, incapable de parler – une aphasie passagère dont l’avait sauvée le directeur de l’Institut français en l’emmenant déjeuner.
Sans ordre véritable, Le Château des rentiers relate peu à peu la vie de ses grands-parents et de leurs voisins, tous originaires de Bessarabie, les visites qu’elle leur rendait, l’avancement de son projet pour un endroit où se retrouver ensemble entre amis, tout cela mêlé à une réflexion sur l’âge, sur la vieillesse, dont elle n’a jamais eu « une conscience claire ». Elle se souvient, par exemple, de l’obstétricien choqué de la voir, à quarante-six ans, enceinte d’un quatrième enfant.
Pour y voir plus clair, elle interroge les autres, recueille les paroles de « seniors » sur l’âge, la vieillesse, prend rendez-vous avec un architecte pour lui soumettre son plan d’un habitat collectif convivial, leur « phalanstère ». Et ses amis d’autrefois ? Qu’en pensent-ils à présent ? Entretiennent-ils comme elle ce rêve d’un futur en commun ?
Juste après la mort de sa mère, Agnès Desarthe n’avait pas eu le courage de regarder une vidéo de la fondation Spielberg où celle-ci, à cinquante-neuf ans, avait témoigné sur les années de guerre. Enfin elle se décide à la voir et à l’écouter. Séquence après séquence, Le Château des Rentiers raconte des moments vécus avec sa famille, ses amis, ses enfants. Beaucoup de rencontres et une prise de conscience du temps qui passe sans rien de lourd ou de convenu : son récit est chaleureux et parfois drôle. « Les années s’amenuisent, qu’importe ? Plus le temps qui me reste à vivre diminue, plus ce que j’ai vécu enfle et prospère. »
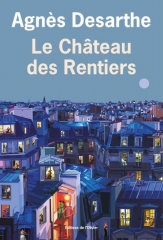 « A regarder mes grands-parents et leurs amis, on ne craignait pas de devenir vieux. Car vieux ne signifiait pas « bientôt mort ». Vieux signifiait « encore là ». Vieux, au Château des Rentiers, était synonyme de temps. Non pas du peu de temps qu’il reste, mais du temps dont on dispose pour faire exactement ce que l’on a envie de faire. Le temps était celui, délicieux et coupable, du sursis. Ils avaient survécu. Ils sur-vivaient et conjuguaient ce verbe au pied de la lettre : vivant supérieurement, et discrètement aussi, à la façon des superhéros, dont les superpouvoirs sont enivrants et doivent demeurer secrets. »
« A regarder mes grands-parents et leurs amis, on ne craignait pas de devenir vieux. Car vieux ne signifiait pas « bientôt mort ». Vieux signifiait « encore là ». Vieux, au Château des Rentiers, était synonyme de temps. Non pas du peu de temps qu’il reste, mais du temps dont on dispose pour faire exactement ce que l’on a envie de faire. Le temps était celui, délicieux et coupable, du sursis. Ils avaient survécu. Ils sur-vivaient et conjuguaient ce verbe au pied de la lettre : vivant supérieurement, et discrètement aussi, à la façon des superhéros, dont les superpouvoirs sont enivrants et doivent demeurer secrets. »


