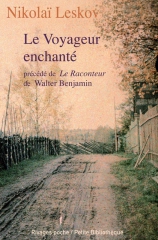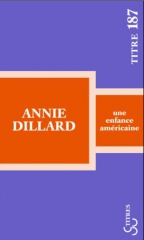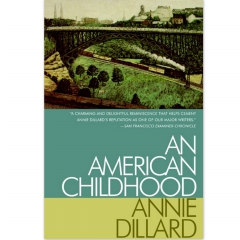C’est dans une des avenues les plus connues de Schaerbeek que le rendez-vous de Patris était donné le 9 juillet (Estivales 2017). Yves Jacqmin attendait les amateurs du patrimoine et des promenades guidées sur le terre-plein de la place de la Patrie. (Pour information, quasi toutes les dates affichent complet et il ne reste plus qu’à espérer des désistements pour ceux qui sont sur liste d’attente.)

Place de la Patrie, Schaerbeek © SPRB-DMS
Vers 1860, la commune a décidé de prolonger la rue Rogier qui reliait déjà la chaussée de Haecht au quartier Nord : l’avenue Rogier s’est ouverte en plusieurs phases, jusqu’à la place Meiser. Charles Rogier (1800-1885), homme politique plusieurs fois ministre de l’Etat belge, a de son vivant vu son nom donné à une rue puis une avenue, et aussi à la place Rogier. Enterré au cimetière de Saint-Josse ten Noode, il a sa statue place de la Liberté.

Au milieu, un entablement blanc typique de l'Art Déco en haut d'une façade, entre deux colonnes (place de la Patrie)
La visite commence donc par le tronçon le plus récent : la place de la Patrie, prévue à l’origine pour une église finalement bâtie plus loin, est devenue un square ; en venant de la place Meiser, c’est la première étape sur le tracé de l’avenue Rogier, avant la place des Bienfaiteurs. Elle a été construite dans les années 1920, quand s’épanouissait l’Art Déco. La bourgeoisie privilégiait encore des styles plus anciens, comme en atteste une maison à proximité (ci-dessous), avec ses œils-de-bœuf sous le toit et un joli fer forgé au balcon central.

Vue partielle de l'avenue Chazal
Nous traversons l’avenue Chazal qui monte vers la place Dailly, ce qui rappelle à notre guide l’hiver 60 qui rendait « fous » ses élèves quand la neige rendait l’ascension difficile pour le bus et occasionnait des retards. Devant une maison de Joseph Diongre, l’architecte de Flagey, qui a gardé ses sgraffites et quelques éléments art nouveau, pas ses châssis malheureusement, je me dis que cette façade comme beaucoup d’autres dans l’avenue Rogier mériterait d’être restaurée.

A droite, maison moderniste (avenue Rogier)
De l’autre côté de cette large avenue large plantée d’arbres, où le tram circule au milieu, nous observons une maison moderniste de l’architecte Léon Guianotte (au 280, ci-dessus) à côté d’une façade de style beaux-arts. Du côté impair, un autre témoignage du modernisme présente un parement noir et blanc en carreaux de céramique (au 299). Du côté pair, le numéro 250 présente une belle loggia en bois ; la pierre bleue du rez-de-chaussée encadre une entrée inspirée par l’art nouveau dans sa phase stylisée.

Maison de style Beaux-Arts (la plus haute), avenue Rogier
La diversité des styles architecturaux frappe comme presque partout dans Bruxelles. Ici un pignon en briques, vaguement médiéval, là de grandes baies vitrées – les maisons de style beaux-arts, inspirées du XVIIIe français, sont très bien éclairées. Le petit bois des fenêtres, dont les moulures jouaient avec la lumière, a souvent été remplacé par du PVC inesthétique, mais il suit tout de même les lignes originales.

271, avenue Rogier
Plus loin, une confrontation radicale entre tradition et modernité : le mur de verre de la façade, au 271, inédit en 1968 pour une maison particulière, tranche avec les maisons voisines – les vitres ont déjà été modifiées depuis. A l’angle de la rue Victor Bourgeois, le propriétaire du 263 a réalisé en 1930 une extension moderne avec garage très différente de sa maison : châssis arrondis, crépi blanc... Aujourd’hui, les murs sont jaunes et portent depuis la fin du mois dernier une fresque sympathique signée Nean, dans le cadre du projet d’art urbain Mixity.

urbana_project Mixity Wall #3 / Nean - Bruxelles « ville intergénérationnelle » (détails)
En descendant vers la place des Bienfaiteurs, rond-point en pente qui coupe l’avenue à mi-parcours, un habitué des Estivales me fait remarquer, en me montrant la perspective, que le premier creux de l’avenue Rogier, plus bas, correspond à la vallée du Maelbeek. Puis on remonte vers la chaussée de Haecht avant de redescendre, dans la rue Rogier, vers ce qui fut la vallée de la Senne.

Vue de la place des Bienfaiteurs vers l'avenue Deschanel (en bas) puis la chaussée de Haecht (en haut)
Au centre de cette grande place inaugurée en 1907, un « Monument aux Bienfaiteurs des Pauvres » de Godefroid Devreese est agrémenté d’une fontaine et de bassins auxquels ont collaboré Henri Jacobs et l’architecte paysagiste du parc Josaphat, Edmond Galoppin. Plus de cent ans plus tard, les arbrisseaux devenus de grands arbres dissimulent le piteux état de la fontaine – faute d’entretien, les bassins de cette place remarquable et pourtant classée ont un besoin urgent de restauration.

Monument des Bienfaiteurs (Godefroid Devreese) : « Cette allégorie de la Charité protégeant le vieillard et l’enfant
est complétée d’une paysanne schaerbeekoise qui rassemble ses choux dans un panier.
Le patrimoine communal possède les deux esquisses en plâtre de cette imposante fontaine. »
Les maisons qui l’entourent datent des années 1908-1909 et présentent un mélange de styles propre à l’éclectisme bruxellois : pignons d’inspiration médiévale, courbes Art nouveau… Les bâtiments d’angle vers le bas de l’avenue (photo de la vue plus haut) sont à la fois semblables et différents, leurs coupoles d’origine – trop coûteuses à restaurer, parfois faute d’artisans qualifiés – ont été remplacées par des toitures plates.

Le Bienfaiteur, place des Bienfaiteurs, 25 (angle de la rue Frans Binjé)
Une ancienne habitante de la place nous fait remarquer qu’Alain Resnais a tourné ici une séquence de « Je t’aime, je t’aime ». Elle se souvient d’un temps où les fontaines fonctionnaient encore. Le guide nous fait remarquer un hôtel dit « de rapport » annonçant les immeubles à appartements : sa façade en briques jaunes se termine par un pignon, elle dispose de trois portes (photo ci-dessous), celle du milieu dessert le haut, les latérales les appartements de chaque côté.

Trois portes d'un immeuble ou « hôtel » de rapport de style éclectique (architecte Louis Serrure), 1912
place des Bienfaiteurs 26-27-28
Nous verrons encore quelques bâtiments aux alentours avant de revenir sur la place – le snack-resto Le Bienfaiteur occupe le rez-de-chaussée d’une maison d’angle surmontée d’un renard, remarquable avec ses pierres bleues et ses balustres sous les fenêtres. En face, de l’autre côté de la place, le café Le vase d’argent (disparu) était connu des amateurs de jazz. Une petite communauté ou comité de quartier des environs s’appelle « les Bienfêtards » !

A gauche, maison en briques jaunes à arcs brisés (architecte A. Dankelman), 1909 (rue Frans Binjé)
Quand on descend vers l’avenue Deschanel où la promenade se termine – espérons qu’elle aussi fasse un jour l’objet d’une Estivale schaerbeekoise –, on peut admirer entre autres la belle poste de l’avenue Rogier (ancien hôtel de maître) ; une maison qui porte la mention « Anno 1908 » très hétéroclite avec ses carreaux de céramique ; un magasin dont la façade déborde de fantaisie décorative.

Poste de l'avenue Rogier (stores rouges)
Nous voici presque à l’avenue Deschanel, nous nous arrêtons au pont du chemin de fer pour admirer ses beaux matériaux. Quand la station-service de l’avenue a été reconstruite, tout près, on a veillé à ce qu’elle ne dépare pas trop le grand carrefour des avenues Rogier et Eisenhower (hauteur réduite, murs de briques). Ces avenues ont conservé un beau patrimoine, mais il semble fragile.

 Chaque fois que je passe devant ces immeubles de l’avenue Deschanel, juste avant le carrefour avec l’avenue Rogier, je regarde si elles sont encore là, ces portes « littéraires » qui célèbrent des écrivains français.
Chaque fois que je passe devant ces immeubles de l’avenue Deschanel, juste avant le carrefour avec l’avenue Rogier, je regarde si elles sont encore là, ces portes « littéraires » qui célèbrent des écrivains français.