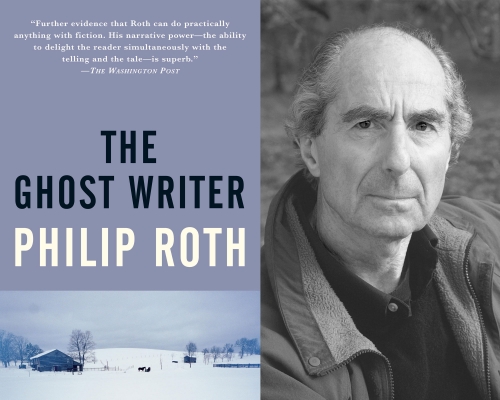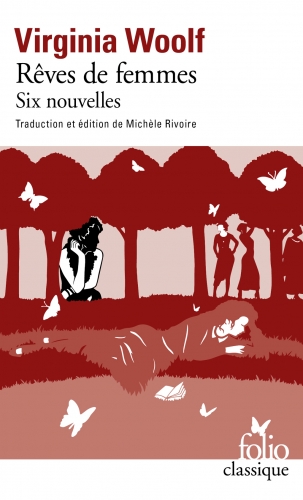Après avoir lu Exit le fantôme (2007), il me fallait absolument remonter aux débuts de Nathan Zuckerman, le héros et le double « de fiction » de Philip Roth (1933-2018). Zuckerman enchaîné rassemble les quatre premiers titres du cycle. L’écrivain fantôme (titre plus fidèle que L’écrivain des ombres dans la première traduction de The Ghost Writer, 1979) fait apparaître le jeune Nathan en admirateur de l’écrivain E.I. Lonoff à qui il rend visite.
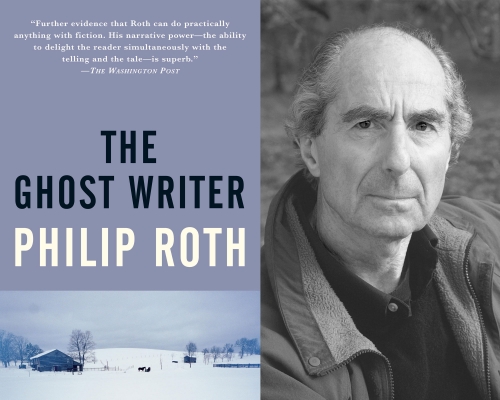
A vingt-trois ans, Zuckerman a publié quelques nouvelles et se rend, très ému, « à la retraite du grand homme » au bout d’un chemin de terre dans les Berkshire. La tenue soignée du « maestro » (titre du premier chapitre) le surprend, et tout chez lui, ses manières méticuleuses, son salon « simple, confortable, très en ordre », la vue des « grands érables sombres et des champs de neige » par les fenêtres, lui plaît tellement qu’il se dit : « Voici comment je vivrai. »
Elevé à Newark par des parents aux petits soins dans un quartier « ni riche, ni pauvre », avec un frère plus jeune qui l’idolâtre, Nathan vit et écrit dans un « réduit » en bas de Broadway, quand il ne travaille pas à New Jersey, trois fois par semaine, à faire du porte à porte pour placer des abonnements à des illustrés. Avec l’aide de son éditeur, il a été admis « pour les mois d’hiver, comme résident à la Quahsay Colony, la retraite rurale pour artistes en face de la colline de Lonoff, juste de l’autre côté de la frontière de l’Etat. »
C’est de là qu’il a envoyé à Lonoff les numéros de la revue qui a publié quatre nouvelles de lui, avec une lettre où il lui disait l’importance que son œuvre a eue pour lui, comme celle de ses « frères de race », Tchekhov et Gogol. Très vite, Nathan explique au lecteur qu’il n’ambitionne pas moins que devenir le « fils spirituel » de Lonoff. Il dispose par ailleurs d’un père aimant, mais celui-ci est pédicure et non artiste, et reste effaré par ce qu’écrit son rejeton. Cela fait plusieurs semaines qu’ils ne se parlent plus.
« Le héros typique des récits de Lonoff (…) semblait dire quelque chose de neuf et poignant aux Gentils à propos des Juifs et aux Juifs à propos d’eux-mêmes (…) ». Une fois décrites les raisons de son admiration, Zuckerman relate leur entrevue, les questions qui lui sont posées, sa curiosité en apercevant une fille magnifique assise sur un tapis dans le bureau de travail dont Hope, la femme de Lonoff, a poussé la porte : sa fille ? Il imagine déjà de se fiancer avec elle.
Lonoff résume son art tout simplement : « Je combine des phrases, voilà ma vie. » L’écrivain décrit sa manière de faire, son emploi du temps. L’entretien avec Nathan est interrompu par diverses sollicitations qui agacent Lonoff et puis par l’apparition de la jeune Amy Bellette : elle travaille à la bibliothèque de Harvard et met de l’ordre dans les manuscrits du maître. Elle lui annonce avoir trouvé « vingt-sept versions différentes de la même nouvelle » intitulée « La Vie est embarrassante » !
Nathan Zuckerman reste pour le dîner. Lonoff lui porte un toast inoubliable, « A la santé d’un nouvel écrivain merveilleux ! », ce qui le libère complètement de sa timidité. A son épouse, le vieil écrivain déclare que ce que leur jeune invité écrit « témoigne d’une certaine turbulence qu’il faut entretenir et pas au milieu des bois ». Quand la conversation tourne autour de Miss Bellette, la tension monte et Nathan assiste à une scène terrible, ce qui n’empêchera pas les deux écrivains, le maître et le débutant, de discuter ensuite de littérature toute la soirée. C’est entendu, comme il ne cesse de neiger, il restera dormir dans le cabinet de travail.
« Qui aurait pu dormir après cela ? » C’est peut-être, pour Nathan, l’occasion rêvée d’écrire à son père (qui veut le « sauver » de ses « erreurs ») la lettre d’explication qu’il attend, après que son fils a laissé sans réponse la lettre d’un juge réputé à qui son père a demandé d’intervenir pour le raisonner sur la façon dont il parle des Juifs dans ses écrits. Mais les bruits, les conversations nocturnes qu’il écoute avidement, l’observation du bureau de Lonoff, de sa bibliothèque, tout cela lui importe davantage.
Le petit déjeuner à quatre, le lendemain matin, comme dans « une famille heureuse », ne sera pas des plus ordinaires. On en apprend davantage sur Amy Bellette, qui se prend pour Anne Frank, et on découvre à la fin pourquoi Lonoff dit à Nathan Zuckerman : « C’est comme d’être marié à Tolstoï. » L’écrivain fantôme, avec ferveur et humour, raconte comment « la folie de l’art », selon la formule d’Henry James, se vit au quotidien, à travers le regard d’un jeune écrivain qui ne perd pas une miette de ce qui s’offre à lui. Irrésistible.
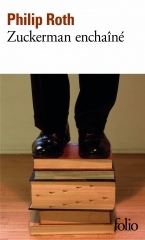 « Je combine des phrases, voilà ma vie. J’écris une phrase et je la décortique. Puis je l’examine et je la retourne encore. Ensuite, je vais déjeuner. Ensuite, je reviens et j’écris une autre phrase. Ensuite, je prends le thé et remanie cette phrase. Ensuite, je lis les deux phrases et les recompose encore. Ensuite, je m’allonge sur mon canapé et je réfléchis. Ensuite je me lève, bazarde mes deux phrases et recommence à zéro. Et si je laisse tomber cette routine ne fût-ce qu’un jour, je suis malade d’ennui et ravagé à cause du temps perdu. »
« Je combine des phrases, voilà ma vie. J’écris une phrase et je la décortique. Puis je l’examine et je la retourne encore. Ensuite, je vais déjeuner. Ensuite, je reviens et j’écris une autre phrase. Ensuite, je prends le thé et remanie cette phrase. Ensuite, je lis les deux phrases et les recompose encore. Ensuite, je m’allonge sur mon canapé et je réfléchis. Ensuite je me lève, bazarde mes deux phrases et recommence à zéro. Et si je laisse tomber cette routine ne fût-ce qu’un jour, je suis malade d’ennui et ravagé à cause du temps perdu. »