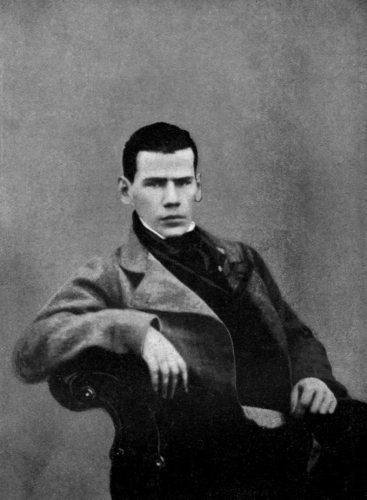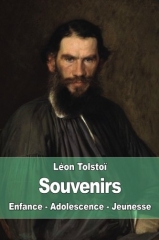27 janvier 1945 : libération du camp d’Auschwitz par l’Armée rouge en Pologne occupée (Wikipedia). Avant de lire le nom d’Edith Bruck sur de nombreux blogs fidèles au devoir de mémoire, je ne savais rien de cette écrivaine italienne d’origine hongroise, née Edith Steinschreiber en 1931. Le pain perdu (2021, traduit de l’italien par René de Ceccatty, 2022) est le récit autobiographique et le témoignage d’une survivante d’Auschwitz.

Edith Bruck en janvier 2020 (source)
Petite fille aux pieds nus et aux tresses blondes, elle a grandi à la campagne, benjamine d’une famille nombreuse. Au lieu de « Ditke », son diminutif, ses frères et sœurs l’appelaient « Boulette ». Sa mère, fatiguée de ses « pourquoi ? », lui répondait souvent « Demande-le-Lui, à Lui » en lui criant dessus, exaspérée de la voir s’approcher des fous, des vieux. On s’en rappellera en lisant la « Lettre à Dieu » à la fin du récit.
Ditke était « la première de la classe, malgré les lois raciales, que le village n’appliquait pas à la lettre. » Elles étaient trois élèves juives au dernier rang, deux filles de commerçants et elle, « fille de Stein Schreiber », « exclu de l’armée, en 1942 », qui conduisait les bêtes des autres au marché, « pour un gagne-pain de misère ».
Sa grand-mère maternelle meurt quand Ditke a douze ans. Dans une poche raccommodée de son peignoir, sa mère trouve de l’argent, deux alliances en or et une chaînette avec l’étoile de David. Cela leur permet de construire une petite maison d’une seule grande pièce avec une cuisine. Au premier « Heil Hitler ! » lancé à sa sœur Judit, qui est pour sa petite sœur une seconde mère, leurs parents sont bien forcés de leur expliquer que pour les autres, ils ne sont pas hongrois mais juifs.
A Noël, le tambour annonce que les Juifs ne pourront plus sortir de chez eux après six heures, « ni quitter le village, ni voyager ». Au treizième printemps d’Edith, ils fêtent la Pâque juive sans joie ni chants. Une brave voisine leur a offert de la farine, la mère a préparé de la pâte pour la fin de la fête quand deux gendarmes font céder la porte sous leurs coups et leur donne cinq minutes pour sortir – « le pain, le pain » répète sa mère, mais les voilà tous jetés dehors. En chariot puis en train, les familles juives sont emmenées dans le ghetto du chef-lieu local. Un oncle arrivera à leur y apporter de la nourriture pour l’anniversaire de Ditke, « fêté avec un gâteau, mais maman soupirait encore pour le pain perdu. »
Fin mai, « des bandes de corbeaux noirs, armés, d’apparence humaine » les chassent de là pour les entasser dans des wagons à bestiaux. Seule consolation : ils sont tous ensemble. A quarante-huit ans, les parents « ont vieilli d’un coup ». Quatre jours plus tard, ils sont à Birkenau, aussitôt séparés. Ditke se retrouve seule avec sa sœur Judit.
A Auschwitz, Ditke est « 11152 ». Quand elle s’inquiète de sa mère, une kapo polonaise lui montre la fumée : voilà ce qu’est devenue sa mère. Au camp, il leur faut s’habituer à la nourriture immangeable comme à la faim, aux poux, à la peur. « Chaque jour, à chaque heure, à chaque minute on mourait : l’une par sélection, une autre à l’appel, une autre de faim, une autre de maladie » ou foudroyée par le courant du fil barbelé.
Après la Pologne, ce sera l’Allemagne : Dachau, où elles sont mises au travail. Judit et Ditke sont affectées à un petit commando de quinze femmes choisies pour travailler dans la cuisine d’un château pour les officiers de terre et leurs familles. Elles y volent parfois un supplément de nourriture. Puis on les déplace d’un endroit, d’un camp à l’autre. L’enfer sur terre.
« Nous avons vécu dans l’agonie, au milieu des morts, dans le froid, la faim jusqu’au dernier appel du 15 avril, mais de l’aube à neuf heures, personne n’est venu nous compter. La kapo qui nous mettait en rangs à coups de bâton, parce que certaines d’entre nous ne pouvaient tenir debout, avait disparu. » Quand Judit se risque dehors, elle revient en criant que les Allemands sont partis. Des soldats arrivent pour les libérer et les emmènent à l’hôpital militaire de Bergen-Belsen. On y augmente très lentement leur nourriture. Le jour de ses quatorze ans, Ditke reçoit un sachet de sucre.
« Ils nous ont rendu nos noms, inscrits sur des papiers, avec nos dates de naissance, nos origines, nos numéros de déportées, nos lieux de captivité : nous avions l’impression de renaître, libres et dispersées dans le monde des vivants. » Et le reste de leur famille ? Sans attendre leur tour de rapatriement, les deux sœurs se mettent en route dans la confusion générale. Elles ne se doutent pas des difficultés à venir.
A Budapest où vit leur sœur Mirjam, elles la trouvent avec un petit garçon, « déjà veuve ». Son mari « est mort congelé en marche vers les camps, après des années de travaux forcés ». Puis elles retrouvent leur sœur Sara, enceinte, ensuite David, leur frère de vingt ans, qui leur apprend la mort de leur père au camp. Au village, quand elles y retournent, les voisins les regardent avec stupeur, se défendent d’avoir fait du mal ; leur maison a été vidée, dévastée.
La deuxième partie de Pain perdu raconte leur « nouvelle vie ». Judit veut absolument rejoindre la Palestine – le rêve de leur mère – et ne comprend pas que sa sœur ne veuille pas l’y accompagner. Ditke n’a qu’un objectif en tête : écrire, tenir la promesse qu’elle a faite à des mourants de Bergen-Belsen de raconter ce qu’ils ont vécu. Elle sera un témoin de la Shoah comme son ami Primo Levi. « L’écriture d’Edith Bruck est à l’image de sa volonté et de sa force. Claire et directe, elle ne laisse aucune place aux atermoiements ou aux dérobades. » (Gabrielle Napoli)
Survivre est une chose, vivre en est une autre. Trouver un travail, peu importe lequel, se marier et divorcer, plusieurs fois, voyager, et finalement se fixer en Italie pour commencer une carrière d’écrivaine. A 90 ans, sa vue baissant, sa mémoire aussi, Edith Bruck décide de « survoler, rétrospectivement » son existence dans Il pane perduto : « Et aujourd’hui, mon long chemin me semble à moi-même invraisemblable, un conte dans la « forêt obscure « du XXe siècle, avec sa longue ombre sur le troisième millénaire. »