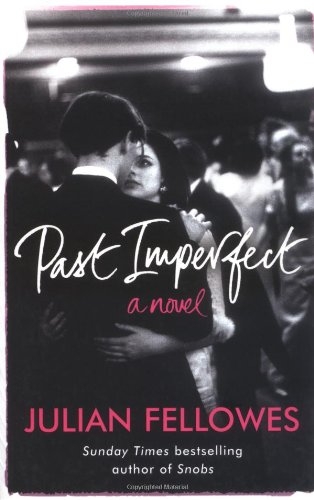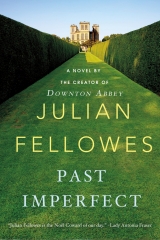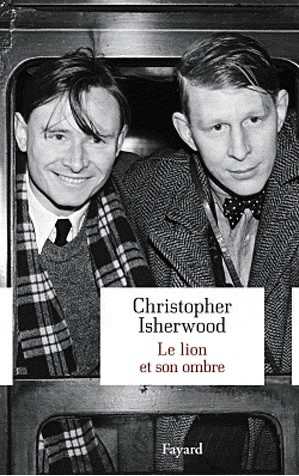Passé imparfait de Julian Fellowes (2008, traduit de l’anglais par Jean Szlamowicz) distille une ambiance propre au scénariste de Gosford Park puis de la fameuse série Downton Abbey. Une certaine fascination du passé – « Londres est désormais pour moi une ville hantée et je suis le fantôme qui erre dans ses rues » ; une certaine tension – « Je détestais Damian Baxter » ; une certaine sensibilité – « Traditionnellement, les Anglais préfèrent ne pas affronter directement une situation qui pourrait se révéler délicate du fait d’événements passés ».
Une lettre déclenche tout : après quarante ans sans plus aucun contact entre eux, Damian Baxter, « son vieil ennemi », aimerait que le narrateur lui rende visite, comme « une faveur accordée à un mourant ». A plus de cinquante ans, le voilà troublé à l’idée de revoir celui qui prétendait être son ami. A la gare de Guilford, un après-midi de juin, un chauffeur en uniforme l’attend. Le narrateur connaissait la réussite de Damian, mais n’en mesure l’ampleur qu’en découvrant sa demeure entourée de jardins en terrasse et « l’ambiance digne d’Agatha Christie » : maître d’hôtel, femme de chambre, salon ample, un décor réussi quoique impersonnel – « rien de vivant en réalité ».
Le « beau jeune homme bien bâti aux boucles épaisses » a disparu, mais il reconnaît Damian, sa voix un peu hésitante et aussi « cette arrogance condescendante si familière dans le geste large avec lequel il [lui] tendit sa main osseuse ». Après un dîner délicieux, une conversation « éminemment anodine » en présence du maître d’hôtel, ils vont prendre le café dans la bibliothèque, une jolie pièce avec sa cheminée en marbre, « le cuir luisant des reliures et quelques admirables tableaux ».
Damian n’a plus que trois mois à vivre. Marié peu avant la quarantaine, puis divorcé, sans enfants, il a très bien revendu son entreprise. Devenu stérile à la suite d’oreillons contractés sans doute au Portugal en juillet 1970 (quand ils avaient 21 ans, le narrateur l’avait invité à passer des vacances avec un groupe d’amis dans une villa d’Estoril, vacances aux conséquences « désastreuses » qui ne seront racontées qu’à la fin), Damian sait qu’une jeune femme a eu un enfant de lui : elle lui a envoyé une lettre tapée à la machine, vingt ans après, pour lui dire qu’elle ne lui pardonnait pas sa « fourberie » et « son mensonge » qu’elle avait sous les yeux chaque jour. Puis plus rien.
Damian veut retrouver l’enfant, faire de lui l’héritier de sa fortune. Ses recherches n’ayant mené à rien, il lui faut l’aide de quelqu’un qui connaisse son cercle d’alors. Il a préparé une liste des femmes avec qui il a couché et qui ont eu un enfant à cette époque. Ils avaient fait connaissance en 1968 lors d’un cocktail dans un collège de Cambridge, où le narrateur était en train de parler avec Serena (la femme de ses rêves), Lady Serena Gresham, « membre d’une caste très restreinte, rare résidu qui restait de l’Ancien Monde ». Beaucoup d’aristocrates déchus avaient rejoint la bourgeoisie, très rares étaient ceux qui, comme les Gresham, « continuaient à vivre, à peu de chose près, comme ils avaient toujours vécu. »
Damian, un jeune homme très séduisant, les avait interrompus avec un sourire, avouant qu’il ne connaissait personne – « Inutile de préciser qu’il savait en réalité pertinemment qui nous étions. Ou plutôt qui elle était. » Dès cette soirée, il s’était montré curieux d’en savoir plus sur Serena, sur l’ancienneté de leur relation et sur la manière de s’y prendre pour figurer sur les listes des tea parties entre gens du même monde. En leur compagnie, nous allons découvrir leurs usages et leurs règles, les snobismes d’un autre temps.
Damian s’est servi de lui pour s’introduire dans la haute société. Pourtant le narrateur accepte cette mission, malgré ce qui les a séparés. Le va-et-vient commence entre deux périodes dissemblables : leur jeunesse, rythmée par la Saison mondaine plus que par les études, et le présent. Tout a changé. Chacun d’eux s’est transformé au cours de la vie adulte, et surtout la société, les mœurs, les manières, le monde où ils évoluent.
Lucy Dalton est sur la liste, à son grand étonnement, elle qui avait été une des premières à percer à jour les manigances de Damian. Et aussi la princesse Dagmar de Moldavie. Serena. La belle Joanna Langley qui a été un temps sa petite amie. Terry Vitkov, l’Américaine dont la soirée au musée Tussaud avait tourné au cauchemar à cause du cannabis mis dans les brownies. Enfin, Candida Finch, « la mangeuse d’hommes exubérante et rougeaude ». Rares sont celles qui ont vraiment pu choisir leur vie.
Des années soixante aux années deux mille, Julian Fellowes raconte cette quête très particulière qui mène le narrateur à remonter le temps et à découvrir l’évolution personnelle de ces jeunes filles de bonne famille. Bien reçu partout, il ne lui sera pas difficile de les recontacter sous un prétexte caritatif et de vérifier, en leur rendant visite, qui a eu un enfant de Damian Baxter.
Sans être autobiographique, le roman s’inspire de l’expérience personnelle de l’auteur, un aristocrate aujourd’hui pair du Royaume : « c’est effectivement une photographie de l’époque, de la Saison 1968, où j’allais à tous ces bals. Toutes les fêtes et réceptions du livre ont vraiment eu lieu, et les personnages sont inspirés des hommes et des femmes qui y participaient. Certains sont des portraits fidèles de gens que j’ai croisés, d’autres un mélange de plusieurs personnalités. » (Paris Match)
Passé imparfait est un voyage au cœur de la haute société anglaise et la chronique de ses transformations durant la seconde partie du XXe siècle. C’est brillamment observé, raconté de façon amusante pour qui s’intéresse à ce beau monde, et derrière les rôles, les masques mondains, Julian Fellowes laisse parfois s’exprimer des sentiments vrais, heureux ou malheureux.