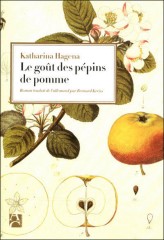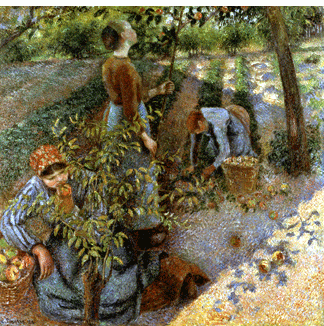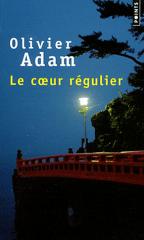Un pavé guerrier et viril, tel paraît le Goncourt 2011, L’art français de la guerre, premier roman (publié) d’Alexis Jenni. Un sujet rude, une entrée en matière directe : « Les débuts de 1991 furent marqués par les préparatifs de la guerre du Golfe et les progrès de ma totale irresponsabilité. » Un style indubitable : « Oh ! ces beaux soldats de l’été, dont presque aucun ne mourut ! Ils vidaient sur leur tête des bouteilles entières dont l’eau s’évaporait sans atteindre le sol, ruisselant sur leur peau et s’évaporant aussitôt, formant autour de leur corps athlétique une mandorle de vapeur parcourue d’arcs-en-ciel. » Six cents pages où alternent les Commentaires d’un narrateur et le Roman d’un soldat.
Gilles Balmet, Mauvaises herbes, 2008 (encre sur papier) © Gilles Balmet / Galerie Dominique Fiat
Courtesy de l'artiste et Dominique Fiat, Paris
Celui qui narre use et abuse des congés de maladie pour traîner au lit chez son amie devant la télévision. Il s’intéresse pour la première fois aux soldats français en regardant le départ pour le Golfe des spahis de Valence. Après une année d’« absentéisme maniaque », il est licencié et rentre à Lyon. Les images de « Tempête du Désert » le fascinent, avec ses morts peu nombreux du côté occidental mais des Irakiens « tués en masse » – les morts adverses, « on ne les compte pas parce qu’ils ne comptent pas. »
Il faudrait, écrit Jenni, élever une statue à Paul Teitgen, secrétaire général de la police à la préfecture d’Alger. Ce civil a obtenu du général des parachutistes une fiche d’assignation à résidence pour chaque homme arrêté, ce qui lui a permis de compter les relâchés, les internés, les évadés et les autres, les « disparus » : « Il fit le seul geste humain dans cette tempête de feu, d’éclats tranchants, de poignards, de coups, de noyades en chambre, d’électricité appliquée au corps : il recensa les morts un par un et garda leur nom. » C’est Victorien Salagnon qui a appris au narrateur que les morts comptés et nommés ne sont pas perdus.
Voilà les protagonistes de L’art français de la guerre : un jeune glandeur en chambre meublée qui distribue des journaux publicitaires puis sirote du vin blanc au bistrot et Salagnon, l’ancien d’Indochine, seul à y lire le journal à table. Ils se reconnaissent un dimanche au bord de la Saône, au Marché des Artistes. L’ancien aux yeux transparents vend ses peintures, des lavis monochromes à l’encre de Chine – « avec du noir il faisait de la lumière ». Subjugué, le jeune homme lui demande de lui apprendre à peindre. Ces deux-là n’ont pas fini de se parler.
Le narrateur se raconte et raconte Salagnon. Salagnon se raconte et raconte la guerre. Quelle guerre ? La guerre de vingt ans en Algérie (1942-1962), d’où il a ramené sa femme, Eurydice Kaloyannis, et les autres où il a combattu. Eurydice, du même âge que Victorien, est la vie même, une des rares mais belles présences féminines dans ce récit. « Sa vie intense tout entière en même temps était présente dans chacun de ses gestes, toute sa vie dans la tenue de son corps, toute sa vie dans les inflexions de sa voix, et cette vie la remplissait, se laissait admirer, était contagieuse. »
C’est durant l’hiver 43 que Victorien Salagnon, occupé à traduire De bello gallico au cours du professeur Fobourdon tout en griffonnant le plan de la bataille sur le côté, a pris le goût de la Chine, d’un mot sur un flacon d’encre – « Il aimait à ce point l’encre noire qu’elle lui semblait pouvoir fonder un pays entier. » Un vieux jésuite qui avait passé sa vie en Chine est venu leur en parler à l’école, leur a lu Lao-Tseu, parlé de Sun-Tsu « à propos de l’art de la guerre ». Fuyant la boutique « haïssable » de son père, Victorien préfère dessiner dans sa chambre : « Sa main voyait, comme un œil, et son œil pouvait toucher comme une main. »
Chez les scouts aussi, on joue à la guerre. Salagnon y est le roi Minos qui, pour faire gagner ses troupes, les emmène se cacher dans la forêt (le parc de la « Grande Institution »), les entraîne à se jeter à terre, se relever, bondir, recommencer, à obéir comme des machines, sans états d’âme. Le premier mort de Victorien, c’est l’ami avec qui, pour échapper à cette vie stupide, une nuit, il a décidé « d’aller peindre sur les murs des mots sans concession » avec un seau de peinture rouge sombre. Pendant que lui pisse dans un coin, son ami, surpris par une patrouille allemande, est abattu quand il s’encourt. Protégé par l’ombre, Victorien est sauf.
Au printemps, un homme en uniforme noir vient en classe annoncer aux garçons leur convocation aux « Chantiers de jeunesse », où on les formera avant de les intégrer à une armée nouvelle. L’oncle de Victorien y est officier. Après, ce sera la vraie guerre face aux chars des Allemands, la rencontre d’Eurydice, fille du Dr Kaloyannis, l’Indochine, l’Algérie surtout. Une implacable leçon de réalité, d’horreur, de force et de mort. Mais dès l’apprentissage du fusil-mitrailleur, Salagnon s’est fabriqué un cahier du papier brun des munitions. Partout, toujours, il regarde, il dessine.
Avant de rencontrer le vieux soldat, le narrateur a eu « travail, maison et femme ». La routine consommatrice lui était insupportable : courses, shopping, dîners. Un soir, après avoir trop bu et provoqué un esclandre devant sa femme et leurs amis, il s’en est allé, s’est désinstallé. Il a attendu, s'est réjoui d’atteindre le ciel dans sa « boîte », une chambre sur les toits de Lyon. Dans la rue, témoin d’une émeute lors d’un contrôle policier, il s’interroge sur « la race ». Son grand-père était intarissable sur le thème de la génération, il avait fait « lire son sang » en laboratoire pour savoir de quel peuple ancien il était issu. « La ressemblance, confondue avec l’identité, permet le maintien de l’ordre » – la pourriture coloniale revient à la surface.
Comment on vit dans la guerre, comment on y meurt, comment on s’en sort. La vie de Victorien Salagnon est la véritable école du narrateur : en apprenant à tenir un pinceau, en écoutant ses histoires de solitude, de force, de faiblesse et de mort, d’amitié et d’amour, un homme jeune et désarmé devant le monde comme il va distingue les questions sociales sous le « petit guignol racial », la nostalgie de la force armée sous les dérives policières. « La force et la ressemblance sont deux idées stupides d’une incroyable rémanence : on n’arrive pas à s’en défaire. » Mourrons-nous à petit feu de ne plus vouloir vivre ensemble ?
Lire L’art français de la guerre, c’est recevoir en plein front la violence des hommes. Non pas contre ni à côté mais dans toute cette fureur, il y a le dessin, la peinture. « La vie de la peinture est non pas le sujet mais la trace de ce que vit le pinceau. » A la force brutale de la guerre, Alexis Jenni accole la puissance de l’art. Il écrit de belles pages aussi sur la langue, qui fonde l’identité. Telle est la perspective de ce roman foisonnant : « retracer en français un peu de la vie de ceux qui le parlent. »