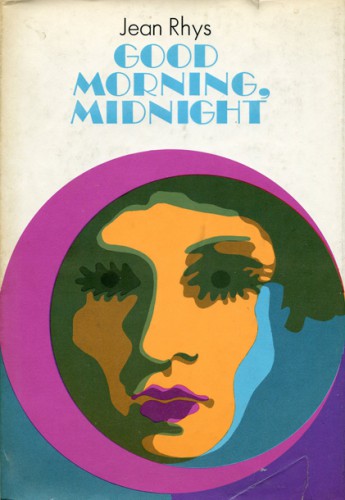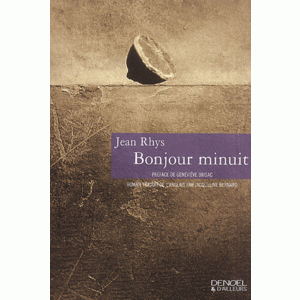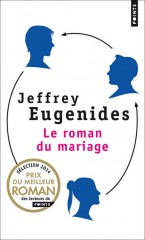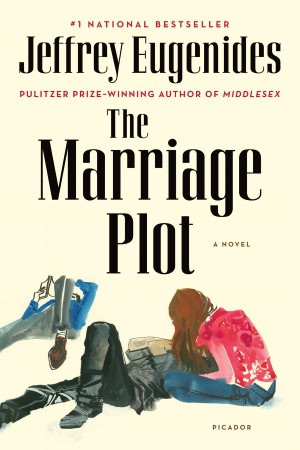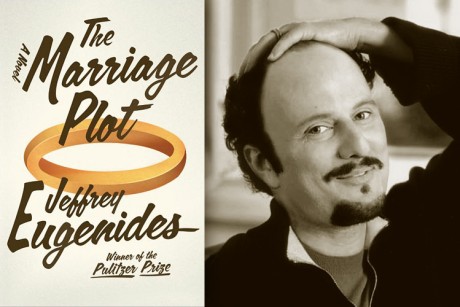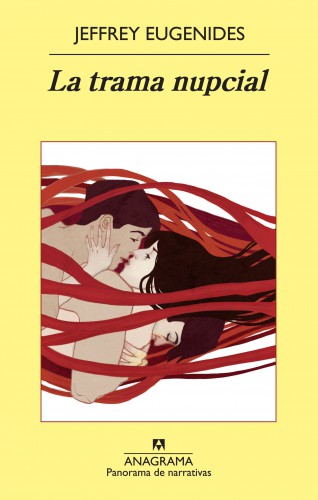Le nom de Jean Rhys (1890-1979) vous dit-il quelque chose ? Née aux Antilles, elle a écrit quelques romans – La prisonnière des Sargasses ou l’enfance et l’adolescence d’une jeune créole à la Jamaïque – et des nouvelles. Bonjour minuit (1939, traduit de l’anglais par Jacqueline Bernard) vient d’être réédité, voici le début de la préface signée Fanny Ardant.
« Vous la rencontrerez peut-être un après-midi dans le jardin du Luxembourg. Elle est blonde, elle a un manteau de fourrure, elle marche les mains dans les poches, le regard par terre, elle sait que les yeux des hommes sont cruels. Elle s’arrête et parle toute seule. Si elle dit : « Curieux comme cela peut être triste, le soleil de l’après-midi. » C’est elle. »
Le titre est emprunté à un poème d’Emily Dickinson : « Bonjour, Minuit ! / Je rentre chez moi, / Le Jour s’est lassé de moi – / Comment pouvais-je me lasser de lui ? » Dans une chambre d’hôtel bon marché, une femme arrange son existence entre « un endroit pour manger à midi, un endroit pour manger le soir, un endroit pour boire après le dîner ».
C’est une amie qui ne supportait pas de la voir « avec un air comme ça » qui lui a suggéré de se changer les idées, de retourner un peu à Paris, en lui prêtant de l’argent si nécessaire, pour s’acheter de nouvelles robes. A Paris, elle a partout des souvenirs. Dans les années vingt, elle avait choisi de s’y faire appeler « Sasha » – « J’ai pensé que mon sort changerait peut-être si je changeais de nom. »
Du Gardénal pour dormir. Le matin, croiser sur le palier « ce foutu type » squelettique en robe de chambre qui occupe la chambre d’à côté. Son programme du jour ? « Ne pas trop boire, éviter certains cafés, certaines rues et certains endroits, et tout ira très bien. Ce qu’il faut c’est avoir un programme, ne rien laisser au hasard – pas de trous. »
Un dimanche après-midi dans un cinéma des Champs-Elysées, et quand elle en sort, « il fait nuit et les réverbères sont allumés », Paris a un air pimpant. La voici à l’endroit d’où elle a vu passer le cortège funèbre d’Anatole France. Elle a travaillé autrefois dans ce quartier, elle accueillait les clientes d’une maison de couture. Elle raconte ses débuts, son renvoi, ses autres emplois.
A l’hôtel, au restaurant, dans les bars, elle écoute les conversations, surveille les regards posés sur elle : elle tient à avoir l’air respectable, même s’il ne s’agit plus à présent d’être « aimée, belle, heureuse ou capable ». La tranquillité, avant tout. Elle a bien essayé de se tuer à force de boire, mais elle est toujours là, à lire les menus et observer les autres clients. Un soir, elle se laisse approcher par deux Russes, elle trouve le plus jeune « assez beau dans un genre doux et mélancolique ».
« Jean Rhys disait de son roman : "Les gens le trouvent trop triste, je ne sais pas pourquoi. Je ne voulais pas montrer les choses sous un jour particulièrement noir. Il me faut reconnaître que mon livre en a vu de toutes les couleurs. On me conseille d'être moins sinistre alors que je veux simplement raconter quelques-unes des choses qui me sont arrivées, telles quelles". » (Au bonheur de lire)
Chaque journée, pour Sasha, est une traversée périlleuse, mais elle s’accroche, entre souvenirs, résolutions et rencontres de hasard. Bonsoir minuit est le roman d’une errance au féminin, lucide et parfois drôle. « Champagne pour les perdants », titre Marie-Noël Rio dans Le Monde diplomatique. Un méli-mélo de désespoir et d’élégance dans le Paris bohême.