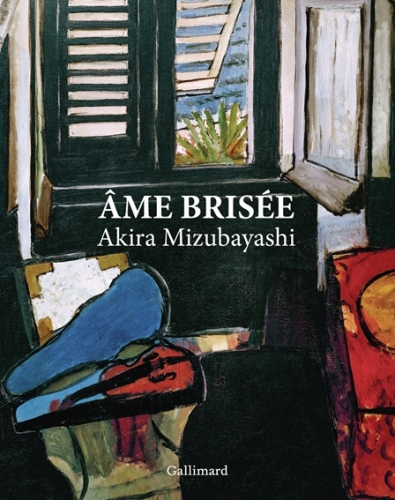Avec « Longtemps je me suis couché de bonne heure », une autre première phrase célèbre de Proust suffit à nous introduire dans son univers : « Il n’y a peut-être pas de jours de notre enfance que nous ayons si pleinement vécus que ceux que nous avons cru laisser sans les vivre, ceux que nous avons passés avec un livre préféré. » La première phrase de Journées de lecture (1906), préface à la traduction par Proust de Sésame et les lys (un essai de John Ruskin), est reprise par Pascal Lemaître dans la même écriture que le titre (fort éloignée de celle de l’auteur) en quatrième de couverture d’une édition illustrée pour les éditions de l’Aube (2022).
C’est d’abord une superbe évocation par Marcel Proust de son enfance, en particulier de ses heures de lecture pendant les vacances : « le matin, en rentrant du parc, quand tout le monde était parti « faire une promenade » et qu’il pouvait se glisser dans la salle à manger – « deux grandes heures » avant le déjeuner, à condition de ne pas être dérangé ; après le déjeuner, quand chacun se retirait dans sa chambre ; après le goûter, dans une charmille du parc ; après le dîner, dans son lit « seulement les jours où [il était] arrivé aux derniers chapitres d’un livre », au risque d’être découvert et puni.
En même temps, Proust décrit qui passe ou s’installe dans la salle à manger, comment les préparations de la cuisinière sont appréciées ou non par sa grand-tante, comment sa chambre est meublée et décorée (en désaccord avec les théories de William Morris selon lesquelles « une chambre n’est belle qu’à la condition de contenir seulement des choses qui nous soient utiles ») et puis les sentiments qui l’envahissent une fois le livre fini, l’adieu aux personnages « à qui on avait donné plus de son attention et de sa tendresse qu’aux gens de la vie ».
En préfaçant « Trésors des Rois » (première des deux conférences de Ruskin, la seconde étant « Des Jardins des Reines »), son traducteur a voulu mettre à part les « charmantes lectures de l’enfance » avant d’exprimer son désaccord avec Ruskin sur « le rôle prépondérant » de la lecture dans la vie, ainsi qu’avec les mots de Descartes : « la lecture de tous les bons livres est comme une conversation avec les plus honnêtes gens des siècles passés qui en ont été les auteurs. » Et Proust de développer en quoi « la lecture ne saurait être ainsi assimilée à une conversation » puisque le lecteur reste seul pour recevoir « communication d’une autre pensée » ou ressentir « l’ivresse » d’une belle phrase comme quelques-unes qu’il aimait dans Le Capitaine Fracasse de Théophile Gautier.
« Et c’est là en effet un des grands et merveilleux caractères des beaux livres (et qui nous fera comprendre le rôle à la fois essentiel et limité que la lecture peut jouer dans notre vie spirituelle) que pour l’auteur ils pourraient s’appeler « Conclusions » et pour le lecteur « Incitations ». Nous sentons très bien que notre sagesse commence où celle de l’auteur finit, et nous voudrions qu’il nous donnât des réponses, quand tout ce qu’il peut faire est de nous donner des désirs. Et ces désirs, il ne peut les éveiller en nous qu’en nous faisant contempler la beauté suprême à laquelle le dernier effort de son art lui a permis d’atteindre. »
Quelle clarté dans l’analyse d’un Marcel Proust, à quelque trente-cinq ans : « La lecture est au seuil de la vie spirituelle ; elle peut nous y introduire : elle ne la constitue pas. » La lecture est pour lui « une amitié » sincère et désintéressée, qui n’a rien à voir avec les politesses et manières des relations de sympathie. « Avec les livres, pas d’amabilité. Ces amis-là, si nous passons la soirée avec eux, c’est vraiment que nous en avons envie. »
A la recherche de ce que j’ai souligné dans mon vieil exemplaire des Journées de lecture (en 10/18), je trouve ceci : « La puissance de notre sensibilité et de notre intelligence, nous ne pouvons la développer qu’en nous-mêmes, dans les profondeurs de notre vie spirituelle. Mais c’est dans ce contact avec les autres esprits qu’est la lecture, que se fait l’éducation des « façons » de l’esprit. » L’écrivain plaide aussi pour la lecture des grands auteurs du passé et en donne des exemples.
Quant à la fin du texte, après une dernière explication de « cette prédilection des grands esprits pour les ouvrages anciens », Proust y décrit de manière éminemment poétique – sur le thème du Temps qu’il développera dans la Recherche – les deux colonnes qu’on peut contempler à Venise sur la Piazzetta, « double élan léger de granit rose » : « Tout autour, les jours actuels, les jours que nous vivons circulent, se pressent en bourdonnant autour des colonnes, mais là brusquement s’arrêtent, fuient comme des abeilles repoussées ; car elles ne sont pas dans le présent, ces hautes et fines enclaves du passé, mais dans un autre temps où il est interdit au présent de pénétrer. »