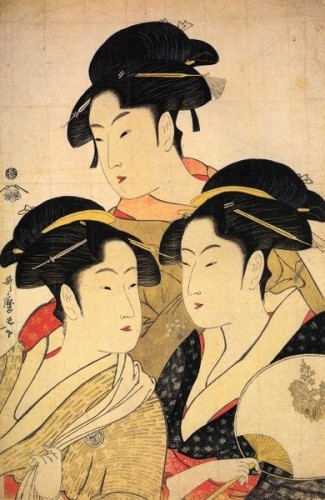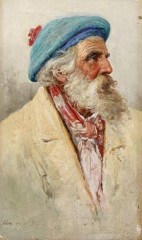Publié en 1980, Le passage de Vénus a révélé la romancière australienne Shirley Hazzard. La traduction française par Claude Demanuelli date de 2007. S’il s’ouvre sur l’arrivée de l’astronome Ted Tice chez le professeur Sefton Thrale, un été, dans le sud de l’Angleterre, quelques années après la deuxième guerre – sa mission est de l’aider à choisir l’emplacement idéal d’un nouveau télescope –, le roman commence lorsque Ted rencontre dans la maison de son hôte Caroline Bell, une jeune femme aussi brune que sa sœur est blonde.
Grace Bell est fiancée au fils Thrale, Christian, un parti inespéré pour cette Australienne venue tenter sa chance en Anglerre avec Caro et leur demi-sœur Dora, à la suite d’une infortune familiale. Ce n’est pas à sa beauté ni à ses gestes parfaits que Caro doit d’être « élevée au rang d’enfant de Vénus », mais au passage de la planète Vénus devant le soleil en juin 1769, raison pour laquelle James Cook a mis le cap sur l’Australie, comptant observer le phénomène en route, à Tahiti – voilà le genre d’anecdote prisé par le professeur Thrale. Ted, auprès de lui, se sent traité en « domestique de haut rang », toléré parce qu’il le faut, un peu agaçant par ses compétences indéniables.

Pour les Thrale, la situation des deux soeurs laisse à désirer : l’aînée, tout en préparant un concours dans l’administration, travaille dans une librairie, Grace au service des réclamations chez Harrods. Christian Thrale a choisi cette dernière, gracieuse et soumise – « Caro, elle, dépassait ses moyens, c’était une évidence. » Ted Tice emmène Caroline Bell visiter une grande maison où il a vécu, enfant, pendant le Blitz. La visite guidée intéresse moins l’homme aux cheveux roux que la belle Caro en robe bleue. Il l’écoute raconter l’Australie, où, dit-elle, on ne connaissait le vert qu’à travers les livres et la poésie : « on croyait aux saisons humides, caduques et disciplinées de la littérature anglaise, au velours émeraude des pelouses ou à des fleurs qui, en Australie, ne pouvaient pousser qu’une fois la sécheresse finie et la terre fertilisée. » Tice lui parle de ce qu’il a vécu à la guerre, d’Hiroshima, de sa vie à l’université – et même d’un secret qu’il n’a confié à personne d’autre. Caro, qui lit beaucoup, est heureuse de parler avec lui, mais Ted mesure vite à quel point elle se tient éloignée de l’amour fou qu’il a d’emblée ressenti pour elle.
Paul Ivory, bien plus séduisant que lui, confirme cette intuition lorsqu’il apparaît avec « son beau visage clair d’homme comblé ». Le fils du poète Rex Ivory s’est déjà fait un nom au théâtre, il est fiancé à Tertia, la fille d’un Lord propriétaire du château voisin. « Jeune homme charmant et vraiment béni des dieux », aux dires de Mrs Thrale, il a « un grand avenir devant lui » selon Sefton Thrale lui-même, aux opinions rarement contestées – « Paul éclairait l’atmosphère, autant que Ted l’assombrissait. » Avant de partir, celui-ci ouvre son cœur à Caro. Pour elle, après des années à subir l’exigeante et toujours insatisfaite Dora, « être enfin libre compte beaucoup ». Paul Ivory, lui, malgré Tertia, séduit Caro avec l’aisance qui le caractérise : « Les femmes ont une aptitude à la solitude, mais ne veulent pas être seules. Les hommes, eux, désirent la solitude, et ils en ont besoin, mais la chair ne tarde pas à les faire se comporter comme des idiots. » Au milieu des mégalithes d’Avebury Circle, que Caro a voulu voir parce que Ted lui en avait parlé, Paul l’embrasse, et la suite est inévitable.
A la fin de la première partie, « L’Ancien Monde », les cartes sont distribuées. Ted écrit régulièrement à Caro, qui retrouve Paul au théâtre, un soir, à Londres. Grace a choisi la sécurité ; elle, la passion. Leur liaison dure jusqu’à ce que Tertia se retrouve enceinte. Quand Paul s’éloigne, Caro garde cette « maîtrise de soi » qui subjugue les autres, mais elle se consume. Il y aura pourtant une vie sans Paul, un emploi au ministère, d’autres rencontres. Le destin de Caroline Bell se veut aussi intense que la lumière d’une étoile, sans demi-mesure. Elle se reconstruira dans « Le Nouveau Monde », troisième et avant-dernière partie de la passionnante intrigue de Shirley Hazzard. Des années quarante aux années septante, d’un continent à l’autre, c’est surtout Caro que l’on suit, son désir d’une joie véritable et partagée, un parcours dont Ted Tice reste le premier témoin.
Le passage de Vénus ne se réduit pas aux péripéties sentimentales. Les dialogues sont vifs, les échanges sur la beauté, l’état du monde, la littérature, la société, l’art, la vérité et le mensonge s’inscrivent avec fluidité dans le récit. La romancière a une façon particulière de peindre les paysages, les intérieurs, les caractères par petites touches – surtout visuelles, souvent allusives. Femmes et hommes tâchent de se frayer dans le mouvement des jours, des années, une voie personnelle, entre heures sombres et heures claires. Comme nous tous.