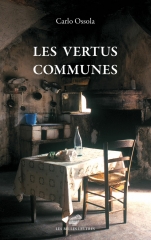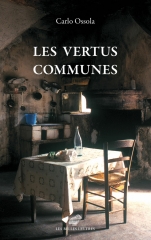VIII. « En raison d’une grève du métro, je suis en retard à un rendez-vous avec le Prix Nobel de physique Pierre-Gilles de Gennes ; je frappe à la porte de son bureau, entre et m’excuse, essoufflé. « Vous n’avez pas à vous excuser ; c’est plutôt moi qui dois vous remercier de n’avoir pas interrompu le fil d’une démonstration. Asseyez-vous donc » (urbanitas : modération et retenue…). »

“Cyrano de Bergerac” d’Edmond Rostand par Denis Podalydès pour la Comédie-Française, 2017 (source).
Le chapitre de l’urbanité s’ouvre sur cette anecdote avant de présenter la « vertu de l’adoucissement ». La scène illustre parfaitement l’étymologie de cette vertu – « qualité de ce qui est de la ville ; urbanité, bon ton, politesse de mœurs ; langage spirituel, esprit » (TLF) – qu’on voudrait pratiquée par davantage de citadins.
Carlo Ossola y fait allusion en terminant le chapitre VIII par le rappel d’une réplique bien connue et pleine d’esprit. « Et pourtant, sans urbanité, comment pourrions-nous supporter l’arrogante insolence qui nous assaille de toutes parts ? Le journaliste Nicolas Domenach raconte que Jacques Chirac, insulté à Bormes-les-Mimosas par un contestateur qui l’avait traité de « connard », avait souri en lui répliquant, à l’instar de Cyrano* d’Edmond Rostand : « Enchanté, moi c’est Chirac ! »… »
Carlo Ossola, Les vertus communes
*La référence en note de bas de page m’a permis de facilement retrouver la source, dans l’Acte I, scène 4 de Cyrano de Bergerac :
Le vicomte.
Maraud, faquin, butor de pied plat ridicule !
Cyrano, ôtant son chapeau et saluant comme si le vicomte venait de se présenter.
Ah ?… Et moi, Cyrano-Savinien-Hercule
De Bergerac.
(Rires.)