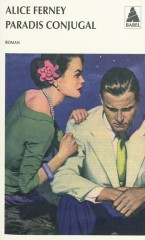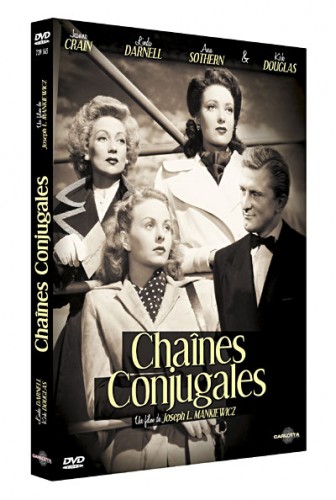Si Yann-Arthus Bertrand ne se lasse pas de nous montrer La terre vue du ciel, le ciel vu de la terre inspire naturellement les photographes, artistes ou amateurs. Dans l’amphithéâtre de la Bibliothèque Sésame, une exposition en témoigne : « Schaerbeek à ciels ouverts », visible tout l’été jusqu’au 20 septembre prochain.
C’est en découvrant la plate-forme au dixième étage de la Résidence Bel-Air (boulevard Lambermont) que Philippe Massart a trouvé son bonheur de photographe. Il en a fait son nid d’aigle : « Le citadin passionné par les grands horizons est un être souvent frustré… Des immeubles, des poteaux, des arbres ou des câbles, il y a toujours un obstacle qui empêche de voir le ciel grand ouvert. » Là, enfin, une vue dégagée.
Ses photos, prises durant ces dernières années, montrent « Les quatre saisons du ciel au-dessus des toits de Schaerbeek ». Le choix d’une ligne d’horizon très basse réduit le plus souvent la ville aux silhouettes des maisons et des immeubles. Les cheminées, les tours, les clochers des églises, tout ce qui « dépasse » permet aux Bruxellois de reconnaître la direction prise par l’objectif.
Mais le ciel constitue le champ essentiel à contempler. Le lever et le coucher du soleil offrent les couleurs les plus somptueuses, allument les nuages, révèlent le grillage des stries laissées par les avions qui survolent Bruxelles. On y parcourt toute la gamme des couleurs chaudes, entre autres dans un magnifique ciel pommelé – presque exotique. Sur une photo de jour, un panache de fumée monte à l’assaut de l’azur. En regardant attentivement ce qui se dessine là-dessous, on distingue d’une photo à l’autre le dôme de l’Eglise Royale Sainte-Marie, la tour Reyers, le Brusilia, l’Atomium, la flèche de l’église de Laeken…
Allez-y faire un tour, l’entrée est libre, vous ne le regretterez pas. Ne manquez pas cette photographie de l’hiver 2010, avec ses jolies maisons sous la neige dans l’arrondi d’une grande avenue. Elles attirent en premier lieu le regard, mais derrière elles se profilent les gratte-ciel du quartier Nord – une image significative du passage des quartiers « à taille humaine » à la ville contemporaine, qui vise toujours plus haut, comme on vient de l’apprendre avec le feu vert accordé par la Ville de Bruxelles à la future Tour Premium le long du canal, une tour de 42 étages culminant à 140 mètres de hauteur.
D’autres photos de Philippe Massart complètent cette exposition, à la Bibliothèque Mille et une pages, place de la Reine. Internautes, vous pouvez explorer les galeries photos de Philmass, amoureux des paysages d’Irlande ou de Provence, randonneur des villes et des montagnes, ami des arbres et des nuages en Belgique ou ailleurs.
« Il y a de ces jours où l'on ne peut que rester sans voix en admirant le ciel s'allumer et se transformer en peinture », écrit-il.