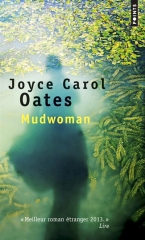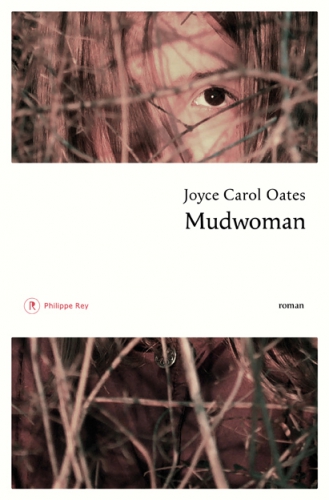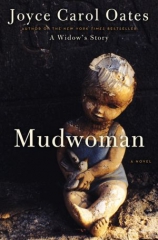Premier roman de Mathilde Alet, Franco-belge née à Toulouse en 1979, Mon lapin raconte les adieux de Gabrielle à son grand-père, Papy Louis, le jour de son enterrement. Malgré l’insistance de ses deux filles, il avait été « hors de question d’aller s’enterrer dans un mouroir bourré de vieux » et il avait pu se faire aider à domicile grâce à l’association « Vieillir chez soi ».

Firmin Baes (1874-1943), Jeune fille pensive
Quand elle allait le voir, Gabrielle logeait dans la chambre rose préparée par la femme de ménage, et sortait le promener dans sa chaise roulante, comme Marc les autres jours, un jeune homme qui lui faisait aussi la lecture. Dans leurs conversations ordinaires où les mêmes questions étaient reposées à chaque fois, surgissait régulièrement le nom de sa grand-mère, Elisabeth, dont Papy Louis parlait « comme si elle était morte l’année dernière ».
Gabrielle – c’est elle qui raconte, à la première personne – a du mal à imaginer sa mère Olympe et sa tante Victoire en petites filles emmenées par Elisabeth au Jardin des Plantes, elle écoute son grand-père les évoquer, elle imagine, elle s’arrête – « On marche encore un peu, mon lapin ? »
L’enterrement a déjà commencé quand elle arrive, en retard à cause du train, mais sa sœur Clara la rassure, « ça vient juste de commencer ». Son grand-père ne voulait pas de discours. « Moi j’ai envie d’émotions déclamées, de sanglots, de poèmes, de marches funèbres, de Beethoven, de Mozart, de youyous. Allez, mon lapin, arrête de dire des bêtises et écoute un peu. »
De l’église au cimetière, du cimetière au restaurant, on fait plus ample connaissance avec la famille. La tante Victoire, « une artiste » qui enseigne dans une école d’art, expose des photographies, intrigue Gabrielle par ses apartés avec une inconnue qui ressemble fort à sa grand-mère, dont la mort à 47 ans reste un mystère – un suicide ? – sur lequel elle aimerait connaître la vérité. Et puis, il y a ses proches, si prévisibles : Olympe et Michel, ses parents, sa sœur aînée Clara, son éternelle complice et rivale en même temps.
« Ma ville natale, c’est l’appartement de Papy Louis. » Marc, qui s’était attaché au vieux monsieur, l’a entendu raconter bien des choses sur ses petites-filles et en sait plus sur Gabrielle qu’elle à son propos. Ils font connaissance le jour de l’enterrement. Sera-ce lui, la surprise de cette journée ?
Mon lapin, un récit d’une centaine de pages, se lit très facilement : de petites scènes ordinaires, des souvenirs, écrits avec naturel, rien de forcé, de théâtral, juste la vie et les gens, les émotions, les doutes, les questions qu’on se pose mais qu’on ne pose pas. Un enterrement, c’est comme un bilan de famille, pas gai, mais pas si triste qu’on l’avait craint. Un enterrement, c’est un retour sur soi.