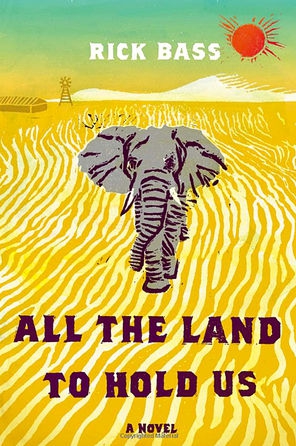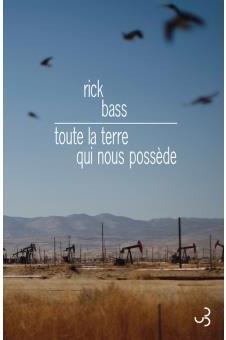Samedi dernier, la neige est tombée sans discontinuer, et le lendemain, le soleil, en s’accrochant à ses mille paillettes, a révélé la ville métamorphosée : toits blancs, ourlets cotonneux sur les arbres, perles d’eau gelée. A quoi ressemblait le parc Josaphat sous la neige ? Allons-y voir.
Rares étaient ceux qui avaient pris la peine de dégager un passage sur les trottoirs verglacés. Traverser les rues n’est pas non plus sans piège quand la température reste négative, et même dans le parc, il fallait éviter les glissades – sauf pour le plaisir, évidemment. Mais quel décor !
Comme toujours, quand je marche face au soleil, j’admire les contre-jours, si difficiles à rendre en photo. C’est dimanche, il y a bien sûr des amateurs pour descendre en luge sur les pelouses enneigées avec de grands cris d’excitation. D’autres restent immobiles au soleil, regardent, s’imprègnent, méditent. Ou téléphonent, figés, sans voir le chien qui trépigne.
Un pinceau d’artiste a souligné de blanc certaines branches, posé de petits points sur les plus fins rameaux, on a l’impression de se promener dans un de ces paysages d’hiver idylliques des cartes de vœux.
Les statues du parc souvent maltraitées par les tagueurs – ou pire, ici aussi, parfois, on décapite – retiennent la neige çà et là, et c’est du plus bel effet. Eve et le serpent semblent paisibles, une mère réchauffe son bébé contre elle.
Pas question aujourd’hui de marcher pour marcher, il y a trop à découvrir : en haut, où les cimes des arbres sont parées ; en bas, vers le ballet des herbes immaculées.
Plus loin, on va à la pêche aux reflets. Oh le joli chapeau pointu du kiosque ! Les canards semblent à l’aise sur l’étang où quelqu’un a rapidement tracé des zigzags à l’encre de Chine.
Le parc Josaphat, si romantique, cache sa mélancolie en des coins plus sombres, mais là où il arrive à se frayer un chemin, le soleil joue à l’éclairagiste de théâtre, égaie même un saule pleureur.
Un vrai temps d’hiver, un dimanche de vacances, de la neige au parc, profitons-en : c’est la trêve des confiseurs et pour les promeneurs, un plaisir rare.
*
* * *
* * *
* * * * * * * * * *
* * *
* * *
*
Bonne et heureuse année riche en lectures, balades, expos
&
au plaisir de vous retrouver dans la blogosphère !
Tania