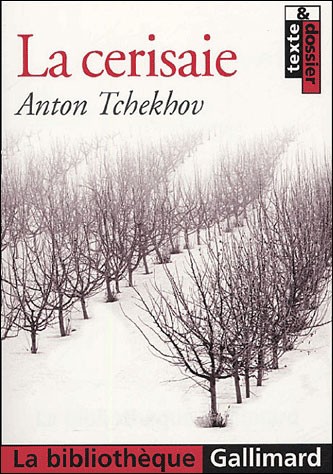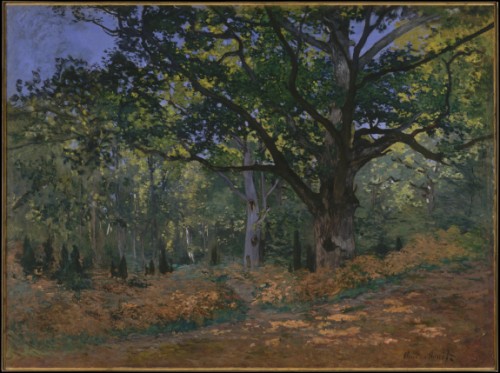Prix Goncourt des Lycéens 2008, Un brillant avenir de Catherine Cusset déroule la vie d’Elena-Helen, une petite Roumaine devenue citoyenne américaine. Fille, amante, épouse et mère, veuve (ce sont les quatre parties), un portrait éclaté puisque le récit change de période à chaque chapitre, de 1941, « La petite fille de Bessarabie », à 2006, « Demain, Camille » (sa petite-fille).
A quoi tend cette fragmentation ? Le refus de la chronologie est dans l’esprit du temps, « qui n’est parfois que la mode du temps » (Yourcenar), les professeurs d’histoire ou d’histoire littéraire ont depuis belle lurette été priés d’y renoncer dans l’enseignement secondaire pour des raisons qui ne m’ont jamais totalement convaincue. Dans la littérature contemporaine, le facettage de l’intrigue tient parfois davantage à la mise en forme du texte qu’à une nécessité interne. Ici Catherine Cusset se place sous l'égide de Sebald : « J’ai de plus en plus l’impression que le temps n’existe absolument pas, qu’au contraire il n’y a que des espaces imbriqués les uns dans les autres… »
C’est donc par épisodes et dans le désordre que nous est raconté le destin particulier d’une femme que l’on pourrait justement caractériser par la volonté de se construire un destin, pour elle d’abord, puis pour son fils, avec Jacob, le séduisant jeune homme aux cheveux noirs et à la peau mate qu'elle a épousé contre l’avis de ses parents antisémites. Un brillant avenir commence par la mort dramatique de ce mari, atteint de la maladie d’Alzheimer, avant de remonter à l’enfance de la petite Elena, « Lenoush », fuyant un pays bientôt occupé par les Soviétiques avec son oncle et sa tante. C’est le premier d’une longue série de voyages et de déménagements, d’abord avec ceux-ci qui deviendront ses parents adoptifs, Elena portera désormais le nom de Tiburescu.
A New-York, elle s’appelle Helen Tibb, et quand à la fin des années quatre-vingts, son fils Alexandru lui annonce au téléphone qu’il pense venir chez elle le lendemain, « avec quelqu’un », elle se réjouit en espérant que cette fois, à vingt-six ans, il a rencontré la femme de sa vie. Marie est française, a priori un bon point aux yeux d’Helen qui a appris le français en Roumanie, mais aussi une crainte : la jeune femme conçoit sans doute sa vie en Europe, or Helen et Jacob ont choisi de vivre aux Etats-Unis pour être libres, pour échapper aux préjugés concernant les juifs, pour fuir la dictature de Ceaucescu. En France, avec son accent, leur fils n’aurait accès qu’à des emplois subalternes, loin du « brillant avenir » dont ils rêvent pour lui.
Mais Marie et Alex s’aiment vraiment et comptent vivre aux Etats-Unis. Comme Elena et Jacob ont tenu bon malgré l’hostilité des parents, eux aussi se marient sans leur approbation. Helen est nommée vice-présidente dans la société d’informatique qui l’emploie. La réussite professionnelle et la réussite familiale, voilà ce qui compte avant tout à ses yeux. Son père l’avait envoyée dans un lycée technique pour qu’elle puisse vivre en femme indépendante et elle est devenue experte en physique nucléaire. Hors de Roumanie, elle s’est tournée vers une autre voie prometteuse.
Intelligente et volontaire, Helen se montre aussi possessive et autoritaire, Catherine Cusset en fait une belle-mère maladroite, peu affectueuse. La romancière entremêle l’histoire des deux couples, celui d’Helen et de Jacob bâti sur une fidélité sans faille, celui d’Alex et de Marie formé sur des bases et dans un contexte très différents. Mais Un brillant avenir est surtout l’évocation d’un destin de femme dans la seconde moitié du XXe siècle, avec ses choix et ses peurs, sa réussite et ses faiblesses, et la part la plus attachante d’Helen se révèle dans sa confrontation avec Marie, la femme de son fils, si différente d’elle, avec qui elle a tant de mal à s’entendre.
L’intérêt du roman naît de ces caractères, et surtout de leur évolution à travers plusieurs époques et d’un continent à l’autre. Le style de Catherine Cusset, assez sec, et la fragmentation du récit – propice aux rapprochements mais fastidieuse – m’ont tenue un peu à distance de cette « bouleversante saga ». Un brillant avenir est néanmoins un roman cosmopolite ambitieux, qui offre à ses lecteurs plus d’un éclairage sur les réalités de notre temps.