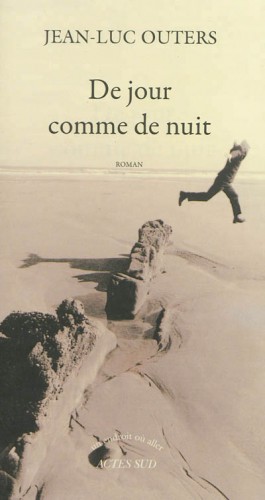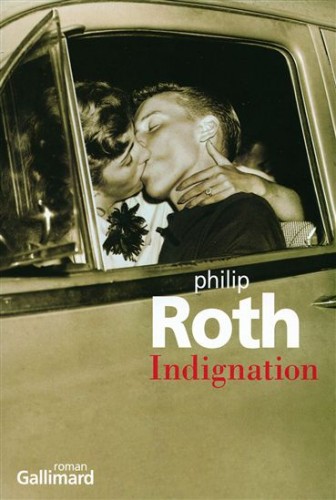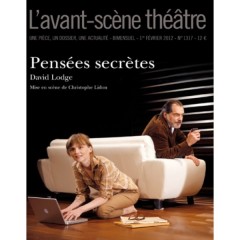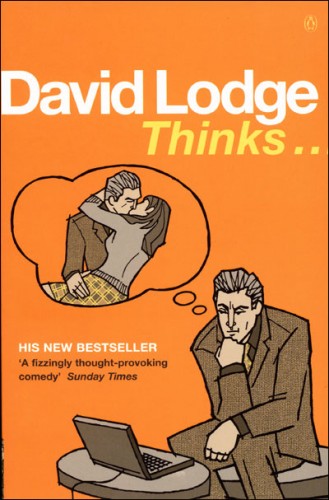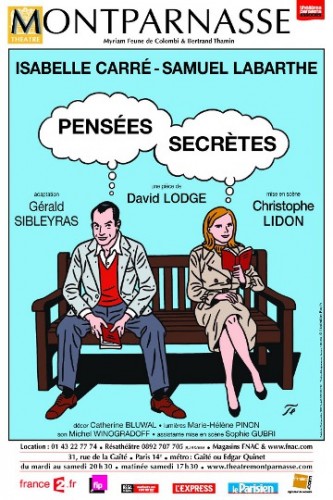Des amitiés, une époque, des doutes, des rêves, des débuts… Voilà ce que conte Jean-Luc Outers dans son dernier roman, De jour comme de nuit (2013). Trois personnages principaux, à la fin des années soixante : Hyppolite, inscrit en droit à l’université de Bruxelles « puisque le droit, lui avait-on dit, pouvait mener à tout. » César, qui a choisi Sciences-Po pour la même raison. Juliette, à trente kilomètres de là, inscrite en psychologie à Louvain (avant que les francophones, chassés par les flamands, ne déménagent à Louvain-la-Neuve).
« Les études sont une suspension du temps entre l’enfance et l’âge adulte, un moment différé avant de plonger dans le bain définitif de la vie. » Outers situe d’abord ces trois jeunes en rupture dans leur famille. Les parents de Juliette s’inquiètent de sa vie loin d’eux et hors des sentiers battus – depuis que le jour de ses seize ans, elle a refusé net le collier de perles que lui offrait son père joaillier. Hippolyte déteste le conformisme de son père, un parlementaire. Les parents de César, fils unique, ont recomposé une famille, chacun de leur côté, après leur divorce.
Lui, rebelle, en profite pour vivre à sa guise et se retrouve régulièrement au poste de police. Il disparaît tout un temps avant que ses parents ne reçoivent une carte du Chiapas (Mexique), où les Indiens se rebellent contre le gouvernement – leur fils, un apprenti-terroriste ? Juliette, tombée amoureuse de Marco, est si impatiente de « foutre le camp » qu’elle va jusqu’à l’accompagner pour un casse de la bijouterie paternelle, mais se ravise en dernière minute. Quant à Hippolyte, il souffre de dépression chronique et ne sort de sa léthargie que lorsque Zoé, une de ses soupirantes, s’impose. Ou quand, en octobre 1968, il écoute Jessie Owens aux J.O. dénoncer l’oppression des noirs au micro d’un reporter blanc.
Juliette aménage une « maison de poupée » au Grand Béguinage de Louvain, et se sent vite chez elle dans la ville universitaire où tout est accessible à pied. Elle y tombe sous le charme de Rodrigo, un étudiant chilien. C’est à une manifestation contre Franco que nos trois étudiants font connaissance au commissariat, embarqués après le caillassage d’une banque espagnole à Bruxelles. César, connu de la police, y est retenu. Juliette et Hippolyte, qui vomissent toute forme d’injustice, se joignent au comité pour sa libération.
Quand Juliette, enceinte de Rodrigo rentré au Chili pour aider la Révolution, se retrouve sans nouvelles de lui après le coup d’Etat, elle peut compter sur le soutien de César et Hippolyte. Tous deux prennent soin du bébé quand Marie vient au monde. Pour son mémoire sur le décrochage scolaire, Juliette rencontre une directrice d’école et assiste à un entretien décourageant à propos d’un garçon qui n’arrive pas encore à lire à onze ans, et dont plus aucun établissement ne veut, au désespoir de sa mère.
L’été, ils partent tous les trois en 4L avec Marie pour Lisbonne. César l’imprévisible, enthousiasmé par la Révolution des œillets, finit par s’en aller de son côté. Quand ils se retrouvent à Bruxelles, après leurs études, Juliette les persuade de travailler avec elle à son projet : « créer une école pour adolescents dont les écoles ne voulaient plus ». La suite du roman y est consacrée, on assistera à l’ouverture de « l’école des Sept-Lieues » et on retiendra son souffle avec ses concepteurs et leurs premiers élèves.
De jour comme de nuit (cette école exige une « présence ininterrompue ») restitue le contexte politique et social des années 1970 et le parcours des trois étudiants. C’est raconté avec détachement, sans fioritures – le roman perd un peu en émotion ce qu’il gagne en réalisme. On y reconnait les réflexions d’Hypothèse d’Ecole et les fondements du Snark (dans la réalité, c’est le nom de l’animal imaginaire de Lewis Carroll qui a été retenu). Outers, né en 1949, a puisé dans sa propre expérience pour écrire ce récit de fiction. C’est juste, fidèle, mais il y manque un je ne sais quoi, effet du style sans doute, qui rende ses personnages plus attachants, dans leurs désarrois comme dans leur désir généreux de rendre le monde meilleur.