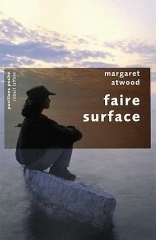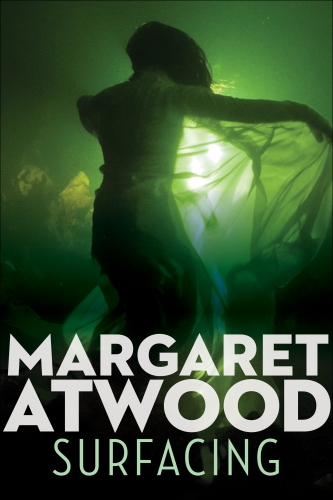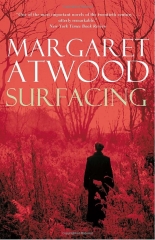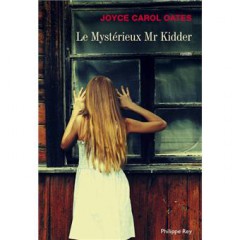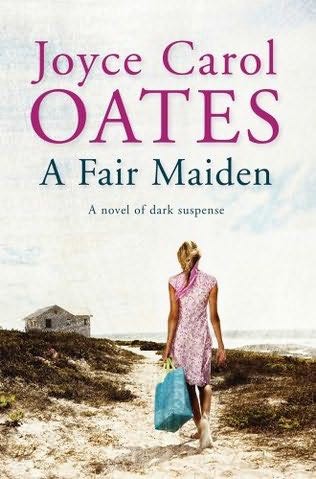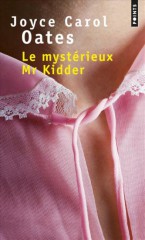Que vous dire de Todos lo saben (Everybody Knows), le dernier film d’Asghar Farhadi dont les médias, la presse ont déjà tant parlé ? C’est « son second film hors d’Iran après Le Passé » (Wikipedia) qui a fait l’ouverture du Festival de Cannes 2018. Un film à voir pour ses acteurs, l’excellent trio formé par Penélope Cruz, Javier Bardem (ci-dessous) et Ricardo Darín – un bon moment de cinéma.
Penélope Cruz joue Laura, la mère qui arrive avec son fils et sa fille Irene, au début du film, dans le village où sa jeune sœur va se marier. Toute la famille se rassemble dans la grande maison en partie hôtel, tenu par la sœur aînée. Le mari de Laura, resté en Argentine pour affaires, n’a pas pu l’accompagner. (L’acteur argentin Ricardo Darín qui apparaîtra plus tard dans le film est le mari de Penélope Cruz). Javier Bardem incarne un fascinant Paco, son amour de jeunesse, marié lui aussi.
On admire le rythme et les cadrages pour filmer ces préparatifs de mariage puis la cérémonie et la fiesta sans temps mort, tout en mouvement. Irene, adolescente rebelle, a tôt fait d’improviser une virée en moto avec son amoureux du village ou de grimper avec lui dans le clocher de l’église pour y tirer les cloches. C’est là qu’on entend pour la première fois le titre, quand son ami lui montre les initiales de Paco et de Laura, une histoire qu’elle ignorait – au village, « tout le monde le savait ». Mais sur quoi repose ce qu’on sait des autres, en réalité ?
La disparition d’Irene, le soir même du mariage, est le ressort principal de ce « thriller intimiste » (Le Soir). Des coupures de journaux laissées sur son lit, bientôt une demande de rançon et la menace du pire au cas où on avertirait la police, rappellent un autre enlèvement dans ce village, qui s’était mal terminé, ce qui redouble la tension. Très vite, il semble que les ravisseurs aient dû avoir un complice parmi les proches de Laura. L’absence de son mari, qu’on dit riche – il a versé de l’argent pour restaurer une partie de l’église –, alimente les rumeurs au sein de la famille.
Tout en veillant à garder la disparition d’Irene secrète, pour sa sécurité, la famille et les amis les plus proches envisagent toutes sortes d’hypothèses. Paco, l’ancien amoureux de Laura, viticulteur sur des terres qu’il lui a rachetées, est si bouleversé que sa femme en est jalouse, irritée de le voir se mêler de près aux recherches, tout faire pour soutenir celle qui l’a quittée un jour sans explications. Visiblement, il ne supporte pas de la voir tant souffrir.
Autour des protagonistes du drame, le réalisateur étoffe chacun des personnages secondaires. Une famille est comme un microcosme de la société, avec des réussites différentes, des rivalités, des rancœurs. La propriété, l’argent, le travail, l’alcool, les classes sociales, les générations, la générosité, l’envie, de nombreux thèmes s’invitent dans cette histoire où les apparences sont parfois trompeuses.
Ce film franco-iranien a été tourné à Torrelaguna, près de Madrid. Les paysages, certaines lumières sont superbes. En racontant à la manière d’un thriller cette histoire mélodramatique, Todos lo saben (Everybody Knows) exprime à l’écran la force des sentiments, le besoin de relations vraies et la manière singulière dont chacun réagit aux épreuves de la vie – « les personnages si humains d’Asghar Farhadi ne sont jamais d’un bloc » (Samuel Douhaire, Télérama).
Désolée de ne pouvoir répondre à vos commentaires pour l'instant, mais je les lirai avec plaisir. A bientôt.
Tania