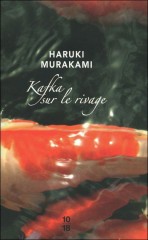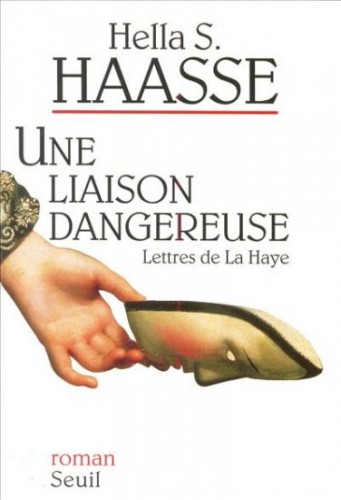Trouver le ton, faire entendre la voix singulière d’un personnage, c’est ce que réussit d’emblée Geneviève Damas dans Si tu passes la rivière (2011). Ce roman d’une centaine de pages donne la parole à François Sorrente, le plus jeune des fils de la ferme, qui garde les cochons – et les aime. « Si tu passes la rivière, si tu passes la rivière, a dit le père, tu ne remettras pas les pieds dans cette maison. » La menace a déjà été mise à exécution : Maryse, sa grande sœur, a filé de l’autre côté quand il était petit. Il ne l’a plus jamais revue. Son nom même n’est plus prononcé. Maryse manque à François qu’elle a si souvent rassuré, elle seule lui témoignait un peu d’affection : « Ça a été aux cochons aujourd’hui, Fifi ? »
A présent, il n’y a plus que le prêtre, Roger, à lui lancer de son vélo : « Ça va, François ? » Intrigué par le sac que l’homme porte toujours en bandoulière, François lui a un jour barré le passage pour savoir ce qu’il y avait dedans. Le curé en a sorti un livre d’images, il a bien compris que le gamin avait envie qu’on lui en lise l’histoire, une histoire pieuse, c’était mieux que rien.
« Mes frères, je n’en ai pas encore parlé. Jusqu’à présent, j’ai toujours dit les frères, comme s’ils formaient un lot, mais comment pourrais-tu savoir alors qu’ils sont deux si différents d’apparence, comme un grain de blé et un grain de seigle. » Jules a pris la place de Maryse à table, « il a la voix forte et les épaules qui vont avec. » Il s’occupe des machines, « ça le connaît. » François a reçu une taloche quand il a essayé de lui cacher Oscar, son cochon favori, mais Jules l’a saigné, « et le sang a commencé à battre » dans la tête de François - il a refusé d’en manger. Quelques mois plus tard, Jules lui a ramené un accordéon et François en a tiré « sa chanson de solitude et de liberté ».
Le deuxième frère, le blond, Arthur, « beau comme un taureau », vend les produits de la ferme au marché. En réalité, il est le quatrième. Maryse était l’aînée, Jean-Paul, le troisième, s’est tué en tombant du toit. Même s’ils sont différents, les frères de François parlent pareil : « Moins on parle, mieux ça vaut, si tu as quelque chose à dire, tais-toi, si tu es content, tais-toi, si tu as du chagrin, tais-toi. Tais-toi, tais-toi, tais-toi. »
Sa mère, François ne la connaît même pas en image, personne ne parle d’elle, même pas Maryse quand elle était encore là. Il a bien fouillé dans la chambre du père, un jour où il n’était pas là, mais il n’a trouvé que des photos des alentours de la maison, avec des fleurs partout, alors que son père n’en veut plus, et de l’autre côté de la rivière, une ferme, une grange, une étable, au lieu « des vieux murs brûlés qui branlent sans aucun toit dessus » dont personne ne lui a jamais raconté l’histoire.
Privé d’Oscar, son confident, François choisit un autre cochon pour l’amitié, cette fois en secret, ce sera « Hyménée », une truie de presque deux ans qu’il a baptisée ainsi en souvenir d’une autre dont Maryse lui avait parlé autrefois. Il lui parle, mais, à dix-sept ans, même si les siens le traitent comme un attardé, cela ne lui suffit plus. Roger, qui l’a bien compris, lui a dit qu’il pouvait lui raconter des tas d’autres histoires un jour, s’il voulait, et un soir il se décide, va gratter à son volet. Le prêtre, torse nu, passe la tête à la fenêtre : « Pas ce soir, je suis occupé. » Le lendemain, quand il y retourne, François se surprend lui-même en répondant, quand le curé lui demande le genre d’histoire qu’il voudrait : « Pour y aller de l’autre côté de l’eau, Roger. »
« J’ai dit ça, comme ça, pour me sortir d’un mauvais pas, et v’là que je me mettais dans un autre, à penser traverser la rivière, moi aussi, sans y prendre garde, contre la défense du père, et je me suis dit que les ennuis commençaient. » A l’indifférence, au silence, à la dureté, François préfère les mots de Roger, ou ceux de la vieille Lucie qu’il est allé chercher un jour où le père s’était senti mal, et que celui-ci a chassée de la maison parce qu’elle avait osé lui dire : « Tu dois lui dire la vérité, Jacques, sinon cela te poursuivra jusque dans la mort. »
François prend goût à s’éloigner de la ferme, à marcher dans les rues du village où il ne s’est rendu que rarement, comme pour l’enterrement de son frère. « Ce qui est bien, quand tu te promènes, c’est que parfois tu croises des gens, et alors ils te saluent, toi tu les salues, et c’est un peu comme si tu n’étais plus un inconnu. » Il parle avec la grosse Amélie qui étend son linge sur le côté de la maison et qui l’invite à boire un coup. Il pousse la grille du cimetière, où il y a tant de noms sur les pierres qu’il ne pourra jamais trouver la tombe de son frère, lui qui ne sait pas les déchiffrer. C’est encore vers Roger qu’il se tourne alors pour qu’il lui apprenne à lire : « Je n’ai pas peur. J’ai fini d’être un crétin. »
L’histoire que François voudrait qu’on lui raconte, c’est la sienne, celle de sa famille, celle de sa mère. Il veut savoir d’où il vient. Si tu passes la rivière est le récit d’une quête personnelle née d’une absence et de secrets trop longtemps gardés. Peu à peu, il va s’en rapprocher. Geneviève Damas nous fait littéralement entrer dans la tête et le cœur d’un garçon sensible qu’on traite comme un idiot et qui cherche son chemin à travers les mots. Après des nouvelles et des textes pour la jeunesse, en plus de son travail de théâtre, ce premier roman émouvant de la comédienne et metteuse en scène belge a remporté le prix Rossel 2011. Le monologue de François trouvera sans doute, un jour ou l’autre, on le lui souhaite, une voix de comédien pour le dire. Mais n’attendez pas pour aller à sa rencontre.