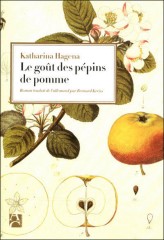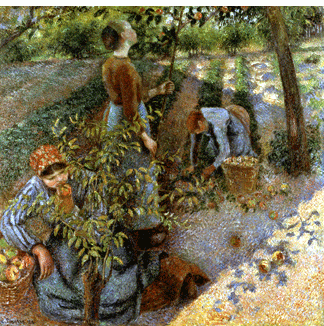Genève, place du Molard, deux heures du matin. Un jeune Anglais élégamment vêtu se déshabille, puis tombe évanoui comme une masse – il mourra plus tard à l’hôpital, empoisonné.
Louis Dominicé, un vieux professeur de psychologie, dit « le maître ».
Des mouches qui bourdonnent, des nuages d’insectes. Un paquet d’aiguilles.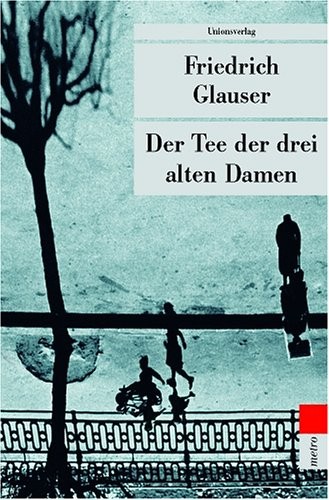
Le Dr Thévenoz, fiancé à une Américaine assistante en psycho, Madge Lemoyne, au physique de « madone expressionniste ».
Ronny, le chien de Madge, un airedale.
Le jeune assistant du Dr, Rosenstock, qui trouve que l’hyoscyamine ressemble à « un prénom de femme d’une pièce de Maeterlinck » (la jusquiame des sorcières). Il a deux frères et tombe amoureux de Natalia Kuligina, « incarnation de la Russie éternelle » ou agente quatre-vingt-trois, selon ses interlocuteurs.
Un commissaire à barbiche.
Sir Avindranath Eric Bose, inquiet pour son secrétaire (le mort).
Jane Pochon, « un ancien medium avec qui le maître a travaillé », collaboratrice de Dominicé.
Des bars et des hôtels cosmopolites.
Des hallucinations.
Baranoff, « une personnalité trouble ».
Le correspondant du journal Le Globe, O’Key, rappelé de Collioure où il passait ses vacances – « mais aussi collaborateur de l’Intelligence Service (ce que peu de gens savent) ». Irlandais aux cheveux « rouges », forcément.
Un procureur et sa riche épouse toujours en robe de soie violette.
Un conseiller d’Etat.
La mort d’un pharmacien, second empoisonnement du même type.
Une vieille écrivaine du nom d’Agnès Sorel, « d’une si monstrueuse laideur qu’elle en redevient belle, comme un bouledogue de race », l’une des « trois vieilles dames » qui boivent le thé ensemble.
Des projets de traité.
Un cours de psychologie très couru dans la plus grande salle de l’université.
Beaucoup de questions, quelques interrogatoires.
Un troisième décès suspect.
Mystères, manies et bizarreries.
Humour noir.
Atmosphère, atmosphère.
Pourquoi le professeur, spécialiste des poisons, était-il sorti dans la nuit ?
Où est passée la serviette de Crawley (le secrétaire anglais) ?
Qui se fait appeler George Whistler, dans la maison De la Rive ?
Qui mettra fin à cette série mortelle ? – « Comment dit Arsène Lupin déjà ? Seuls les idiots devinent ? Je ne devine pas, je combine. »

Illustration de Hannes Binder pour son livre Glauser Fieber © Hannes Binder
On devine le visage de l’écrivain Friedrich Glauser.
Friedrich Glauser (1896-1938), « le Simenon suisse » (son Maigret s’appelle Studer) vous invite dans la Genève des années vingt : c’est Le thé des trois vieilles dames, un roman policier traduit de l’allemand par Daniel Renaud. L’écrivain morphinomane – sa vie romanesque a inspiré un film, il a même été mineur à Charleroi – a donné son nom au Glauser-Preis, « Prix Goncourt » du meilleur roman policier en allemand.
« J’aimerais voir s’il est possible d’écrire des histoires sans sentimentalisme au sirop de framboise et sans rugissements sensationnalistes qui plaisent à mes camarades, les aides jardiniers, les maçons et leurs femmes, en bref, qui plaisent à la grande majorité. » (F. Glauser)