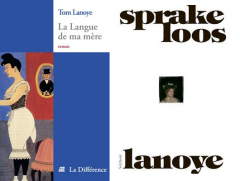Première œuvre de l’écrivain flamand Tom Lanoye traduite en français, La Langue de ma mère est un roman magistral, une des lectures les plus marquantes de cette année 2011 en ce qui me concerne. Je n’en suis pas encore sortie, je m’y suis plongée et replongée comme un poisson dans la Mer du Nord. « Digne successeur de Hugo Claus et de son célèbre Chagrin des Belges », peut-on lire en quatrième de couverture. Et comment !

Le sujet n’est pas facile, le récit est jubilatoire. Sprakeloos, le titre original, désigne le malheur qui frappe sa mère devenue aphasique à la suite d’une attaque cérébrale : « Elle a d’abord perdu la parole, ensuite la dignité, ensuite le battement de son cœur » - deux années infernales. A ceux qui n’aiment pas les écrits « qui reposent en grande partie sur la vérité et vous laissent imaginer les parties manquantes », à ceux qui refusent les incohérences, l’auteur lance un avertissement liminaire : « Alors le moment est déjà venu pour vous de fermer ce livre. Reposez-le sur la pile dans la librairie où vous vous trouvez, remettez-le entre les autres ouvrages sur l’étagère de votre club, de votre maison de retraite, de votre bibliothèque publique, du salon de vos amis ou de la maison que vous êtes venu cambrioler. Achetez autre chose, empruntez autre chose, volez autre chose. Et passez-vous de l’histoire de ma mère. »
Elle était la plus jeune des douze enfants Verbeke, « on pouvait se demander d’où étaient sorties soudain tant de beauté et d’élégance. » La plus fine, elle avait suivi un an de français à Dinant, à l’âge de seize ans, puis appris l’anglais à Northampton. La Belgique était alors florissante grâce à la corne d’abondance congolaise, à la bière et aux armes à feu. « Ons Joséeke, notre petite Josée » rêvait d’être avocate, et tous savaient dans la famille que « quand notre Joséeke a quelque chose derrière la tête, il vaut mieux s’écarter de son chemin. »
Et voilà Sint-Niklaas (Saint-Nicolas) en Flandre orientale, au moment de son lâcher annuel de montgolfières par-dessus le clocher de Notre-Dame, en langue populaire « Marie Dorée », puis l’antique prison devenue bibliothèque publique avant d’être transformée en lofts, ce qui réveille le souvenir de la brave bibliothécaire qui l’avait autorisé à lire des livres de la catégorie supérieure quand il n’en restait plus aucun en rapport avec son âge, à condition qu’il ne le dise à personne. La digression est longue, « mais c’est ainsi, c’est comme ça qu’on se rappelle les choses dans ma famille et dans ma région », continue Lanoye, et de nous parler des saules têtards (« kloefen » et non « klompen » comme en bon néerlandais), des canadas (peupliers), avant de revenir au potager où sa mère s’active en maillot noir à motifs blancs…
C’est qu’il lui est très difficile d’écrire ce livre, de faire son deuil : « votre cas est terriblement ordinaire, inévitablement banal, mais aussi effroyablement unique et incomparable ». En plus, il y a la pression de sa mère qui comptait sur lui pour écrire un jour à son sujet et méprisait ceux qui disent du mal de leurs parents. Contre son goût, elle avait mené une vie de bouchère, tout en jouant dans une troupe de théâtre amateur. « Quoique je vous livre ici, de quel ordre ou de quelle tonalité que ce soit, cela restera un noble mensonge, un fragment, un éclat du prisme qu’était sa vie. »
La première partie de La Langue de ma mère – LUI (ou : le récit du récit) – tourne autour de sa mère qui a fini sa vie en institution fermée, autour de sa propre enfance puis carrière en « paresseux farfelu » ou « acteur de théâtre manqué », du père installé tout près dans une maison de retraite et qui va y mourir paisiblement, en « polisson de quatre-vingt-huit ans » – « je suis foutu, je l’ai dans le baba, hu hu hu ! » Le fils comprend alors, c’est terrible à dire, que ce livre était impossible à écrire tant que son père, un homme magnifiquement généreux et patient, admirateur de Justine Henin, était en vie. Et aussi qu’écrire ce livre ne sera pas du tout un travail de conservation, mais au contraire de destruction, une manière de chasser le souvenir, de prendre congé de cette famille nombreuse installée dans une petite ville, dans une petite maison d’angle sans jardin où il avait sa chambre au-dessus du magasin loué à Dikke Liza, des voisins et des clients. Rien à faire des schémas préparés, se dit-il, mais être seulement « à l’affût du moment vif-argent », par exemple de ce dimanche de septembre ensoleillé où sa mère coupait les asperges au potager, tandis que son père dormait sous le parasol, la radio allumée à côté de lui.
ELLE (ou : frappée d’aphasie), récit du soir fatal. C’est la deuxième partie, l’essentielle, trois cents pages pour raconter comment vivait sa mère, comment elle avait arrangé sa maison, avec son bric-à-brac acheté en salle des ventes et ses objets préférés, jusqu’au soir fatal où « le regard vide, méconnaissable », elle saute à la gorge de son mari avec un cri de rage. De sa bouche sortent alors des bruits rauques, incompréhensibles. Plus jamais on n’entendra « ce magnifique et ininterrompu flot de paroles baroque et précis de jadis ».
A la retraite, les parents de Lanoye n’ont pas voulu déménager, préférant s’installer dans le logement exigu de leur ancienne propriétaire. Il se souvient d’y avoir tremblé d’impuissance sur les genoux de sa mère pourtant « forte en bec » en présence de la grosse Liza, harpie déplaisante avec ses locataires, même si Josée aidait la religieuse qui venait laver l’obèse de temps à autre. A sa mort, le père avait dû surenchérir contre les enfants de la propriétaire cherchant sans vergogne à tirer un maximum de leur héritage. Pour effacer le souvenir de Liza, la mère avait multiplié les aménagements, surchargé la décoration, obtenu contre l’avis de tous l’installation d’une salle de bain dans un réduit minuscule.
Après sa première attaque, quand il la retrouve aux soins intensifs, son fils revenu du Cap se sent coupable et parce qu’à chaque départ, elle lui faisait une scène, et parce qu’il a osé supposer encore « une intrigue grotesque de notre petit tyran ». Et surtout parce qu’en assistant à la terrible fin de sa sœur, Maria l’artiste, sa mère lui avait demandé de faire quelque chose pour elle si ça lui arrivait : « Laissez partir ». Il se passera encore deux ans avant sa mort. Deux années où les rôles sont inversés : Joséeke l’infirmière pleine d’attentions pour l’enfant malade, la reine du plat froid, l’actrice du Théâtre Municipal, la femme qui avait pour principe qu’il faut faire soi-même ce qu’on peut faire soi-même, « un Kladdaradatsch de scènes et d’images », est dorénavant celle qu’on soigne, qu’on nourrit, qu’on visite.
Revalidation, rechutes, souvenirs d’elle, du voisinage, de la kermesse sur la Chaussée d’Anvers, des courses cyclistes, tentatives de retour à la maison, mariage en pleine guerre, comptes, grand-père colombophile fier de la langue de Guido Gezelle et lecteur de La Libre Belgique en français… Lanoye nous saoule de ses souvenirs et de ceux de sa mère, qu’il dresse contre « l’inacceptable déchéance » de cette langue maternelle. Quand à vingt-deux ans, il décide d’enfin annoncer à ses parents qu’il est homosexuel (Quelle différence entre être pédé et être nègre ? – « Si vous êtes nègre, vous n’êtes pas obligé de le dire à vos parents »), la mort de son frère, le Plus Difficile et le Plus Populaire, change la donne. Sa mère est anéantie, sombre dans l’alcool et les tranquillisants. La scène de son « coming-out », des années plus tard, est à la fois comique et terrible, le fils et la mère s’y montrent impitoyables l’un envers l’autre.
Tom Lanoye veut tout dire des derniers mois, décrit « la fin d’un monde ». Dans MOI (ou : et maintenant ?), après les funérailles et un dernier questionnement sur le livre qu’il est en train d’écrire, « avant tout un livre du temps et des choses qui passent », il termine sur le « véritable adieu », les derniers instants, et l’engagement qu’il prend alors : lutter contre le silence par sa voix, contester le vide par la parole. « Ne plus jamais se taire, toujours écrire, plus jamais sans parole. Je commence. » Ne manquez pas La Langue de ma mère, livre de tendresse et de sarcasme où les mots sont à la fête, « magnifique et bouleversant chant d’amour » (Guy Duplat).