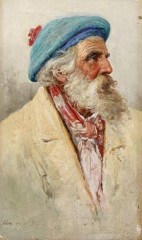Il y a des livres qui donnent envie d’écrire, de parler. D’autres de se taire, d’écouter. Ainsi Giacometti La rue d’un seul, de Tahar Ben Jelloun, suivi de Visite fantôme de l’atelier (2006). Gallimard a ceint l’essai d’une centaine de pages d’un bandeau blanc où, précédant Le Chat, L’homme qui marche suit Le chien, les trois bronzes aussi efflanqués l’un que l’autre, dans le même mouvement. Lisons.
« Il existe dans la médina de Fès une rue si étroite qu’on l’appelle « la rue d’un seul ». Elle est la ligne d’entrée du labyrinthe, longue et sombre. Les murs des maisons ont l’air de se toucher vers le haut. On peut passer d’une terrasse à l’autre sans effort. (…) En observant les statues de Giacometti, j’ai su qu’elles ont été faites, minces et longues, pour traverser cette rue et même s’y croiser sans peine. »
Solitude
« La solitude a un visage travaillé par des mains très humaines, ce visage n’est pas un masque, il est cette tête où vit un regard au bout d’une tige qui se donne comme un corps détaché de tout, avec des jambes si hautes, faites pour marcher éternellement jusqu’à rencontrer un autre visage dont l’expression est celle de la stupeur, une expression familière où les solitudes se reconnaissent sans se faire signe. C’est qu’elles proviennent toutes d’un même abîme, une blessure singulière, absolue, totale et sans la moindre compromission. Cela, c’est la beauté. Ce n’est ni l’harmonie, ni la régularité des traits et des humeurs, ni la complaisance à l’égard de la lumière et de l’apparence du bien-être. »
« Beckett m’a toujours fait penser à une sculpture de Giacometti qui se serait rebellée au point de lui échapper et de vivre hors de l’atelier ou du musée. »
Réel
« Depuis, que je sois dans le métro ou dans le train, que je sois dans la médina de Fès ou de Marrakech, je suis à la recherche d’autres statues de Giacometti qui auraient investi des corps vivants, des mémoires brûlantes, des visages hallucinés. »
« J’écris pour capter l’extrême limite du réel. Je ne peux pas faire autrement, car j’appartiens à un pays où la terre est enceinte de milliers d’histoires, où l’imaginaire du peuple est si riche, imprévisible, fantastique, qu’il suffit pour l’écrire de tendre l’oreille humblement et de savoir que le réalisme est impossible. Tout est fugitif. »
Regard
« Giacometti ne cherchait pas à « s’exprimer » quand il travaillait. (…) Dans une personne, il ne cherchait que le regard. Dans le regard, il cherchait à capter la détresse, même et surtout si elle est cachée. »
« Seul l’artiste qui ne sait pas où il va, ni à quoi ses mains vont aboutir, est digne d’être à la hauteur de la réalité. C’est par le regard que Giacometti ouvre une brèche dans l’âme du personnage. »
« « Un jour, je me suis vu dans la rue comme ça, j’étais chien », dit Giacometti à Genet. Le chien qu’il a sculpté ensuite est tous les chiens, il est le dernier chien arrêté devant une porte fermée ; il apparaît comme nous le voyons dans nos nuits de rêves ou de cauchemars. »
Silence
« Quand les statues de Giacometti marchent, elles ne font pas de bruit. Il faut une ouïe très fine pour entendre des pas glisser sur du sable. Le mouvement est à peine perceptible. Il faut s’arrêter et écouter un immense silence respirer. »
« Je ne sais pas si Giacometti a lu Cervantès, mais l’homme qui marche est un double silencieux de Don Quichotte, pour une fois livré à sa solitude et à ses méditations profondes. »
« C’est cela qui fait que face à l’œuvre de Giacometti on se sent rempli d’humilité. On est intimidé parce qu’un homme, à l’écart du monde, à l’écart de toute valeur marchande, a réussi à nous exprimer tous, en creusant la terre, en creusant le métal, et en se souvenant de la tragédie humaine, qu’elle soit immédiate – comme celle qu’il a vécue durant le nazisme – ou lointaine, et qui existe depuis que l’homme humilie l’homme. » (Tanger, août 1990)
Comme pour La rue d’un seul, à chaque page de Visite fantôme de l’atelier fait face une illustration – sculpture, peinture, photographie. Ben Jelloun a écrit ce texte à Paris en juin 2006, inspiré par l’atelier de Giacometti au 46 bis de la rue Hippolyte-Maindron dans le XIVe arrondissement. Loué en 1927 et occupé par le sculpteur jusqu’à sa mort, devenu l’atelier de Michel Bourbon. Un lieu exigu dont le sol en terre battue a été recouvert de ciment dur. Giacometti vivait avec sa femme Annette dans ce minuscule rez-de-chaussée, indifférent à tout confort.
Des êtres de bronze ou de plâtre qui en sont sortis, Ben Jelloun écrit : « Ils étaient vivants, c’est-à-dire vigilants et discrets. Je me sentais petit face à ces êtres filiformes qui prenaient le minimum d’espace pour une présence intimidante. » La rue des Giacometti, cette rue d’un seul, est la rue de tous.