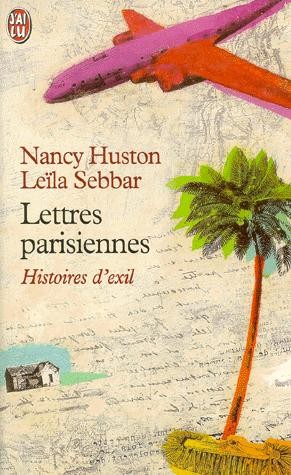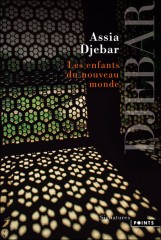C’est le fil des commentaires sur Assia Djebar qui a attiré mon attention sur la correspondance entre Nancy Huston et Leïla Sebbar : Lettres parisiennes. Histoires d’exil (en couverture) ou Autopsie de l’exil (sur la page de titre).
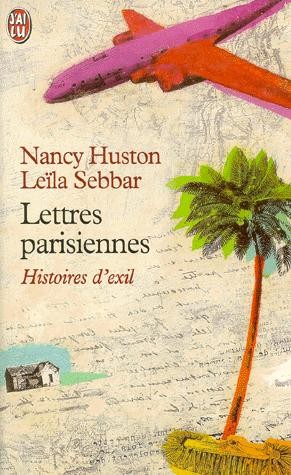
Ayant quitté le Canada pour l’une, l’Algérie pour l’autre, elles se sont rencontrées à Paris en contribuant à diverses publication féministes : Histoires d’elles, Sorcières, Les Cahiers du Grif. Elles se connaissent déjà depuis dix ans, « proches et à distance », quand elles décident de s’écrire, pour se parler de l’exil. Trente lettres envoyées de Paris le plus souvent, parfois d’ailleurs, qui vont les rapprocher. Du 11 mai 1983 au 7 janvier 1985.
Leïla Sebbar aime écrire dans une brasserie, un lieu de passage, sur des papiers de hasard, voire des bouts de nappe, qu’elle range ensuite dans son sac près des enveloppes, tickets, papiers divers conservés. « Je m’incruste dans ces lieux publics, anonymes… » Nancy Huston ne fait jamais cela, pour elle c’est un cliché de « l’Américaine à Paris », ce qu’elle n’est pas. Canadienne anglaise, elle a choisi l’exil volontaire et la double nationalité. Elle n’est pas non plus une « Française authentique » et parle de son accent comme d’une « friction entre (elle)-même et la société qui (l’)entoure ».
Nancy et Leïla s’expriment sur leur condition de femmes en exil et, indissociablement, de l’écriture qui en découle, pour l’une et l’autre. Nancy Huston a choisi d’écrire en français. Sa première réponse tapée à la machine choque Leïla Sebbar qui préfère l’encre verte habituelle des cartes postales de Nancy. Fille d’une mère française et d’un père algérien, tous deux instituteurs, elle tient beaucoup à son stylo, le même depuis dix ans : « la mobilité du stylo-plume me plaît infiniment. » Le français est sa langue maternelle, elle n’a jamais su l’arabe et pense même que, si elle avait su la langue du pays de son père, elle n’aurait pas écrit.
Chaque matin, Nancy quitte la maison de M. pour son studio dans le Marais, à un quart d’heure de marche, se plaît dans ce quartier. Un séjour en Amérique du Nord lui a donné la nausée des platitudes échangées là-bas, même si elle est triste de quitter parents et amis pour rentrer à Paris, sa ville d’élection, quitte à passer pour une femme têtue et sans cœur.
Leïla connaît bien cette « division » ; elle l’estime nécessaire, vitale, parce qu’elle crée le déséquilibre qui la fait exister, écrire. Elle n’a pas de lieu bien à elle, préfère l’espace public. Sa passion pour George Sand, pour Indiana en particulier, la rapproche de Nancy, « Canadienne berrichonne », qui va régulièrement dans la maison de campagne de M. située dans le Berry de Sand. Le français est sa « langue d’amour », écrit-elle.
De Cargèse en Corse, où elle ressent l’hostilité des autochtones envers les touristes français, Leïla raconte son amour non d’une ville mais d’un pays, la France. Elle connaît mal Paris, ne cherche pas à en savoir davantage sur la ville. D’Ardenais, Nancy dit les petites catastrophes du quotidien (une bouteille de cassis pleine cassée dans la cuisine) qui la font penser à Virginia Woolf. Ils sont sept dans la maison de campagne et elle y retrouve d’une certaine façon la maison familiale qu’elle a fuie. Il n’y a qu’avec son frère, indépendantiste, qu’elle parle en français.
De lettre en lettre, nous suivons ces deux indépendantes dans leur vie quotidienne, dans leurs déplacements, mais surtout nous en apprenons davantage sur leur passé et sur leur façon de vivre l’exil. Le père de Leïla Sebbar était un instituteur du bled, ce qui l’excluait du milieu des filles de colons à l’école. Apercevoir l’une d’elles, à Paris, qui ne l’a pas reconnue, la secoue tellement qu’il lui faut écrire cela à Nancy. Pour celle-ci, l’exclusion est plutôt liée à la religion, qui lui a été un temps un refuge ; ses parents étaient de religion différente et le remariage de son père avec une Allemande les amena à la religion anglicane, par compromis.
Leïla Sebbar évoque souvent des femmes passionnées, rebelles, elle conservait dans une farde intitulée « Institutrices, guerrières, putains » des documents sur les « aventurières de l’école, de la guerre, de l’amour ». Femmes souvent nomades, « déplacées ». Jeanne d’Arc l’a séduite, alors que Nancy Huston la voit comme un emblème du nationalisme et de la force militaire, et refuse l’héroïsme de la violence.
Les Lettres parisiennes sont une véritable correspondance entre deux femmes qui prennent aussi des nouvelles de leurs enfants (deux garçons pour Leïla, une fille pour Nancy, dont Leïla apprécie le prénom proche du sien, Léa). Leïla Sebbar aime enseigner, enseigner la protège de l’exil. Les questions des intellectuels qui la poussent constamment à se situer, le rejet des Arabes qui ne comprennent pas qu’avec son nom, elle ne parle pas l’arabe, tout cela renforce son sentiment d’exclusion, de non appartenance à un groupe ou une communauté.
Nancy Huston : « j’ai accepté d’habiter cette « terre » qu’est l’écriture, une terre qui est par définition, pour chacun de ses nombreux habitants, une île déserte. » Femmes écrivains, rencontres de hasard (souvent de comptoir, pour Leïla), familles, projets d’écriture, souvenirs, condition féminine… A travers de multiples thématiques, deux femmes de lettres et d’exil se disent et se questionnent. L’exil, se demande Nancy, n’est-ce pas finalement le fantasme qui fait écrire ? « Je ne subis pas l’écart, je le cherche. »