« Nous ne supportons plus le lierre qui nous étouffe, pensa-t-il, mais le jour vient où nous nous demandons si ce n’est pas le lierre qui soutient l’édifice de nos branches pourrissantes. »
Dawn Powell, Le Café Julien
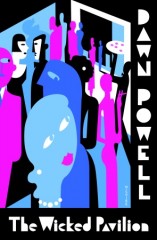
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.
« Nous ne supportons plus le lierre qui nous étouffe, pensa-t-il, mais le jour vient où nous nous demandons si ce n’est pas le lierre qui soutient l’édifice de nos branches pourrissantes. »
Dawn Powell, Le Café Julien
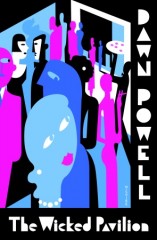
Si vous ignorez tout de la romancière américaine Dawn Powell (1896-1965), comme moi avant de lire Le Café Julien (The Wicked Pavilion, 1954), vous trouverez dans l’édition 10/18 une postface de Gore Vidal qui la présente et la défend contre les critiques qui ne lui ont pas donné sa place dans la littérature de son temps. Comme la plupart des personnages de son roman, elle a quitté la province pour tenter sa chance à New York. A Greenwich Village, où elle a passé toute sa vie, elle a fréquenté et observé le milieu des artistes fauchés et des riches mécènes qui inspire le cycle new-yorkais de son œuvre.
Le Café Julien est un lieu de rendez-vous branché : on y croise des gens intéressants, on s’y saoule de pernods ou de mazagrans, de rumeurs aussi. L’écrivain Dennis Orphen, un habitué, y écrit sans peine alors que dans sa chambre d’hôtel, rien ne sort de sa machine à écrire. Il connaît les habitudes des serveurs, ces « êtres orgueilleux, estimant que leur premier devoir était de protéger le café de ses clients », experts dans l’art de décourager les curieux.
Philippe, « le petit serveur replet aux allures de moine » a pris sous son aile le jeune Ricky Prescott qui s’évertue, chaque fois qu’il est à New York, à passer ses soirées au Julien dans l’espoir de revoir Ellenora Carsdale là où il l’a rencontrée la première fois. Sept ans avant cet hiver 1948, il est tombé amoureux et de la ville de ses rêves et de Greenwich Village et de cette fille d’artistes « incroyablement douée » avec qui le courant est passé tout de suite. Mais tandis que la standardiste annonce toutes les demi-heures un appel pour M. McGrew, Ellenora, elle, ne vient pas.
Dalzell Sloane, la cinquantaine, estime avoir échoué en amour et en art, mais il s’est laissé pousser la barbe. Il pense avec nostalgie à ses compagnons de peinture, Marius qui est mort, et Ben qui a disparu depuis des années. C’est un client de bistrot né, et quand il croise au Café Julien un grand gaillard nonchalant, qui se vante de sa forme physique à soixante ans, il le flatte volontiers, se présente, et se voit sollicité pour peindre son portrait, une aubaine. L’animation, ce soir-là, vient de la bande de Cynthia Earle, riche à millions, qu’accompagnent parasites et jeunes artistes qui offrent leur compagnie en échange de ses généreux chèques. Son ami expert en art, confie-t-elle à Sloane, est justement à sa recherche. La cote du peintre Marius ne cesse de grimper depuis sa mort, et il cherche à rencontrer ses anciens camarades dans l’espoir de retrouver quelques tableaux. Dalzell est plutôt écoeuré des éloges posthumes de Marius – de son vivant, sa grossièreté déplaisait à tout ce beau monde.
Pour compléter le tableau, voici Elsie Hookley, une riche Bostonienne qui s’amuse depuis des années à choquer sa famille, son frère Wharton en particulier, en s’encanaillant à New York. Elle s’est prise d’amitié pour Jerry, une jeune célibataire qu’elle veut lancer dans le monde. Initiée par elle, Mlle Delaine pourrait même faire un grand mariage – pourquoi pas avec McGrew, par exemple ? Jerry, ravie de profiter des largesses d’Elsie, comprendra que celle-ci a trop de comptes à régler avec la société dont elle est issue pour servir ses projets.
Il y a beaucoup de dialogues et de chassés-croisés dans Le Café Julien. Certains donnent des soirées, d’autres s’y invitent. Tout le monde veut réussir, sortir de l’anonymat. L’argent qu’on donne, l’argent qui manque, Dawn Powell en parle avec autant de précision que Balzac. Entre les hommes et les femmes, l’intérêt se mêle au désir, l’amour est rare. La comédie humaine, dans une version new-yorkaise des années 1940 pleine d’ironie et d’acuité.
« Le rapport particulier qui unit le récit au voyage tient précisément à cela, comme, peut-être, les raisons pour lesquelles il existe des liens si étroits entre l’écriture narrative et la marche. Ecrire, c’est ouvrir une route dans le territoire de l’imaginaire, ou repérer des éléments jusque-là passés inaperçus le long d’un itinéraire familier. Lire, c’est voyager sur ce territoire en acceptant l’auteur
pour guide – un guide avec qui nous ne serons pas forcément d’accord, dont nous nous méfierons au besoin, mais dont nous pouvons au moins être sûrs qu’il nous conduit bien quelque part. J’ai souvent rêvé que mes phrases accolées forment une seule ligne suffisamment longue pour établir cette identité entre la phrase et la route, la lecture et le déplacement. »
Rebecca Solnit, L’art de marcher

« Frank, peut-être est-ce le vieux vendeur qui vit en moi, mais je n’ai jamais eu qu’une seule conviction, et la voici : si vous essayez de vendre une idée, et peu importe qu’elle soit plus ou moins compliquée, vous ne trouverez jamais meilleur instrument de persuasion que la voix d’un être vivant. »
Richard Yates, La fenêtre panoramique
La fenêtre panoramique (Revolutionary road, 1961), de Richard Yates (1926-1992), a été récemment porté à l’écran par Sam Mendes (Les noces rebelles, 2009). Dans ce Madame Bovary de la littérature américaine (selon Douglas Kennedy chez Busnel), les allusions à Flaubert sont une piste de lecture très intéressante, mais on peut lire ce roman sans y penser, pour sa peinture magistrale d’une descente aux enfers conjugale en banlieue, non loin du Domaine de la Révolution, vers 1955.
April, la « charmante » épouse de Frank Wheeler, a étudié l’art dramatique, ce qui a poussé leurs amis, Milly et Shep Campbell, à les enrôler dans la Compagnie du Laurier, une troupe d’amateurs. « Longtemps après la date fixée par le directeur pour ce qu’il appelait « enlever la pièce réellement au-dessus du sol, la faire vivre pour de bon », elle demeura une masse statique, inhumainement lourde, informe, inanimée (…) » Une bonne répétition générale a ranimé leur espoir d’éblouir, mais la première est un échec. April qui semblait pouvoir y récolter un succès personnel finit par perdre ses moyens elle aussi – « Quand le rideau tomba enfin, ce fut une vraie miséricorde. »
Frank retrouve sa femme dans la loge, prêt à lui témoigner amour et compassion. « Mais un recul imperceptible de ses épaules lui apprit qu’elle ne tenait pas à ses caresses ». Bien qu’ils aient prévu de sortir ensuite avec les Campbell, April oblige Frank à prétexter un problème de baby-sitter pour pouvoir rentrer – « le premier mensonge de ce genre depuis deux ans qu’ils étaient amis ». Cette petite comédie annonce la thématique du roman : mascarade conjugale, obsession des convenances, insatisfaction profonde.
Sur le trajet du retour, April refuse de parler de cette soirée ratée, s’exaspère de l’insistance de son mari. Une fois rentrée, elle se couche sur le canapé du séjour pour qu’il la laisse tranquille. Le lendemain, quand Frank se lève, elle est déjà occupée à tondre la pelouse, ce qui surprend Mrs Givings, l’agent immobilier de la région, venue leur offrir un plant de sedum. Cette femme bavarde et curieuse est tout de même assez observatrice pour deviner que les Wheeler ne sont pas disponibles pour écouter ce qu’elle a en tête.
Jennifer et Michael, les enfants, s’inquiètent. La tension est palpable. April « s’était toujours tenue sur le bout d’une branche, prête à s’envoler : prête, toujours, à partir à la minute même où elle aurait envie de partir (« Ne me parle pas sur ce ton, Frank, ou alors je pars ; et je le ferais ! ») ou à la minute où entre eux quelque chose clocherait sérieusement. » Tout le week-end, elle reste sur la défensive, au désespoir de Frank qui cherche à se réconcilier tout en pensant à « la seule et unique chose au monde dont il avait envie réellement, sincèrement : s’emparer d’une chaise et la lancer à toute volée dans la fenêtre panoramique. » Et puis, le dimanche soir, les Campbell arrivent comme prévu et pour la première fois, les regards s’évitent, les amis se font des politesses, ne trouvent rien à se dire – « C’était une expérience nouvelle. »
Depuis longtemps, les deux couples s’entendent à déplorer la médiocrité générale, le conformisme. Ce soir, à court d’idées, Milly raconte ce qu’elle vient d’apprendre : le fils de Mrs Givings, présenté par sa mère comme un « merveilleux » mathématicien enseignant dans l’Ouest, se trouve tout près de chez eux, enfermé dans un hôpital psychiatrique depuis qu’il a enfermé et terrorisé ses parents. Cette nouvelle « excitante » détend un peu l’atmosphère. Frank, à la veille de ses trente ans, se lance dans le récit de son vingtième anniversaire à la fin de la guerre. Mais il se rappelle le leur avoir déjà raconté, il y a un an, et capte le regard écœuré d’April, un regard qui le hante encore le lendemain matin, dans le train, où il a « l’air d’un homme condamné à une mort très lente, sans douleurs. »
L’espoir renaît quand après avoir tout pesé, April convainc Frank de laisser tout tomber, emploi, maison, pour commencer une nouvelle vie en Europe, où elle trouverait du travail, le temps que Frank trouve sa voie, une activité qui lui corresponde mieux que sa situation actuelle. Ils annoncent leur départ aux proches, mais acceptent tout de même, à la demande de Mrs Givings, de recevoir leur fils John, de temps à autre, malgré les risques.
Et puis April tombe enceinte. Elle ne veut pas de cet enfant. Frank ne veut pas qu’elle avorte. Derrière leur façade bienveillante – que seul John Givings, « le fou », ose démasquer –, leurs désirs divergent. Frank n’ose parler d’un entretien professionnel prometteur, se console avec une secrétaire. Il décide que le temps sera son allié – « Notre capacité à mesurer et à répartir le temps est une source presque intarissable de soulagements. » Frank se force à être gai, attentif, séduisant. « L’ennui, c’est que la vie ordinaire devait cependant continuer. » La comédie tourne au tragique. Comme chez Flaubert, les rêves se fracassent. Il n’y a parfois rien de plus cruel que les rapports quotidiens où la souffrance fait son nid.