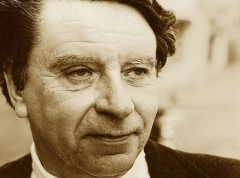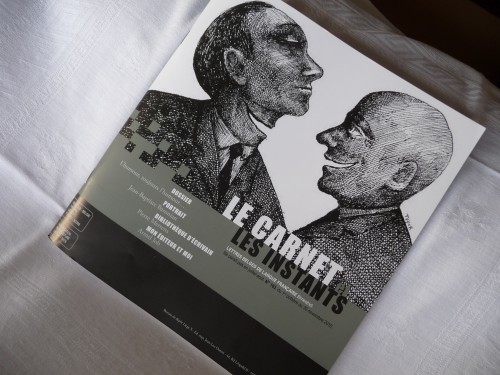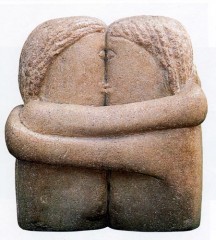La Résistance a pour moi, d’abord, le visage d’un jeune homme fusillé dans un champ le 3 septembre 1944, Hilaire Gemoets, et celui de sa sœur, ma mère. En ouvrant Max de Michel Quint, publié en 2008, ses lecteurs vont à la rencontre d’une figure autrement célèbre, celle de Jean Moulin, alias Max, dont l’auteur fait alterner le récit monologue avec celui d’Agathe, une étudiante en histoire qu’il croise de temps en temps au café de L’Etoile à Lyon. « Qu’on me pardonne de faire de Jean Moulin un héros de roman », écrit Michel Quint au début de son « Avertissement » suivi d’une « Liste des principaux résistants cités dans le roman et de leurs pseudonymes » et de quelques sigles de l’époque, d’AS à STO.
Mai 45. Janvier 43. Juin 40. Le récit remonte le temps, retrouve ensuite la succession des mois, de février à juin 43, pour se clore en juin 45. La scène d’ouverture est terrible : « Je suis entrée aux enfers par une rue en pente. » Agathe, la guerre à peine finie, a pris l’autocar pour se rendre dans un village aux allures de fantôme, avec ses portes de maisons ouvertes sur des pièces silencieuses, vidées de leurs habitants. Vers le centre, des vociférations, une grosse rumeur de fête s’échappent de la place. « Sur l’instant, je n’ai pas compris la bacchanale, le carnaval sanglant qui s’organisait là, farouche et cruel, pire qu’aux sauvages prescriptions, aux folies des saturnales perverses de la Rome antique… » On se bouscule, on crie « A mort ! ». L’homme et la femme « qu’on massacre en kermesse », elle les connaît – « je n’ai entrepris ce voyage que pour les rencontrer, me montrer vivante à eux. » Douleur d’en être témoin, nausée, souvenirs.
Agathe a ses habitudes au bistrot de M. Antonin, c’est là qu’elle fait la connaissance de Jacques Martel, décorateur, un homme dans la quarantaine qu’elle a déjà croisé dans l’immeuble d’en face où elle loge dans une chambre sous le toit. Le courant d’air, quand il a ouvert la porte, a éparpillé son cours d’histoire. Il l’aide à ramasser ses feuilles, s’excuse, bavarde, trouve qu’elle est, à vingt et un ans, « exactement le portrait de Berthe Morisot ». L’étudiante ne connaît pas cette « femme libre » dont Martel aimerait exposer des dessins dans la galerie qu’il va bientôt ouvrir à Nice.
Martel-Moulin-Max a quatre ou cinq mois pour « mettre sur pied quelque chose comme un Conseil de la Résistance » commandé par de Gaulle, qui soit prêt au cas où un débarquement aurait lieu en juillet. Méfiant par rapport aux manœuvres du PC qui aimerait diriger la résistance intérieure mais soucieux de donner à tous « la juste place due à leur courage », il veille à répartir équitablement les subsides entre Combat, Libération et Franc-Tireur.
Il ignore, en offrant un thé de cassis à la jeune Agathe, que dès son arrivée à Lyon en juin 40, celle-ci est tombée amoureuse de Maurice, le fils des pharmaciens Noël – « pas de bol de commencer l’amour de sa vie au début d’une guerre » – et qu’à sa suite, elle est entrée dans le Réseau, gentille assistante de la bibliothèque paroissiale qui distribue livres et fiches avec son triporteur. Elle-même s’est étonnée de trouver sur sa liste de contact les Desmedt, des amis de son père chez qui elle était censée loger et qui n’avaient pas du tout l’air de mener des activités clandestines, ce qui est la règle, bien sûr.
Marcel Quint accompagne Jean Moulin de Londres en France, de Paris à Lyon, de contact en réunion secrète. Lui qui se voit en « paysan de la politique » devient le « ministre plénipotentiaire de la France libre » mais doit faire face aux partisans impatients d’agir, en particulier les réfractaires au STO, et conseiller la prudence, rappeler les ordres. Les rivalités sont incessantes – « Je suis un veilleur, un gardien de phare, un chien de troupeau. Vous ne m’atteindrez plus, messieurs les chicaniers. » Colette, Antoinette – dans la compagnie des femmes il retrouve un peu de légèreté, prend parfois des risques.
Mais le danger se rapproche, la Gestapo multiplie les arrestations, Maurice arrêté, torturé, se pend dans sa cellule, Agathe doit prendre encore plus de précautions. Max la croise à L’Etoile, bien habillée, mais « parfumée au chagrin ». Sur lui aussi, l’étau se resserre. Marcel Quint, en mêlant les destinées du chef de la Résistance française et de l’étudiante au grand cœur, réussit à nous faire partager leurs élans et leurs craintes, et à nous faire mieux comprendre l’héroïque générosité de ceux qui ont risqué, voire donné leur vie à l’histoire de la Liberté.