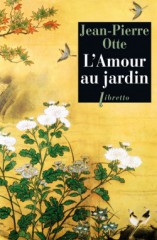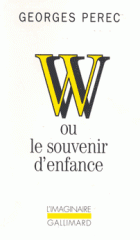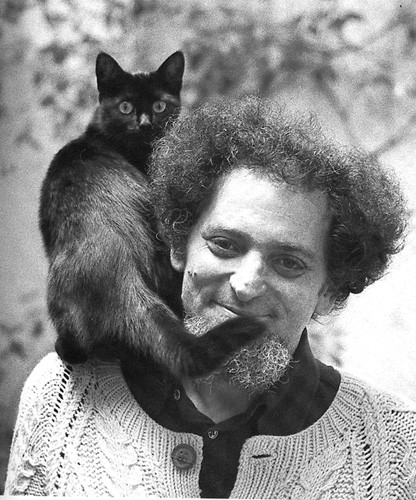Dans la collection « Petit éloge » (Folio), voici Elisabeth Barillé avec Petit éloge du sensible (2008), vingt textes, courts pour la plupart. « Prologue en cuisine », le seul dialogue de cet essai très accessible, donne le ton de cette épicurienne avouée : « Comment fais-tu ? – Pour quoi donc ? – Pour avoir l’air heureuse ? – Mais je le suis vraiment ! – Toujours ? – Chaque jour m’apporte une occasion de l’être… »
Elisabeth Barillé se sent bien dans sa peau, dans son corps comme elle dit, même si les années passent. Comparant les corps aux violons, elle déclare que « les neufs vont aux débutants, les historiques aux virtuoses. » Son conseil à qui est malheureux ? « Sortez ! » Le bonheur demande de la volonté. Ce dialogue a lieu dans sa cuisine – écrire et cuisiner font bon ménage, voir Duras et sa soupe aux poireaux. Les gestes simples, humbles, font la richesse de la vie.
C’est un art de rester dispos, curieux du monde comme il va, ce qui n’empêche pas de s’emporter contre l’immaturité et la grossièreté affichées en société à propos du sexe (« Femmes, on vous ment ! ») au point que « La retenue signe désormais la prétention. » Absurde, bien sûr, de prétendre parler « au nom des femmes » parce qu’on en est une, comme s’en targuent certaines dans les témoignages ou les débats.
« Je ne supporte ni les voix aiguës, ni les voix brutales, ni les voix impérieuses, ça fait du monde… » (« Féconde surdité ») Elisabeth Barillé aime être seule et relie cela à la perte de l’oreille gauche à sept ans, qui l’a rendue vulnérable à certains sons. « Je lui dois la solitude, cette royauté secrète. » Elle y a gagné d’échapper « aux remous du monde » : « Je redoute tout ce qui fait grappe, groupe et débat, forums, assemblées et fêtes. »
A la solitude aimée (on pense à Jacqueline Kelen) se joint le goût des endroits paisibles, quand elle décrit son refuge au cœur de Paris qui lui offre le matin le chant des oiseaux, le soir le silence, ou sa vie en Normandie : « Ici, seule face aux mouettes, j’écris, je ris et je rends grâce. »
Ce n’est pas une vie d’ermite, mais une liberté choisie, un renoncement qui mène à la joie, aux antipodes des faux besoins (les soldes dans « Néant tangible », un dépôt-vente dans « Sac rouge souris grise ») et du pouvoir de l’argent qui aveugle et emprisonne. Elisabeth Barillé s’insurge contre « l’esclavage consumériste ». « Se réjouir pour peu de choses, se contenter du minimum, festoyer d’un rien : si c’était là l’ultime scandale ? » Son premier roman, Corps de jeune fille, avait fait sensation en 1980. Depuis lors, la romancière française a publié une vingtaine de titres, dont les derniers sont inspirés par la Russie, le pays de sa mère.
Petit éloge du sensible m’a permis de faire connaissance avec une écrivaine qui refuse le conformisme sans prétendre à la perfection (elle fume deux cigarettes par jour, elle se souvient de ses années anorexiques) et qui rejette les fausses jouissances (contre le succès des sex toys, elle écrit « Appel au ressentir »). On y croise des papillons, quelques écrivains, de bonnes formules : « L’insupportable bisou. Votre ennemi personnel en ce moment. »