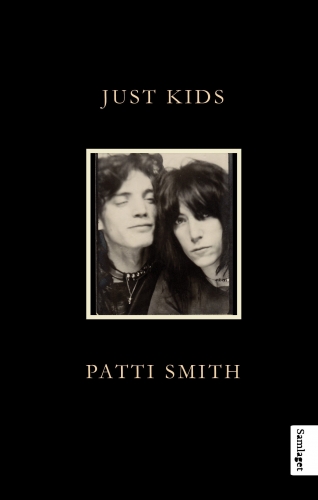On peut aller voir un film pour un formidable duo d’acteurs – en l’occurrence, Meryl Streep et Tom Hanks – et sortir du cinéma emballé par un puissant éloge de la liberté de la presse, ou bien l’inverse. Dans The Post (diffusé chez nous sous le titre Pentagon Papers, au Québec, Le Post, tout simplement), Spielberg raconte avec l’art et le fini qu’on lui connaît ces jours historiques pour le journal The Washington Post, en 1971.
Ecœuré par les mensonges du gouvernement américain sur ses succès militaires au Vietnam, un analyste militaire est à l’origine du dévoilement de ces archives confidentielles du Pentagone : une étude sur les avancées réelles de la guerre au Vietnam dont plusieurs présidents américains, successivement, n’ont pas tenu compte, prolongeant le mensonge d’Etat et l’envoi de jeunes soldats, toujours plus nombreux, dans le bourbier vietnamien.
C’est le New York Times qui publie en primeur ces documents secrets à la une, mais très vite, une injonction de la justice à la demande de Nixon lui interdit de continuer à porter ainsi atteinte à l’image des Etats-Unis. Le rédacteur en chef du Post, Ben Bradlee (interprété par Tom Hanks) y voit une occasion inespérée pour un journal à l’audience plus limitée et qui cherche de nouveaux moyens financiers pour se développer : il voudrait persuader la directrice du journal, Katharine Graham (interprétée par Meryl Streep) de publier ces « Pentagon Papers » s’il arrive à mettre la main dessus. Elle hésite d’autant plus qu’elle est stressée par l’entrée en bourse imminente du Post, groupe familial dont elle a pris la direction après le suicide de son mari.
Au comité d’administration, les conseillers sont nombreux à préférer la prudence, surtout en ces circonstances où il vaudrait mieux ne pas affoler les banquiers. Spielberg filme à de nombreuses reprises la directrice du Post entourée d’hommes en costume et cravate, seule présence féminine dans un monde majoritairement masculin – il fallait du cran. Certains n’hésitent pas à la mettre en cause, à dévaloriser ses compétences, d’autant plus qu’elle est arrivée à son poste parce qu’elle était l’épouse du directeur précédent.
Plusieurs scènes montrent bien l’attention de Spielberg à cette question du genre : lorsqu’elle fait son discours pour l’entrée officielle en bourse ; lorsqu’elle donne une réception et se retire avec les dames à l’heure où celles-ci laissent les messieurs discuter entre eux ; lorsqu’elle quitte le tribunal à la fin, après que le Post et le New York Times ont gagné devant la Cour Suprême des Etats-Unis – laissant le patron du New York Times pavoiser devant les micros des journalistes, la patronne du Washington Post descend les marches de son côté, entre de nombreuses jeunes filles levant vers elle un regard admiratif.
Le thème majeur du film est la liberté de la presse, et en particulier, la liberté de critiquer la politique gouvernementale. Le début du film illustre parfaitement le décalage entre la réalité du terrain (les soldats morts au Vietnam) et le discours de propagande des responsables politiques, pour le prétendu bien du pays, alors même qu’ils viennent d’être informés de défaites calamiteuses.
Spielberg montre la proximité entre les journalistes et la sphère politique : la directrice du Post considère Robert McNamara comme un ami. Quand son rédacteur en chef soulève la question de son indépendance réelle, elle riposte en lui rappelant ses propres liens avec le président Kennedy et sa femme. Le film souligne également le rôle crucial de la justice pour protéger les droits des uns et des autres. Désobéir à l’injonction d’un magistrat peut conduire en prison, le journal risque gros dans l’aventure – et tous ses employés. Spielberg a construit « un haletant suspense uniquement avec des discussions, des réunions et des échanges téléphoniques » (Marcos Uzal, Libération)
Pentagon Papers a été présenté comme un film « anti-Trump » : Tom Hanks est un opposant notoire au président actuel des Etats-Unis, celui-ci n’a pas hésité à dévaloriser la réputation de Meryl Streep, récemment récompensée par un Oscar pour son premier rôle dans The Post. Le journalisme est un métier de passion, c’est ce qu’incarnent parfaitement Meryl Streep et Tom Hanks dans les rôles principaux, et aussi Bob Odenkirk dans le rôle de Ben Bagdikian décidé à tout risquer pour cette cause juste, comme Matthew Rhys dans celui de Daniel Ellsberg, le lanceur d’alerte.
Où en est la grande presse presque cinquante ans plus tard ? Quelle est son indépendance par rapport aux gouvernants dont elle ne fait trop souvent que répéter le discours, au détriment de l’analyse et de la critique ? On mesure aussi, devant les superbes images des salles de rédaction, de la composition des articles au plomb, de l’impression, des rotatives, de l’empaquetage, à quel point le travail technique a changé, sans parler du recul actuel de la presse papier au profit du numérique.
Pentagon Papers de Spielberg, qui nous plonge littéralement dans l’époque et le décor des années septante, m’a passionnée de bout en bout. Je laisse la conclusion à Armelle Barguillet : « Ce film tombe au bon moment pour deux raisons : primo, il rend compte du devoir de vérité d’une presse indépendante et courageuse ; secundo, il se glisse dans l’actuel débat féministe sur les inégalités de traitement faites aux femmes, les humiliations quotidiennes qu’elles subissent en affirmant leurs convictions, leur intelligence et leur perspicacité, y compris dans les décisions historiques de la nation. » (La Plume et l’Image)