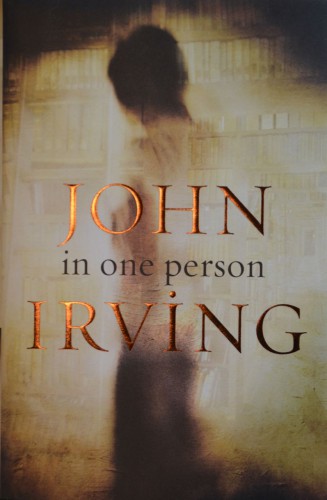La Passerelle de Lorrie Moore (A Gate at the Stairs, 2009), c’est d’abord ce contact facile entre Tassie Keltjin et Sarah Brink dès leur première rencontre. La jeune Américaine, étudiante à Troie, « l’Athènes du Midwest », propose ses services comme garde d’enfants et le courant passe avec cette femme un peu plus petite qu’elle, gentille, d’apparence soignée, quarante-cinq ans, qui tient un restaurant chic et va bientôt adopter un bébé. Sarah connaît et apprécie les pommes de terre « Keltjin », spécialité du père de Tassie, un fermier un peu « étrange » aux yeux de ses voisins, plutôt écolo, l’excentrique local.

Engagée, Tassie accompagne Sarah à un premier rendez-vous avec la mère biologique : une responsable de l’agence d’adoption accompagne une jeune fille, Ambre, qui porte un bracelet électronique au poignet. Celle-ci s’étonne de l’absence du père adoptif, retenu par son travail. Sarah ne peut s’empêcher, en partant, de faire la morale à la jeune délinquante, bref, le rendez-vous est « un désastre absolu ».
Noël en famille : Tassie retrouve son frère, Robert, avec qui elle s’entend très bien, et que sa vie de garçon de ferme déçoit. Leur père s’étonne du programme éclectique de Tassie à l'université : littérature britannique, introduction au soufisme, à la dégustation de vin, musique de films, géologie… Robert, lui, s’est inscrit à un cours de yoga et parle d’un agent recruteur venu au lycée de Dellacrosse proposer deux ans de service dans l’armée à ceux qui cherchent leur voie. Tassie et sa mère le mettent en garde, la guerre en Afghanistan n’est pas terminée.
« Quand je revenais à Dellacrosse, ma place dans le monde universitaire, dans celui de Troie et l’univers adulte se dissolvait, et je me transformais en un improbable ramassis de moi antérieurs qui se télescopaient les uns les autres. » Tout ici lui paraît à présent étranger, ses anciens amis, des « extraterrestres ». Et puis Sarah l’appelle : elle voudrait que Tassie rentre et l’accompagne en avion à Packers City, pour un autre rendez-vous. Edward, son mari, les y rejoindra.
Là, Bonnie, presque trente ans, propose son enfant d’un an ou deux à l’adoption, un bébé métis déjà placé dans une famille d’accueil. Sur le père, aucune information : l’enfant d’un flirt ? d’un viol ? Bonnie insiste pour que Mary soit élevée dans la religion catholique et qu’on lui envoie des photos chaque année, à Noël. La petite a un sourire magnifique, Sarah l’appellera bientôt Mary-Emma ou Emmie, d’après ses initiales.
Tassie, qui joue de la guitare basse, fait la connaissance à l’université d’un étudiant brésilien un peu cachottier, Reynaldo, qui devient bientôt son petit ami. Brave fille, elle prend à cœur son rôle de baby-sitter tandis que Sarah rassemble chaque semaine chez elle d’autres parents adoptifs en butte aux mêmes problèmes qu'eux : remarques racistes à cause de leur enfant de couleur différente, questions d’éducation quant à la meilleure façon de les préparer à la mixité sociale… Mary-Emma est une petite fille charmante, éveillée, elle adore sa baby-sitter.
Tout semble aller pour le mieux, qu’est-ce qui cloche ? De terribles non-dits. Entre les hommes se construisent des passerelles, mais aussi des barrières, ou pire. Dans ce premier roman, par les yeux de Tassie, Lorre Moore décrit les mœurs américaines ordinaires avec une ironie que rend bien la traductrice, Laetitia Devaux. Curieuse de tout et de tous, l’étudiante va peu à peu découvrir ce qui se cache derrière de douces apparences.
« Chaque personne, dans cette maisonnée, moi y compris, semblait issue d’un horrible conte de fées. Mais de contes différents. Nous étions tous grotesques et égocentriques, chacun dans sa propre histoire, si bien que nos échanges étaient incompréhensibles et dépourvus de sens, comme les personnages dans une pièce de Tennessee Williams qui déclament une tirade futile mais envoûtante de folie. » La petite Mary-Emma échappera-t-elle à cette dérive chaotique ? La vie est parfois drôle, souvent elle ne l’est pas. Au bout du compte, leur histoire à tous n’est pas du tout ce qu’elle promettait. Surtout connue comme nouvelliste, Lorrie Moore intitule ses recueils Des histoires pour rien, Vies cruelles, Déroutes.
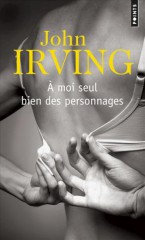 « Je me haïssais de chialer comme ça, mais je ne me maîtrisais plus. Le Dr Harlow nous avait dit que, chez les garçons, les torrents de larmes dénotaient une tendance homosexuelle à proscrire absolument. Inutile de préciser que cet abruti s’était bien gardé de nous expliquer comment ! En outre, j’avais entendu ma mère dire à Muriel : « Honnêtement, je ne sais plus quoi faire quand Billy se met à pleurer comme une fille ! »
« Je me haïssais de chialer comme ça, mais je ne me maîtrisais plus. Le Dr Harlow nous avait dit que, chez les garçons, les torrents de larmes dénotaient une tendance homosexuelle à proscrire absolument. Inutile de préciser que cet abruti s’était bien gardé de nous expliquer comment ! En outre, j’avais entendu ma mère dire à Muriel : « Honnêtement, je ne sais plus quoi faire quand Billy se met à pleurer comme une fille ! »