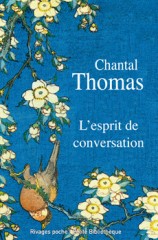De 1937 à 1946, Lune de loups (Luna de lobos, 1985, traduit de l’espagnol par Raphaël Carrasco et Claire Decaëns) nous fait revivre des années douloureuses pour l’Espagne sous Franco. Julio Llamazares raconte comment ceux qui avaient fui dans la montagne après la chute du front républicain des Asturies ont dû y rester pendant des années pour échapper à la traque des gardes civils, y survivre, s’en échapper parfois ou y mourir, à moins de réussir à passer la frontière et s’exiler.
Ils sont quatre à monter en automne vers le col d’Amarza : Ramiro et son frère Juan, Gildo et Ángel, le narrateur. Dans la vallée, au versant sud, une lumière s’allume dans une maison. « Bientôt il fera clair et pour lors il nous faudra être cachés. La lumière du soleil n’est pas bonne pour les morts. » Sous la menace de leurs armes, ils se font ouvrir la porte et donner à manger, ils n’ont plus rien avalé depuis cinq jours. « Le lait est chaud et épais. Il descend comme une flamme dans ma gorge. » Puis ils reprennent la marche à travers les montagnes, pour rejoindre leur contrée quittée un an plus tôt.
Au-dessus des toitures de La Llánava, Ramiro signale une tache jaune sur un chemin : la sœur d’Ángel porte le foulard jaune offert par son frère pour mener les vaches au pré. Celui-ci descend lui annoncer leur arrivée cette nuit, mais cela l’effraie : « Ils vont te tuer. » Dans l’obscurité, ils s’introduisent dans la grange, apprennent que les gardes civils ont emmené le père. Même si sa sœur Juana le conjure de s’en aller, Ángel décide de rester, la grange a déjà été fouillée, mais les autres retournent dans la montagne. Quand son père revient, maigri, vieilli, il lui donne de l’argent pour passer dans l’autre zone, c’est trop dangereux par ici : « Ils recherchent tous ceux qui étaient aux Asturies »
Le groupe décide alors de se cacher dans une mine abandonnée. Ramiro y a travaillé douze ans, de quinze à vingt-sept ans, avant la guerre civile. A la bergerie, ils emportent des fromages et une brebis, qu’Ángel paie au berger dont ils ont aussi pris la carabine. Gildo tue la bête, la vide, Juan sort les viscères puis donne l’alerte : quelqu’un là-haut l’a vu ! C’est un gamin de Vegavieja qui cherche une chèvre et les accuse de l’avoir volée avant de s’enfuir. Bientôt les gardes civils arrivent avec des soldats pour fouiller la mine, poussant deux prisonniers devant eux, qu’ils abattent. Les fuyards se sont réfugiés dans une grotte humide et glacée – « avant le printemps, nous ne pourrons pas nous échapper d’ici. »
Deux ans plus tard, Ángel et ses compagnons arrêtent au col un autocar qui va au marché de León. A l’abri de leurs passe-montagnes, ils prennent l’argent des passagers sous la menace de leurs mitraillettes. Ángel passe deux jours et deux nuits chez son amie María ; de la fenêtre de sa chambre, il surveille un tablier à carreaux bleus pendu dans le jardin, qui signale la présence de gardes civils autour de la maison familiale. « Tu sens les bois, tu sens comme les loups », lui dit la jeune femme. A cinq heures du matin, le tablier a disparu, il peut se glisser chez lui. Sa sœur a été battue par les gardes civils, elle remet du sang. Ángel : « comment lui dire que je souffre davantage pour eux que pour moi. Sans savoir comment mettre un terme à ce cercle sanglant et interminable. »
Son père lui avait dit un soir en rentrant chez eux : « Regarde, mon fils, regarde la lune ; c’est le soleil des morts. » Et c’est ainsi que se sentent les fugitifs, comme des morts, comme des loups. Toujours sur la défensive, toujours prêts à fuir ailleurs, à tuer pour ne pas être tués. Se déplaçant au clair de lune. La possibilité d’un retour s’éloigne chaque jour, y compris pour Gildo qu’attendent une femme et un fils. Des échappatoires se révèlent souvent des pièges meurtriers, et il faut beaucoup d’argent pour passer à l’étranger. Les villageois sont partagés entre la compassion – certains les aident – et « la peur, chaque jour plus grande, des représailles ». Connaîtront-ils tous les quatre, l’un après l’autre, le sort des loups traqués et abattus ?
Nous suivons jusqu’en 1946 les pas d’Ángel, l’ex-instituteur de La Llera, qui d’année en année, à travers des hivers terribles, se sent devenir une véritable bête qui effraie les gens, et même les siens. Dans Lune de loups, Julio Llamazares décrit avec une intensité remarquable le destin de ces maquisards condamnés à épouser la montagne dans toute sa rigueur et toute sa beauté intransigeante. Toujours à deux doigts de la mort. Vivant comme des loups.