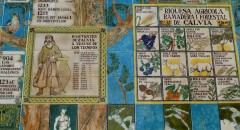Quelques éclats d’une île, côté ville et côté campagne, pour prolonger ce séjour à Majorque. Reverdie grâce aux pluies d’avril, elle est aussi de pierre, disent les rochers valises de l’aéroport.
Haut dans le ciel de Palma, des palmiers vouvoient des bougainvillées en fleurs. Au Grand Hôtel, l’invité est italien : Fellini El circo de las illusiones propose exclusivement des images, photos et séquences de films, de tournages. On y voit le réalisateur de La dolce vita et Mastroianni en belle complicité. Anita Ekberg brûlante dans une fontaine romaine. La statue du Christ transportée en hélicoptère. Une époque. De l’autre côté de la place Weyler, des motos immobiles au pied des maisons de Gaudi.
La vieille ville de Palma est très belle : il y a tant à regarder dans ses avenues et ses ruelles, les immeubles aux loggias de bois, les saints encadrés à l’angle des rues, les portes, les façades anciennes ou modernistes... Pour prendre un café ou un petit déjeuner décliné en formules diverses, le Cappuccino (Carrer de San Miguel) est un endroit magique. Musique de qualité, carte et décor remarquables, patio et jardin.
Dans la Cathédrale de Palma, après les interventions de Gaudi au début du siècle dernier, une chapelle a été récemment confiée à Barceló, l’artiste majorquin, peintre et aussi sculpteur, céramiste. L’audace du geste surprend d’abord, et puis la magie opère devant ces modelés qui montent à l’assaut des murs, des colonnes, et fusionnent avec la structure gothique. Ici, la pêche miraculeuse, vague et poissons, là les fruits de la terre, des figures. Des parois comme ressuscitées, vivantes. Seuls les vitraux déçoivent, en rupture avec l’élan vital qui surgit des murs où la glaise et la céramique portent les couleurs naturelles des Baléares.
Près de la cathédrale, dans les jardins de l’Evêché (Bisbat), les pétales des bougainvillées posent sur le bassin aux nymphéas des touches impressionnistes. Du Parc de la Mer (Parc de La Mar), sous les murailles, la vue est grandiose. On y a installé quelques sculptures, un pan de mur signé Miró.
La moderne et immense station « intermodale » en sous-sol à la Place d’Espagne donne accès aux métro, trains et autobus pour se déplacer dans la ville et dans l’île, c’est très commode. Mais être emmenée par une amie sur les routes de campagne, non pour tout voir mais à la rencontre de quelques villages et paysages (Puigpunyent, Calviá, Galilea, Alaró, Cap Blanc), c’est bien sûr un privilège inestimable que seule l’amitié peut offrir. Merci, Colo.