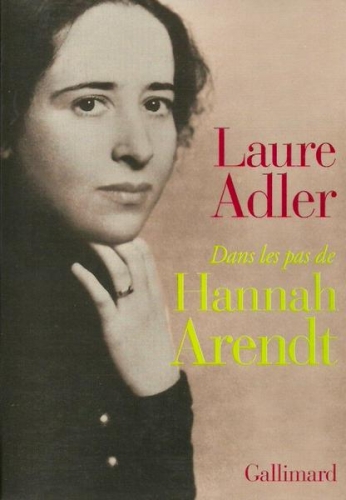Sagesse de l’herbe. Quatre leçons reçues des chemins : Anne Le Maître, rencontrée dans la blogosphère où elle partage deux passions, l’aquarelle et l’écriture poétique, offre sous ce titre à cheminer avec elle. « D’aussi loin que remontent mes souvenirs, il y a les prés, les forêts et les chemins qui les sillonnent, et le temps suspendu de la promenade. »
© Anne Le Maître, Colline. Vézelay 2015 (Bleu de Prusse)
Ce livre allie délicieusement la balade et la réflexion, l’observation et l’amour de la vie. Quand Anne Le Maître se met en route, elle emporte une carte, une gourde, parfois quelques pinceaux – « Un sac, pour les trouvailles. Un carnet, pour les mots ». Elle marche, elle regarde, elle songe : « Chaque fois que sonne l’heure des mots, chaque fois me reviennent, plus fort que tout, ces leçons apprises des chemins. Cette sagesse à hauteur de brin d’herbe. Je crois que je n’en ai pas d’autre. »
Elle nous emmène à la rencontre des jonquilles dans les bois de Pâques, dans la lumière d’un matin de printemps ; un jour d’été, à la cueillette des mûres avec une enfant. Pour mesurer le monde, « la seule aune » du corps : « Ce qui compte c’est le pas, le souffle et le nombre de battements de cœur qui me séparent du but. » Au passage, l’enseignante de Dijon rappelle une définition, une étymologie, une citation. La science et la lecture sont ses compagnes discrètes et sûres.
« Il a suffi de trois pas hors de chez moi pour que je rejoigne d’autres intentions, d’autres rythmes, d’autres temporalités, plus mystérieux. » Echapper au temps des machines – celles du travail, celles que nous laissons envahir notre vie – et « renouer, si peu que ce soit, avec les cycles naturels ». Anne Le Maître fait un bel éloge des saisons : « J’aime à la folie cette ronde des saisons propre à nos latitudes tempérées, qui fait passer des collines du brun au vert puis à l’or poussiéreux des moissons. »
Anne Le Maître à La Hulpe, 11 mai 2019
S’ouvrir à la beauté du monde, sans angélisme ni naïveté. La laideur, la nature blessée, le paysage défiguré existent – « Mais comprenez ceci : je n’ai pas ignoré la porcherie derrière l’églantine. J’ai vu l’églantine devant la porcherie. J’ai vu le vallon tout autour de l’antenne, et le bleu incroyable d’un champ d’orge empoisonné qu’on aurait pourtant dit pétri de ciel pur. J’ai vu. Je me suis efforcée de voir. C’est un effort constant, une vraie discipline. »
En résonance, des écrivains, des jardiniers, des poètes, la Bible, des peintres – des porteurs d’Espérance. Ils s’invitent, quand elle découvre un lieu, un paysage – quelques dessins à l’encre noire à l’appui –, quand elle admire, quand elle contemple. Il en faut, de l’espérance, pour accompagner quelqu’un dans un service d’oncologie, pour affronter jour après jour l’érosion effrénée du monde par l’homme.
Anne Le Maître sait raconter la magie des rencontres avec une fleur, un oiseau, un arbre, un animal sauvage. Elle aime les appeler par leur nom, les identifier pour reconnaître ces « autres » que sont nos compagnons dans la sphère du vivant. « Il y a là une forme de politesse faite au monde. » « Apprenons à nommer. Prenons cette peine. L’émerveillement ou l’inquiétude : tout plutôt que l’indifférence, cette mort lente du cœur. »
La Hulpe, jardin de l'Académie de musique
Même dans sa cour où elle bataille contre les herbes indésirables, la conteuse a de quoi penser, comme Hubert Reeves à la rencontre des fleurs sauvages, devant l’infiniment petit, la vie en abondance. Qu’est-ce que le sauvage, au fond ? « La friche, proclame Gilles Clément, qui a beaucoup réfléchi au rapport entre espaces sauvages et terres cultivées, la friche est le territoire de la liberté et de la créativité. »
J’ai rencontré Anne Le Maître à La Hulpe, où elle participait avec ses aquarelles lumineuses à un parcours d’artistes. Le soleil nous a permis de faire connaissance dans le jardin de l’Académie de musique, en compagnie d’un chat malicieux. J’en ai ramené ce précieux petit livre de sagesse à garder près de soi pour le rouvrir souvent. Merci, Anne.
Dans la « petite bibliographie subjective » qu’elle ajoute à la fin de Sagesse de l’herbe, des « voyageurs immobiles », des « scientifiques contemplatifs », de « grands arpenteurs », des « maîtres spirituels », des « aventuriers du minuscule ». Précieuses listes où je retrouve des livres aimés et d’autres à découvrir. Anne Le Maître, « terrienne », est entrée dans cette famille d’écrivains avec Sagesse de l’herbe, un livre à offrir et à s’offrir.