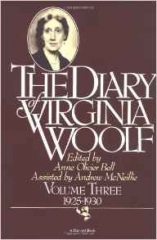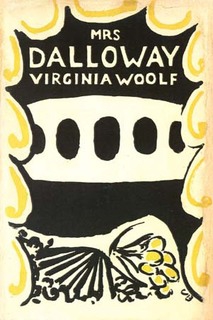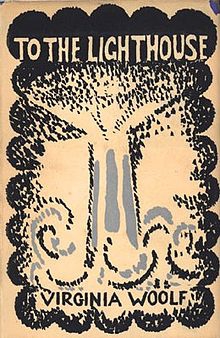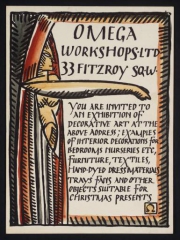Le tome 4 du Journal de Virginia Woolf traverse trois années plutôt prospères et en tout cas heureuses, comme elle le répète souvent. Elle termine d’écrire Orlando en mars 1928 – « trop long pour une farce et trop frivole pour un livre sérieux » – avec un grand désir de soleil, de vin et de « rester assise à ne rien faire », ce qu’elle pourra faire à Cassis, où elle rejoint sa sœur qui y migre à présent chaque hiver. Au retour, elle « consigne » drôlement la réception de son prix Femina en mai pour La promenade au phare : « une abomination », mais le succès du roman lui permet l’acquisition d’une automobile qu’elle surnomme « le Phare ».

Lenare, Portrait of Virginia Woolf, 1929 (The Red List)
Le retour de Nessa en juin réjouit Virginia : « Nessa m’est nécessaire – comme je ne le lui suis pas. Je cours vers elle comme un petit kangourou vers sa mère. C’est aussi qu’elle est pleine d’entrain, solide, heureuse. » Souvent elle note l’importance d’avoir des enfants, même si elle n’a plus envie d’en avoir pour pouvoir donner libre cours à ses pensées sans être dérangée – « la seule vie qui soit passionnante est la vie imaginaire ».
L’été à Monk’s House amène une nouvelle idée de roman qu’elle appelle d’abord « Les Phalènes » (Les Vagues) et d’agréables visiteurs avec qui boire le thé au jardin. Les arbres accrochent toujours son regard, ou les corneilles en lutte contre le vent – « Je suis fascinée par le spectacle des choses » – et elle se demande « Avec quels mots rendre tout cela ? » Mais elle déteste les visites de Mrs. Woolf, sa belle-mère, « cette tyrannie qu’exerce la mère – ou le père – sur la fille, leur droit à « ce qui leur est dû » étant une des choses les plus fortes du monde. Et après cela, on se demande pourquoi les femmes n’écrivent pas de poésie. » (A l’anniversaire de son père, qui aurait eu 96 ans, elle note : « Mais, Dieu merci, il ne les a pas atteints. Sa vie aurait absorbé toute la mienne. »)
La perspective de passer sept jours en Bourgogne « seule avec Vita » en septembre l’effraie, mais au retour, après avoir écrit beaucoup de lettres à Leonard, elle n’en dit que ceci dans son Journal : « Nous ne nous sommes pas mutuellement percées à jour ». Un autre texte l’occupe, d’abord en vue de conférences sur « Les femmes et le roman » à de jeunes femmes. Je leur ai dit de boire du vin et d’avoir une chambre à soi « affamées, mais intrépides, intelligentes, ferventes, pauvres et destinées par bancs entiers à devenir institutrices » (d’où le titre définitif). Elle aura bientôt sa propre chambre, grâce à la vente d’Orlando « étonnamment rapide », plus de 6000 exemplaires déjà en décembre ; elle se fait ouvrir un compte en banque personnel et peut dépenser son argent « librement », à 46 ans.
1929 commence bien avec un article élogieux du Manchester Gardian : « Orlando est reconnu pour ce qu’il est : un chef-d’œuvre. » Rien dans le Times sur l’exposition de Nessa – « Et voilà que je pense à part moi : Ainsi, de mon côté, je possède quelque chose, à défaut d’enfants, et je me mets à comparer nos vies. » Sans cesse, elle revient sur ce lien profond avec sa sœur, et leurs vies différentes. « Et même, si je me vois laide dans le miroir, je me dis : très bien, au-dedans de moi je regorge plus que jamais de formes et de couleurs. »
Dans « Les Phalènes », elle veut « reproduire l’instant dans sa totalité, quoi qu’il puisse inclure (…) une combinaison de pensée, de sensation, plus la voix de la mer. » Elle y pense longuement, avant de se mettre à l’écrire, par fragments : « un esprit en train de penser », « des îlots de lumière », « le vol fluide des phalènes ». « On pourrait appeler cela : « autobiographie ».
Les démêlés avec Nelly et Dottie – elle rêve de ne plus avoir de domestiques à demeure – sont parfois cocasses, comme quand Virginia Woolf se scandalise à l’idée que Nelly désire comme elle la victoire des travaillistes aux élections – « Je crois qu’être gouvernés par Nelly et Lottie serait un désastre. » Durant leur séjour à Cassis en juin (« jamais connu de vacances aussi chaudes »), elle est tentée par l’achat d’une maisonnette, « une petite île » qui représenterait « chaleur, silence, détachement total de Londres », mais elle y renoncera.
Créer, voilà ce qui lui importe avant tout dans cette vie « transitoire ». Et elle est heureuse d’être à présent dégagée des soucis matériels. Mais elle a besoin aussi « d’illusion humaine » : « inviter quelqu’un demain soir, après dîner, pour me lancer une fois de plus dans cette stupéfiante aventure qu’offre l’âme des autres… dont je connais bien peu de chose. Serait-ce l’affection qui nous mène ? »
Parfois elle plonge dans son « grand lac de la Mélancolie » d’où seul le travail la sort : « Aussitôt que je cesse de travailler, je sombre de plus en plus profond. » Ou un achat personnel, que ce soit une robe ou un canif. Et la construction de son pavillon à Monk’s House, transformé « en palais confortable ». Elle se réjouit de l’arrivée d’un fourneau à pétrole où cuisiner et réchauffer « sans produire d’odeur ni de résidu, et sans causer d’agitation », « en toute liberté ».
A quoi lui sert ce Journal ? A écrire des choses qu’elle ne raconte même pas à Leonard, à cerner de près les sentiments – « Il est probable que je ne dis pas tout, si bien que ce que je fais là équivaut, somme toute, à me confier. » « Oui, il est bien vrai que coucher quelque chose par écrit, c’est s’en débarrasser. »

Virginia Woolf et Ethel Smyth (New York Public Library)
En 1930, les Woolf envisagent de s’installer à Monk’s House dès le mois d’avril. Les Vagues sont en plein élan : « Pas de vacances ; pas de pause, si possible, avant que tout soit terminé. Puis repos. Et ensuite récrire le tout. » A 48 ans, elle fait ses comptes et constate qu’elle gagne à peu près le salaire d’un fonctionnaire, elle qui s’est contentée de si peu pendant tant d’années. Grippée, en février, elle note : « Une ou deux fois j’ai senti dans ma tête cet étrange bruissement d’ailes qui me vient si souvent quand je suis malade. » « Quelque chose se produit dans mon cerveau. Il se refuse à continuer d’enregistrer des impressions. Il se ferme. Je deviens chrysalide. »
Mais Virginia Woolf donne aussi de formidables portraits comme celui de « Snow », une amie et correspondante fidèle, dont elle déplore la vie gâchée. Quel contraste avec Ethel Smyth invitée à prendre le thé, plus âgée qu’elle ne pensait (71 ans), fantasque et pleine de bon sens, parlant sans discontinuer, « une femme de qualité et d’expérience, qui connaît la vie ». Celle-ci lui dit que « n’ayant eu personne pour l’admirer, elle écrira peut-être de la bonne musique jusqu’au bout » ! Le début d’une amitié indéfectible. Ou encore le portrait de Yeats, rencontré chez Ottoline.
Seules les Œuvres romanesques de Virginia Woolf (deux tomes) ont été publiées dans La Pléiade en 2012. J’espère qu’on y trouvera un jour ses essais rassemblés, et aussi ce Journal pour lequel on aimerait disposer d’un index. Rendez-vous pour la suite dans quelque temps – rien ne presse, et il lui faudra bientôt affronter les années de guerre. Elle conclut, le 30 décembre 1930 : « Mais tout de même, je suis allée à Lewes, et les Keynes sont venus pour le thé, et, m’étant remise en selle, le monde reprend ses proportions ; moi, c’est le fait d’écrire qui me donne mes proportions. »
Relire le Journal de Virginia Woolf – 7
Relire le Journal de Virginia Woolf – 6
Relire le Journal de Virginia Woolf – 5
Relire le Journal de Virginia Woolf – 4
Relire le Journal de Virginia Woolf – 3