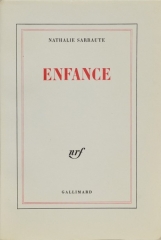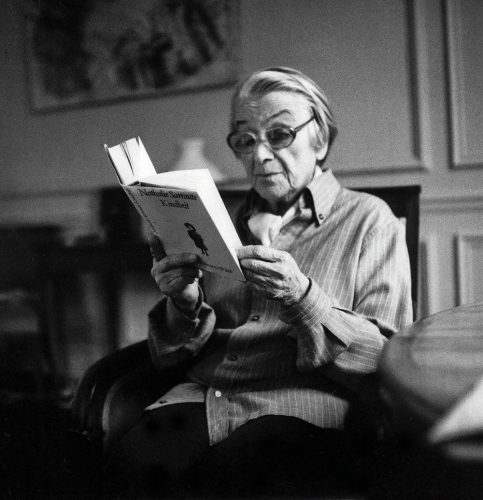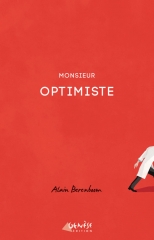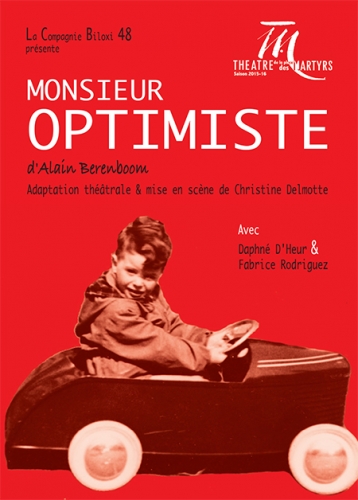J’étais impatiente d’arriver à ce récit de Modiano, Un pedigree (2005), auquel tant d’articles renvoient et qui éclaire son passé, avant sa naissance en tant qu’écrivain. (Un titre en écho au roman de Simenon inspiré par sa vie.) Bien qu’il figure dans Romans, c’est son texte le plus autobiographique. Patrick Modiano, né « d’un juif et d’une Flamande qui s’étaient connus à Paris sous l’Occupation », s’est attelé à baliser le mieux possible sa vie entre sa naissance, le 30 juillet 1945, et sa majorité, en 1966.
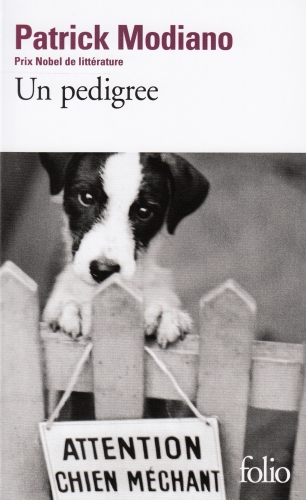
En couverture, une photographie de René Maltête
Sa mère (°1918, Anvers) était fille d’ouvrier et petite-fille de docker (son grand-père Louis Bogaerts « avait posé pour la statue du docker, faite par Constantin Meunier et que l’on voit devant l’hôtel de ville d’Anvers »). A vingt ans, elle est devenue comédienne puis « girl » au music-hall. Modiano reprend les noms des personnes et des lieux que fréquentait cette « jolie fille au cœur sec ». Son chow-chow dont elle ne s’occupait pas « s’était suicidé en se jetant par la fenêtre. Ce chien figure sur deux ou trois photos et je dois avouer qu’il me touche infiniment et que je me sens très proche de lui. » A Paris depuis juin 1942, elle habitait une chambre 15, quai de Conti, dans l’appartement loué par deux amis. Il donne leurs noms ainsi que ceux de ses visiteurs : « Que l’on me pardonne tous ces noms et d’autres qui suivront. Je suis un chien qui fait semblant d’avoir un pedigree. »
Son père (°1912, Paris) a une histoire plus compliquée. « Son père à lui était originaire de Salonique et appartenait à une famille juive de Toscane établie dans l’Empire ottoman. Cousins à Londres, à Alexandrie, à Milan, à Budapest. » Albert Rodolphe Modiano a quatre ans quand son père meurt. « Dans son adolescence et sa jeunesse, il est livré à lui-même. » Après l’internat au collège Chaptal, il ne passe pas son bac. Quand la seconde guerre mondiale éclate, « il vit déjà d’expédients. » Adresses multiples, noms d’emprunt, affaires diverses. Avec une amie juive allemande, « ils se font rafler un soir de février 1942 » dans un restaurant, ils n’ont aucun papier sur eux. Lui parvient à s’échapper du commissariat, elle sera libérée grâce à l’intervention de quelqu’un. « Demi-monde ? Haute pègre ? » Il s’interroge sur le monde où évoluait son père. « Drôles de gens. Drôle d’époque entre chien et loup. Et mes parents se rencontrent à cette époque-là, parmi ces gens qui leur ressemblent. »
Il suit leurs traces sous l’Occupation, période que son père avait évoquée un soir : « j’avais senti qu’il aurait voulu me confier quelque chose mais les mots ne venaient pas. » Ils se cacheront en Touraine jusqu’à la Libération, puis rentreront à Paris. « Le 2 aout 1945, mon père vient à vélo déclarer ma naissance à la mairie de Boulogne-Billancourt. » En 1947 naît son frère Rudy. En septembre 1950, on les baptise à Biarritz où ils vivent seuls pendant deux ans, sous la protection de la gardienne de la Casa Montalvo.
Aucun souvenir d’un geste « de vraie tendresse » de la part de sa mère à Paris, qui les confie en 1952 à une amie de Jouy-en-Josas. Son père leur rend visite de temps en temps avec Nathalie, son amie hôtesse de l’air. Paris de 1955 à 1956, école communale, catéchisme. Patrick Modiano se rappelle le quartier, les Tuileries, ses lectures d’alors, les vacances à Deauville dans un petit bungalow avec son père et Nathalie. Son frère meurt en février 1957 – « A part mon frère Rudy, sa mort, je crois que rien de tout ce que je rapporterai ici ne me concerne en profondeur. » Pensionnat à l’école du Montcel, l’école « des enfants mal-aimés, des bâtards, des enfants perdus ». Lectures. Promenades du dimanche avec son père, qui donne toujours des « rendez-vous » dans des endroits divers et l’emmène parfois au cinéma. Grandes vacances à Megève. Séjour en Angleterre. Rares lettres de sa mère.
Année après année, Modiano note ce dont il se souvient. Il quitte régulièrement des établissements où ils l’ont placé pour rejoindre ses parents, en espérant qu’ils le garderont quelque temps à Paris. Quand il confie à son père qu’il veut devenir écrivain, celui-ci insiste dans une lettre pour qu’il étudie d’abord, citant Sartre ou Claudel qui ont fait « de brillantes études ». Le seul diplôme de Modiano, ce sera le bac, passé à Annecy. Du lycée Henri-IV, il écrit : « jamais un internat ne fut aussi pénible […] surtout à l’heure où je voyais les externes sortir, par le grand porche, dans la rue. » Quand il s’enfuit, son père menace « de ne plus subvenir à son entretien », puis finit par se résoudre à ce qu’il vive avec sa mère. Celle-ci oblige son fils à mendier « un billet de cinquante francs » à chaque rendez-vous avec son père. Tenté « d’écrire noir sur blanc et en détail » ce qu’elle lui a fait subir, il se tait et pardonne.
« Et de menus événements se succèdent et glissent sur vous sans y laisser beaucoup de traces. Vous avez l’impression de ne pas pouvoir vivre encore votre vraie vie, et d’être un passager clandestin. » Alors qu’approche pour Modiano l’âge de la majorité, son père veut lui faire devancer l’appel au service militaire, pour être débarrassé de lui. Il lui signifie de ne plus compter sur lui dès ses 21 ans atteints. La réponse sera tout aussi cinglante : « Cher Monsieur » écrit-il à son père, ce que celui-ci prend très mal. Ils ne se reverront plus. Patrick Modiano regrettera d’avoir écrit cette lettre. Son premier roman a été accepté. « J’avais pris le large avant que le ponton vermoulu ne s’écroule. Il était temps. »