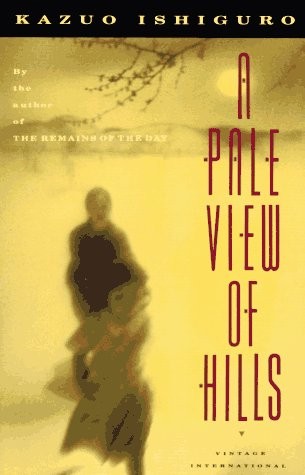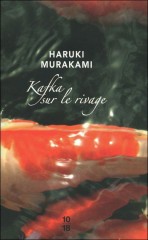Etsuko vit seule dans la campagne anglaise, l’image même de l'Angleterre telle qu’elle se l’imaginait quand elle vivait encore au Japon. Elle se souvient de la visite de sa fille Niki, la première après le suicide de sa fille aînée Keiko. A la cadette, elle voulait donner un prénom anglais, mais son mari préférait un nom japonais et ils étaient tombés d’accord sur ce prénom, Niki, vaguement oriental. Très vite, Etsuko a senti que sa fille, nerveuse, avait hâte de retrouver son appartement et ses amis londoniens. Pour Niki, sa sœur était quelqu’un qui la faisait souffrir, et elle n’était pas à son enterrement.
Cette visite pleine de tension et de non-dits – « la mort de Keiko n’était jamais loin ; elle planait au-dessus de chacune de nos conversations » – réveille les souvenirs d’Etsuko, en particulier l’amitié d’une femme qu’elle a connue quand elle habitait Nagasaki, bien avant de rencontrer le père de Niki, un Anglais. Et pourtant, Sachiko et elle ne s’étaient fréquentées que quelques semaines cet été-là, dans le soulagement de l’après-guerre, même si on se battait encore en Corée. Ce retour dans le passé est le sujet principal de Lumière pâle sur les collines (A pale view of hills, 1982), le premier roman de Kazuo Ishiguro, avant Un artiste du monde flottant, Les vestiges du jour et Auprès de moi toujours. Né à Nagasaki en 1954, l’écrivain devenu citoyen britannique est arrivé en Angleterre à l’âge de cinq ans.
Avec Jiro, son premier mari, Etsuko vivait dans un des nouveaux immeubles reconstruits après le bombardement dans un quartier à l’est de la ville, non loin d’une rivière à laquelle on accédait en traversant des terrains vagues que beaucoup jugeaient insalubres. « Une maisonnette en bois avait survécu aussi bien aux ravages de la guerre qu’aux bulldozers du gouvernement. » Etsuko la voyait de sa fenêtre et savait par des voisins qu’une femme réputée peu sociable et sa petite fille vivaient dans cette bicoque. Elle-même était alors enceinte de trois ou quatre mois.
Elles se rencontrent un jour sur le chemin, et Etsuko signale à cette femme d’une trentaine d’années ou plus (son visage paraît plus âgé) qu’elle a vu sa fille se bagarrer assez méchamment avec deux autres enfants, du côté des ravins. Sachiko n’a pas l’air inquiète, mais la remercie : « Je suis sûre que vous allez être une excellente mère. » Elle doit aller en ville, et Etsuko accepte de s’occuper de la petite Mariko pour la journée. La fillette de dix ans ne va pas à l’école, les paroles d’Etsuko ne semblent pas l’atteindre.
La première fois que Sachiko l’invite chez elle, Mariko lui montre leur chatte qui va avoir des petits et parle d’une femme « de l’autre côté de la rivière » : celle-ci lui a promis de l’emmener chez elle et de prendre un chaton. Pour Sachiko, la petite a surtout beaucoup d’imagination. Quant à elle, il lui faudrait du travail et elle aimerait que sa voisine la recommande à Mme Fujiwara qui vend des nouilles en ville. Etsuko admire le joli service à thé en porcelaine pâle – Sachiko lui a parlé de la maison magnifique de son oncle et de son goût des belles choses, elle n’a pas toujours vécu aussi modestement.
La marchande de nouilles, une amie de sa mère qui a bien voulu prendre Sachiko à son service, s’inquiète en voyant l’air triste d’Etsuko. Elle lui recommande, pour l’enfant à venir, des pensées agréables, une attitude positive. Tant de personnes ne pensent qu’aux morts de la guerre, elle veut regarder vers l’avant.
C’est à la même période que le beau-père d’Etsuko, Ogata, vient passer quelques jours chez son fils. Jiro, qui enseigne dans l’ancien lycée de son père, est agacé par ses remarques sur un ancien condisciple dont il a lu un article très critique envers les anciens enseignants. Il trouve cela déloyal de la part de quelqu’un qu’il a lui-même présenté au directeur du lycée, et voudrait que son fils lui exprime ses doléances. Jiro parti, Ogata parle avec Etsuko du futur enfant : elle aimerait lui donner le prénom de son beau-père, si c’est un fils, ou l’appeler Keiko, si c’est une fille.
Ishiguro met peu à peu des situations en place, y dispose ses personnages comme les pièces de cette partie d’échecs jamais terminée entre Jiro et son père, et cela crée un climat d’attente, d’inquiétude. Même dans la complicité qui s’installe entre des amies, entre un beau-père et sa belle-fille, entre mère et fille, il plane comme une menace. L’avenir de Sachiko et de sa fillette farouche est lié au bon vouloir d’un soldat américain qui a promis de les emmener aux Etats-Unis. Tiendra-t-il parole un jour ?
Du Japon d’après la guerre, Lumière pâle sur les collines revient dans la campagne anglaise où Niki et sa mère sont en désaccord sur presque tout – la jeune femme s’étonne d’entendre Etsuko répondre évasivement à une voisine qui prend des nouvelles de Keiko, comme si on ne l’avait pas retrouvée pendue dans sa chambre à Manchester.
Les souvenirs terribles ne manquent pas dans ce roman mystérieux, où l’on n’ose pas trop s’aventurer sur le terrain des émotions, où l’on communique difficilement les uns avec les autres. Le bonheur semble absent, englouti dans l’entonnoir du passé. Pour Etsuko comme pour Sachiko. Il y a, même au sein des familles, des gouffres infranchissables.