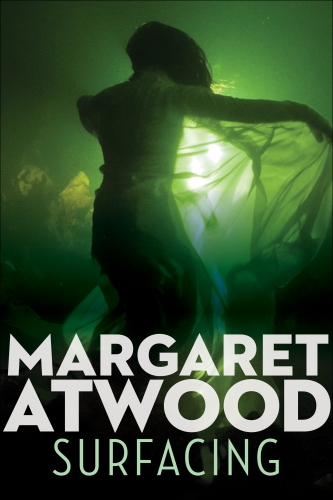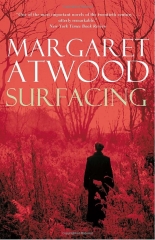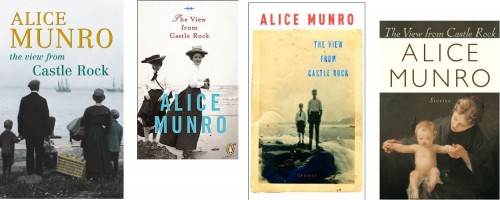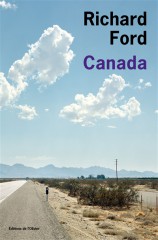Faire surface (Surfacing, 1972, traduit de l’anglais (Canada) par Marie-France Girod), est « un roman fondateur dans l’itinéraire de Margaret Atwood » (quatrième de couverture). Je vous ai déjà parlé de la grande romancière canadienne, née en 1939, à propos de son roman le plus célèbre, La servante écarlate, adapté au cinéma par Volker Schlöndorff et plus récemment à la télévision. Plutôt qu’Œil-de-chat, j’ai repris dans ma bibliothèque ce roman-ci au titre si juste que je le garde pour ce billet, et peut-être aussi comme mantra.
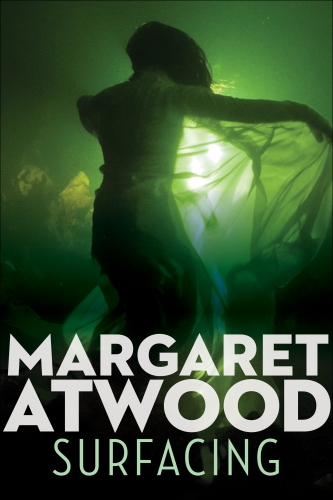
Une femme (c’est elle qui raconte) est en route, avec ses amis David et Anna, et Joe, son compagnon, à côté d’elle à l’arrière de la voiture. Elle reconnaît le paysage, les arbres, une ville du Nord canadien qui possède à présent une déviation ; des images, des souvenirs défilent dans sa tête. Ces deux couples forment le quatuor le plus visible de ce roman. Sa mère et ce qu’elle disait, son frère et ce qu’il faisait, son père disparu – « Où qu’il soit aujourd’hui, mort ou en vie, personne ne le sait » – et elle-même constituent un autre quatuor qui joue dans l’ombre une tout autre partition.
D’emblée, les Américains sont montrés comme des ennemis, eux qui ont fait courir des câbles électriques dans la forêt, pour y installer des fusées – « La ville les a invités à rester, ils faisaient marcher le commerce, ils buvaient sec. » David et Joe profitent du voyage pour tourner leur premier film dont ils ont déjà le titre : « Echantillons aléatoires » : des prises de vue « des choses qu’ils rencontrent, des échantillons pris au hasard ». Elle leur montre au passage la « Villa des bouteilles » aux murs faits de bouteilles assemblées aux culs verts et bruns – ils la trouvent sensationnelle.
La frontière passée, elle se retrouve sur sa « terre familière, en territoire étranger », reconnaît les odeurs de la scierie, la petite « ville de la compagnie » avec ses plates-bandes et sa fontaine ancienne, puis ils se retrouvent devant une voie bloquée, apprennent qu’il y en a une nouvelle. « Rien n’est plus pareil » : elle ne reconnaît plus le chemin et en souffre, voudrait faire demi-tour, mord dans son cornet de glace pour ne pas pleurer. Plus loin, ils croisent l’ancienne route, elle se repère, ils finissent par y arriver, aperçoivent le lac – « nous y sommes trop tôt, et j’ai l’impression d’être frustrée de quelque chose ».
Au lieu d’aller boire une bière au motel avec les trois autres, elle les laisse pour une demi-heure. Elle avait besoin d’eux pour faire ce voyage, maintenant elle a besoin d’être seule : « la raison que j’ai d’être ici les déconcerte, ils ne comprennent pas. Tous ont depuis longtemps renié leurs parents, comme on est censé le faire : Joe ne parle jamais de son père et de sa mère, Anna dit que les siens étaient des gens insignifiants et David appelle les siens les Porcs. »
Voici le village, les bateaux au bord du lac, le sentier de terre battue qui mène chez Paul. De son potager, il répond à son « bonjour » sans la reconnaître, puis le devine quand elle le remercie pour sa lettre et lui demande si son père est revenu : non, il a vraiment disparu, mais il « connaît les bois ». La femme de Paul, Madame, leur prépare du thé, elle la regarde comme si la jeune femme d’une famille réputée « originale et anglaise » était « perdue à jamais ». Elle se souvient des visites ici avec sa mère, tandis que son père parlait avec Paul dehors. Madame soupire sur la mort de sa mère, si jeune.
Son père est parti en laissant chez Paul la boîte postale de sa fille et les clefs de la maison, son auto. Paul est allé à sa recherche sur l’île, la police aussi, mais ils n’ont rien trouvé. Madame, heureusement, n’interroge pas la visiteuse sur le bébé, elle avait sa réponse prête – « resté en ville ; ce serait la vérité, simplement il s’agit d’une autre ville, il est mieux avec mon mari, mon ex-mari. » Elle n’a pas vraiment envie de revoir son père, ses parents n’ont rien compris à son divorce, à l’abandon de son enfant, ils ne l’ont jamais pardonnée.
Chargée de quelques provisions, elle retrouve les autres au bar. Evans, « un gros Américain laconique », les conduira sur le lac : « La presqu’île est là où je l’ai quittée, en saillie sur le rivage de l’île. On n’aperçoit même pas la maison à travers les arbres, quoique moi je sache où elle se trouve ; mon père était pour le camouflage. »
Nous voilà embarqués dans une intrigue tissée de nombreux fils. Découverte de la vie au plus près de la nature dans la maison familiale où l’on se chauffe au bois, où l’on se nourrit des conserves et de ce qui pousse au potager, où les WC sont au bout d’un sentier. Réminiscence de l’enfance, de la jeunesse pour la narratrice, qui cherche dans la maison et aux alentours des signes qui la mettent sur la voie de son père – « A tout moment, l’impression de perte, de vide, peut s’emparer de moi, eux la maintiennent à l’écart. »
Questionnement et jeux amoureux : Joe tient à elle plus qu’elle ne tient à lui, David et Anna qui sont mariés, eux, jouent au jeu de la jalousie, elle toujours occupée à retoucher son maquillage sans lequel elle ne plaît pas à David, lui sans cesse dans l’allusion sexuelle, lorgnant vers toutes les femmes à sa portée. La narratrice ne leur a jamais parlé du bébé. Devenue « ce que l’on appelle une artiste commerciale, ou, quand le travail se fait plus prétentieux, une illustratrice », elle dessine pour son cinquième livre, sans grande inspiration.
La pêche, le canoë, le soleil de juillet, le lac, les arbres, la vie simple – les autres décident de rester une semaine de plus ; il faudra leur trouver des occupations. C’est alors que va s’insinuer le malaise : l’impression d’être observée, de ne pas être en sécurité – son père est peut-être devenu fou, il pourrait réapparaître, ou bien des visiteurs inopportuns, des prédateurs. Paul leur apporte des légumes, accompagné d’un amateur pour la propriété, membre d’une Association de protection de la nature. Le danger peut aussi venir d’elle-même, qui ne cesse de remonter le cours de sa vie, de se parler intérieurement, de voir ou de chercher des signes, des pouvoirs.
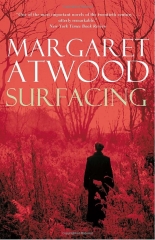
N’en disons pas davantage. « Faire surface » : « Remonter à l’air libre pour respirer, après être resté quelque temps sous l’eau » ou, au figuré, « reprendre contact avec le réel après un passage à vide, une dépression » (entre autres définitions du TLF). Cette expression correspond dans tous les sens possibles aux enjeux de ce roman captivant : tout en suivant les traces de son père, l’héroïne y poursuit une quête solitaire qui exclut peu à peu les autres, l’ouvre à un monde secret à la fois familier et sauvage. Une plongée sous les apparences, quitte à en perdre le souffle.
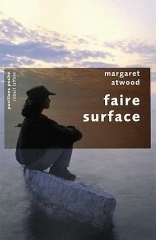 « Le soleil s’est couché, nous glissons vers l’île dans le crépuscule. Cris des plongeons dans le lointain ; des chauves-souris nous dépassent en voletant, rasant la surface de l’eau, désormais apaisée, où les formes du rivage, rocs d’un blanc gris et arbres morts, se dédoublent dans son miroir sombre. Autour de nous, l’illusion de l’espace infini ou de l’espace anéanti, entre nous la rive obscure que nous semblons pouvoir toucher, l’eau, une absence. Le reflet du canoë flotte avec nous, les avirons se jumellent dans le lac. C’est comme de se mouvoir sur de l’air, rien au-dessous de nous ne nous soutient. Suspendus, nous flottons vers la maison. »
« Le soleil s’est couché, nous glissons vers l’île dans le crépuscule. Cris des plongeons dans le lointain ; des chauves-souris nous dépassent en voletant, rasant la surface de l’eau, désormais apaisée, où les formes du rivage, rocs d’un blanc gris et arbres morts, se dédoublent dans son miroir sombre. Autour de nous, l’illusion de l’espace infini ou de l’espace anéanti, entre nous la rive obscure que nous semblons pouvoir toucher, l’eau, une absence. Le reflet du canoë flotte avec nous, les avirons se jumellent dans le lac. C’est comme de se mouvoir sur de l’air, rien au-dessous de nous ne nous soutient. Suspendus, nous flottons vers la maison. »