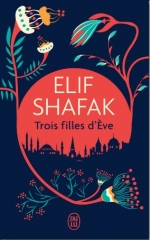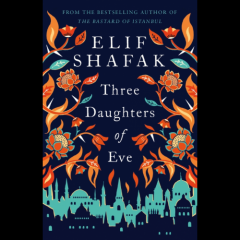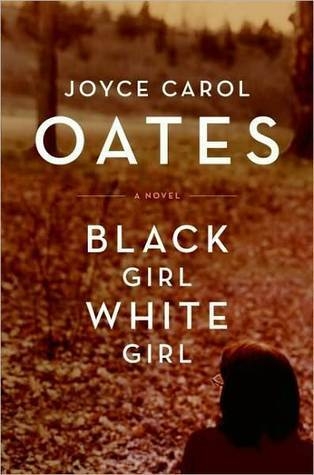En Amérique de Susan Sontag (2000, traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Jean Guiloineau) a été sorti de la bibliothèque et posé à portée de main depuis longtemps, peu après avoir refermé Debriefing. Rien que la photographie de couverture, très belle, tient déjà compagnie. Le plaisir de la découverte en 2001 est revenu d’emblée en relisant le premier chapitre, intitulé Zéro. Aussi n’ai-je pas voulu entamer le suivant avant de revenir sur les ingrédients qui en font l’originalité.

Photo : Onésipe Aguado, Femme vue de dos, ca. 1862
(MET, New York)
Un bref Avertissement signale que le livre « s’inspire de l’histoire d’Helena Modrzejewska, la plus célèbre actrice polonaise, qui a émigré aux Etats-Unis en 1876 », accompagnée de son mari, de son fils et de quelques amis. Sontag précise : « « S’inspire », pas moins et pas plus. » La plupart des personnages sont inventés « et ceux qui ne le sont pas diffèrent de façon radicale de leurs modèles réels. »
Voici l’incipit. « Hésitante, non, frissonnante. Je m’étais introduite dans une réception donnée dans la salle à manger d’un hôtel. A l’intérieur, je sentais encore l’hiver, mais aucune des femmes en robe du soir et aucun des hommes en redingote qui se pressaient dans la longue salle obscure ne semblait remarquer la fraîcheur, aussi j’eus le poêle carrelé dans un coin, au fond, pour moi toute seule. »
Portrait de groupe avec dame – décidément ce titre de Böll me revient en tête (Romy Schneider y jouait le premier rôle dans le film d’Aleksandar Petrović). A la description de la pièce, des invités, se mêlent des bribes de conversation que la narratrice tente de saisir au vol, dans une langue qu’elle ne connaît pas, et pourtant elle devine que cela concerne une femme et un homme, voire deux hommes. Aussitôt elle cherche laquelle de ces femmes élégantes se distingue des autres et la repère : une femme dans la trentaine « avec une masse de cheveux blond cendré », « pas d’une beauté exceptionnelle » – « Mais plus je l’observai, plus elle devint irrésistible. »
« Quand elle se déplaçait dans la pièce, elle était toujours entourée ; quand elle parlait, on l’écoutait toujours. Je crus avoir compris son prénom – Helena ou Maryna – et en supposant que cela m’aiderait à déchiffrer l’histoire si je pouvais identifier le couple ou le trio, quel meilleur point de départ que de leur donner des prénoms, je décidai de penser à elle comme Maryna. Puis je cherchai les deux hommes. »
La scène se déroule comme dans un film, la narratrice braquant sa caméra sur l’un ou l’autre invité, l’un ou l’autre détail du décor. Susan Sontag donne vie à ces personnages à partir d’un vêtement, d’un regard, d’un geste. J’ai l’impression que la romancière nous raconte, tout en contant leur histoire, comment elle s’y prend pour les créer, les faire siens, peut-être à partir d’une photographie d’archives. Elle hésite, puis décide. Elle comprend qu’on commente un choix, qu’on le désapprouve – « Mais son devoir est ici. C’est irresponsable et sans aucun… »
Parmi ces invités, certains se demandent si c’est « bien » ou « mal » – « et leur « mal », leur « bon » et leur « mauvais », qui à mon époque continuent à mener une vie gémissante et atrophiée, ainsi que leurs autres termes, aujourd’hui complètement discrédités, « civilisé » et « barbare », « noble » et « vulgaire », ou ceux devenus aujourd’hui incompréhensibles, « altruisme » et « égoïsme » – excusez les guillemets (je n’en mettrai plus), je ne les utilise ici que pour souligner l’intensité particulière et poignante de ces termes. »
Parfois ils parlaient français – « la seule langue étrangère que je parle bien » – mais « sa » Maryna s’écrie « Oh, ne parlons plus français ! » et la narratrice de commenter : « Quel dommage, parce que c’était elle qui parlait le français le plus vivant. Elle avait une voix grave qui s’attardait de façon délicieuse sur les voyelles finales. » Ses gestes, son aisance, tout lui plaît, comme si elle tombait amoureuse de son héroïne.
Aucun alinéa dans les premières pages de ce chapitre Zéro. Tout est fluide, la vision, l’écoute, la recherche des mots, l’évocation d’un souvenir, et le récit revient toujours à la femme qu’elle a décidé d’appeler Maryna, à propos de qui quelqu’un parle de « symbole national ». Une actrice, « cela expliquerait pourquoi sa grande allure s’imposait aux autres comme de la beauté ; les gestes précis, le regard impérieux ; et la façon dont parfois elle ruminait et hésitait, sans conséquences. »
En même temps, elle finit par donner un prénom, une profession, à certains de ceux qui l’entourent. L’un a « tout du médecin dans une pièce de Tchekhov », l’autre, qui interrompt le brouhaha pour leur faire écouter le bruit de la grêle, sera un régisseur de théâtre, « car il s’inquiétait de trouver des effets ». Maryna « les ensorcelait ». « Je me demandai si elle pouvait m’ensorceler, si j’étais comme eux, pas seulement quelqu’un qui les observait, qui essayait de les percer à jour. Je pensais avoir le temps pour leurs sentiments, leur histoire ; et la mienne. »
Maryna pouvait tout se permettre, porter un pantalon comme George Sand, jouer merveilleusement Rosalinde, et aussi Nora ou Hedda Gabler, si elle acceptait ces rôles. La narratrice se rappelle la première fois qu’elle a vu de près, dans un grand restaurant où un riche soupirant l’avait invitée, une diva en compagnie d’un homme âgé, et qu’elle l’a entendue lui dire : « Monsieur Bing. (Pause) Soit nous faisons les choses à la manière de la Callas, soit nous ne les faisons pas du tout. »
Voilà qui vous donne une idée, j’espère, de cette vingtaine de premières pages formidables d’En Amérique où Susan Sontag glisse entre parenthèses, après s’être demandé pourquoi quelqu’un suit quelqu’un d’autre ou refuse de le suivre : « Ecrire c’est comme suivre et conduire, en même temps. » Nous, lectrices et lecteurs, pouvons la suivre ou non. Pour ma part, je ne céderai pas ma place de passagère dans ce voyage imaginaire où la romancière nous emmène à la rencontre de ses personnages inspirés par la célèbre actrice et son entourage.
Fin du chapitre Zéro : « On peut espérer se trouver parmi des gens au grand cœur, la passion est une belle chose, ainsi que la compréhension, la possibilité de comprendre quelque chose, ce qui est une passion, ce qui est un voyage aussi. Les serveurs apportaient leurs manteaux à Maryna et aux autres. Ils s’apprêtaient à partir. Avec un frisson d’anticipation, je décidai de les suivre à l’extérieur, dans le monde. »