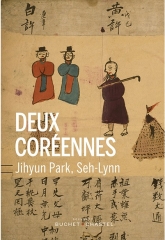Espagne, 1936. Bernanos, « en Espagne au moment du soulèvement des généraux contre la République », constate avec dégoût la connivence de l’Eglise espagnole avec « l’épuration systématique des suspects » parmi les « mauvais pauvres ». Montse (Montserrat), la mère de la narratrice, quinze ans alors, n’oubliera jamais la phrase de Don Jaime Burgos quand sa mère la présente pour un emploi de bonne : « Elle a l’air bien modeste. » Ainsi commence Pas pleurer, qui a valu à Lydie Salvayre le prix Goncourt 2014.

Affiche, 1936, Gallo, Fragua social, Quotidien de l'unité révolutionnaire
© Les affiches des combattants de la liberté, Espagne 1936
A quatre-vingt-dix ans, Montse se rappelle encore l’offense et l’explique à sa fille : « Ca veut dire, je bouillais ma chérie je bouillais, ça veut dire que je serai une bonne bien bête et bien obédissante ! » Vieille, ridée, souffrant de troubles de la mémoire, elle a gardé « absolument intacts les souvenirs de cet été 36 pendant lequel, dit-elle, elle découvrit la vie, et qui fut sans aucun doute l’unique aventure de son existence. » Pas pleurer fait le récit de cette « expérience libertaire » qui émerveille la fille de Montse, plongée en parallèle dans la lecture des Grands cimetières sous la lune de Bernanos.
En juillet 1936, doña Pura, la sœur de don Jaime, vit « dans l’effarement de voir sa maison pillée, ses terres volées et sa fortune détruite par José, le frère de Montse, et sa bande de voleurs ». Elle prie le Ciel de les protéger de ces « sauvages ». José est un « rouge et noir » ; il revient de Lérima où a fait les foins comme saisonnier pour un salaire « dérisoire » ; depuis ses quatorze ans, il travaille aux champs.
Mais cette année-là, la ville a « chaviré jusqu’au vertige, morale culbutée, terres mises en commun, églises transformées en coopératives, cafés bruissant de slogans, et sur tous les visages une allégresse, une ferveur, un enthousiasme qu’il n’oubliera jamais. » Le foulard rouge et noir autour du cou, il raconte à sa mère et à sa sœur « la révolution des cœurs et des esprits ». Sa mère est agacée de tant d’exaltation – des rêves ! Montse est heureuse « d’entendre son frère imaginer un avenir humain où personne ne crachera sur personne », où les richesses seront partagées. « A Palma de Majorque où séjourne Bernanos, les nationaux ont déjà commencé la chasse aux rouges. »
Le père de José, « qui ne sait ni lire ni écrire », réplique : « Moi vivant, personne mangera mon pain. » La mère est plutôt satisfaite de voir Diego, le fils adoptif des Burgos, tourner autour de Montse, même s’il s’est inscrit au Parti et idolâtre Staline, ce que déplorent ses parents. « Du reste, presque tous les pères du village en 1936 sont malheureux car leurs fils ne veulent plus de la Sainte Espagne. » Le 23 juillet, José, dix-huit ans comme Juan, devenu son ami à Lérima, prend la parole devant les paysans, propose la collectivisation des terres, soulève l’enthousiasme jusqu’au délire. Quelques jours plus tard, Diego, le rouquin, s’oppose à ce « folklore révolutionnaire », au désordre. Il affirme qu’il faut « d’abord gagner la guerre avant de faire la révolution ». Il l’emporte.
A la fin du mois, José annonce à sa sœur qu’il quitte la maison ; Montse le suit, avec Juan et sa fiancée. Ils arrivent le premier août « dans la grande ville catalane où les milices libertaires se sont emparées du pouvoir ». Lydie Salvayre mêle des textes d’alors sur « l’épuration nationale » au rappel des faits et au récit de l’ivresse qui s’empare de la jeunesse. Montse a l’impression que sa vraie vie commence, découvre le luxe dans les hôtels réquisitionnés, prend un bain de rêve dans une salle de bain moderne.
« Je t’écoute, maman, je t’écoute.
Tu vois, si on me demandait de choisir entre l’été 36 et les soixante-dix ans que j’ai vivi entre la naissance de ta sœur et aujourdi, je ne suis pas sûre que je choisirais les deuxièmes.
Merci ! lui dis-je, un peu vexée. »
La romancière réussit le tour de force de faire entendre sa mère, d’aller et venir entre son passé et leur présent, et aussi d’écouter Bernanos indigné de ce qu’il voit et obligé en conscience d’en témoigner. Liant le sort des deux familles, la riche et la pauvre, les situations et les sentiments, Lydie Salvayre offre un récit formidablement enlevé, d’un dynamisme qui ne faiblit jamais. La langue varie d’un personnage à l’autre – la mère de Montse, réfugiée en France, accommode le français à sa sauce, recourt à l’espagnol si nécessaire.
Roman de l’histoire et de l’intime, dont les résonances vont bien au-delà des faits de la guerre civile espagnole tels que les rapporte Dan Franck dans Libertad !, Pas pleurer est sans conteste à lire et à conserver dans sa bibliothèque. Lydie Salvayre donnera peut-être envie de relire L’Espoir de Malraux ou Hommage à la Catalogne d’Orwell (à qui ces événements inspireront 1984), elle fera certainement aussi rechercher ce Bernanos de la révolte un peu oublié.
(Les billets de Dominique, Christian Wéry, Aifelle + Claudialucia – signalez-moi le vôtre si vous en avez parlé sur votre blog.)