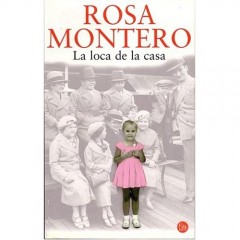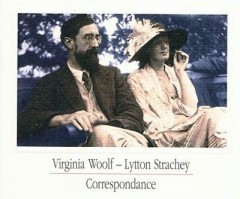Parmi les essais rangés dans la bibliothèque lors du déménagement et que je me suis promis de relire, Les Mots des femmes (1995) de Mona Ozouf. De madame du Deffand à Simone de Beauvoir, ce sont dix portraits de femmes que l’essayiste accompagne, interroge, commente. La directrice de recherche au CNRS a publié depuis bien d’autres ouvrages de grande réputation que je n’ai pas encore ouverts, comme La Muse démocratique, Henry James ou les pouvoirs du roman (1998) ou Composition française : Retour sur une enfance bretonne (2009), mais pour l’instant je m’en tiendrai à l’introduction de Mona Ozouf aux Mots des femmes, intitulée « Dix voix de femmes ».
« Le portrait de femme est un genre masculin. Il s’orne rarement d’une signature féminine. Il se soucie peu des mots des femmes. Il a ses grands hommes, ses auteurs canoniques, les Goncourt, Michelet, Sainte-Beuve. Il a ses lois, il a sa manière. Normatif autant que descriptif, il procède d’une conviction forte : l’auteur d’un portrait masculin n’a nul besoin d’une réflexion préalable sur ce qu’est un homme. » Cet incipit donne le ton. Rappelant les termes dans lesquels Michelet présente « la femme telle qu’elle doit être » lorsqu’il écrit Les Femmes de la Révolution – période de l’histoire dont Mona Ozouf est spécialiste – ou ceux de Sainte-Beuve enchanté par la grâce sérieuse de madame de Rémusat, elle veut rompre avec cette image emblématique des femmes « qui produisent des livres exquis et rares, de préférence pour le cercle des intimes, qui passent avec une élégance discrète dans la littérature et dans la vie et ont la pudeur de leur talent ».
Cet idéal-type féminin qui pousse Diderot à écrire que « Quand on écrit sur les femmes, il faut tremper sa plume dans l’arc-en-ciel et jeter sur sa ligne la poussière des ailes du papillon » (Sur les femmes) mène à s’intéresser moins à leur singularité personnelle qu’à leur conformité au modèle. Même dans le discours actuel sur les femmes, Mona Ozouf perçoit encore l’empreinte masculine qui définit les rôles et les devoirs, fixe « les règles canoniques du portrait ». Comment s’émanciper de ces représentations dominantes ? C’est ce qu’elle a voulu demander à dix de ces femmes « qui ont abondamment écrit sur la destinée féminine et dont frappe la voix autonome, quand on veut bien l’écouter » : madame du Deffand, madame de Charrière, madame Roland, madame de Staël, madame de Rémusat, George Sand, Hubertine Auclert, Colette, Simone Weil et Simone de Beauvoir.
Entendre leur originalité, montrer leur inventivité. En France, selon Mona Ozouf, le féminisme reste tranquille, mesuré, timide, comparé à celui des féministes anglo-saxonnes, au ton plus agressif. Pour les dix interlocutrices françaises qu’elle s’est choisies, elle rappelle que la volonté d’écrire avait un prix, « le prix que doit payer à la société la femme auteur : la marginalité, le ridicule, le manque d’amour, l’affrontement direct et violent avec le monde masculin. » Un tourment décrit « incomparablement » par madame de Staël dont le père ridiculisait la femme qui écrit et dont la mère enseignait que « les femmes doivent briller à la manière des vers luisants, c’est-à-dire dans l’obscurité et faiblement ».
Pour solliciter leur témoignage, Ozouf a préféré puiser dans leurs textes les plus personnels : « j’ai interrogé les Mémoires de préférence aux romans, et les correspondances de préférence aux Mémoires. Elles en ont laissé d’immenses et ont dit pourquoi les mots qui voyagent dans les lettres ont un cachet particulier d’authenticité. » Ces dix femmes ne parlent pas d’une seule voix, et leur discours diffère pour dire « l’amour, le mariage, la maternité, les relations entre hommes et femmes, les fortunes et infortunes de la destinée ». Chacune conçoit à sa manière le rapport entre les sexes et le statut de la femme. Il existe néanmoins entre elle des affinités, des liens, parfois même des rencontres.
« Quelque chose de plus profond encore les unit toutes : une foi, une inquiétude. La foi est celle qu’elles ont placée dans l’éducation des filles. » En effet, celle-ci ne les prépare pas seulement à une destination ou à un état, mais au-delà, « annonce une émancipation, promet qu’on peut ne pas être ce que l’on est, éloigne la fatale féminité. » Passionnées d’apprentissage, de lecture, en écrivant, elles se délient. L’inquiétude réside dans leur rapport particulier au temps, à leur difficulté à « se défaire de la traîne persistante du passé dans le présent ». Je vous reparlerai sans doute de cet essai, Les Mots des femmes, que suit dans la collection Tel, un Essai sur la singularité française. La belle langue qu’écrit (et que parle) Mona Ozouf n’est évidemment pas étrangère au plaisir de la lire et de la relire.