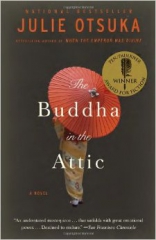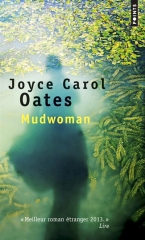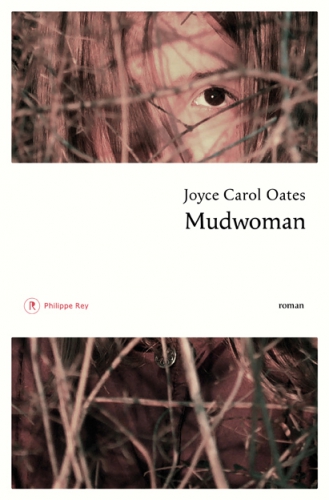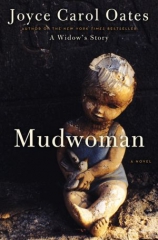Julie Otsuka a gagné bien des lecteurs avec Certaines n’avaient jamais vu la mer (The Buddha in the Attic, 2011, traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Carine Chichereau). C’est son deuxième roman, « une œuvre de fiction » émouvante où, précise un avertissement, toute ressemblance avec des faits réels « ne serait que pure coïncidence ».

“Clifford Harper illustration of woman working in a field” © Clifford Harper/agraphia.co.uk (The Guardian)
Dès qu’on entre dans l’histoire de ces jeunes Japonaises sur un bateau, juste après la première guerre mondiale, en train d’imaginer leur vie d’épouse auprès d’Américains choisis sur la foi d’une simple photographie et d’une promesse de vie meilleure aux Etats-Unis, on se demande quelle réalité historique l’a inspirée – et si Julie Otsuka, née en 1962, évoque là un passé familial. Réponses dans cette vidéo : ce sont les témoignages reçus à la publication de son premier roman, Quand l’empereur était un dieu, qui lui ont donné l’idée de raconter cette histoire connue de toutes les familles américano-japonaises mais souvent ignorée, même des Américains.
Julie Otsuka énumère, juxtapose, raconte la première nuit : « Cette nuit-là, nos nouveaux maris nous ont prises à la hâte. Ils nous ont prises dans le calme. Avec douceur et fermeté, sans dire un mot. Persuadés que nous étions vierges, comme l’avait promis la marieuse, ils nous ont traitées avec les plus grands égards. Dis-moi si ça fait mal. Ils nous ont prises par terre, sur le sol nu du Minute Hotel. En ville, dans les chambres de second ordre du Kumamoto Inn. Dans les meilleurs hôtels de San Francisco où un homme jaune était autorisé à pénétrer à l’époque. » Et cætera.
Les unes ont plus de chance que les autres, mais toutes se retrouvent mariées à des hommes qui ont surtout besoin d’une bonne travailleuse à leur côté, dans les champs, les vergers. Le premier mot qu’ils apprennent à leur épouse, c’est « water », un mot pour tenir le coup, qui peut sauver la vie. Les conditions de vie sont misérables, et les maris admirent leurs dos robustes, leurs mains agiles, leur endurance, leur discipline, leurs dispositions dociles.
D’un chapitre à l’autre, le temps passe. Certaines vont travailler à la ville, dans les lavoirs, les blanchisseries, les hôtels. Ou comme domestiques chez des femmes riches qui leur enseignent plein de choses utiles pour tenir une maison – ou un homme – « Nous les aimions. Nous les haïssions. Nous voulions être elles. Si grandes, si belles, si blanches. Leurs longs membres gracieux. Leurs dents éclatantes. »
Certaines déçoivent ou ne tiennent pas le coup. A nouveau, un jour, elles rêvent de partir ailleurs. « Mais en attendant nous resterions en Amérique un peu plus longtemps à travailler pour eux, car sans nous que feraient-ils ? Qui ramasserait les fraises dans leurs champs ? Qui laverait leurs carottes ? Qui récurerait leurs toilettes ? Qui raccommoderait leurs vêtements ? » Puis ce sont les premières naissances, les enfants à élever.
Comme si tout cela comptait pour rien, un jour, des rumeurs enflent, qui font de tous les Japonais en Amérique des « traîtres ». Les épouses écoutent les nouvelles de la guerre à la radio et s’inquiètent. On parle de listes de noms en circulation, d’hommes envoyés au loin, d’expulsions. Continuer à vivre comme avant ? C’est de plus en plus difficile. Quelque chose va leur arriver, qui risque d’anéantir tout ce qu’elles ont réussi à construire.
« Préquelle » de son premier roman, comme disent les Canadiens francophones, Certaines n’avaient jamais vu la mer se termine là où l’autre commençait. Rythmé grâce à « la voix du nous », ce récit fait entendre le chœur de femmes pauvres et courageuses. Il a remporté les prix Pen Faulkner Award et Femina étranger en 2012. A une époque où l’immigration suscite tant de commentaires, Julie Otsuka rend hommage avec respect et empathie à ces jeunes femmes venues offrir sur une terre étrangère leur force de travail et d’abnégation.